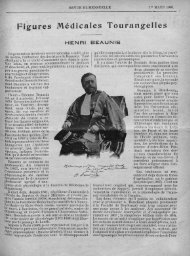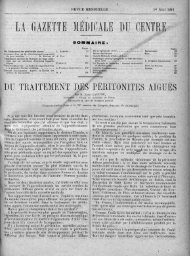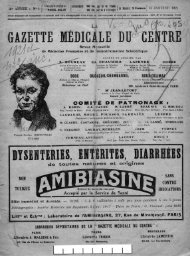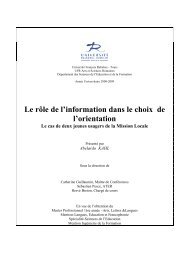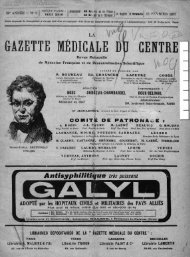Langue, langage et parole en éducation - Université François ...
Langue, langage et parole en éducation - Université François ...
Langue, langage et parole en éducation - Université François ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
59Que cherchons-nous à cacher derrière c<strong>et</strong>te querelle de vocabulaire ? Un s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t deculpabilité probable ? A gommer nos représ<strong>en</strong>tations ? A masquer nos rétic<strong>en</strong>ces ? Atravestir nos int<strong>en</strong>tions ? Les mots ne sont pas tout, ni ne peuv<strong>en</strong>t à eux-seuls tout changer.Quels que soi<strong>en</strong>t ceux que l’on choisit d’utiliser, la syntaxe demeure l’aspect primordial dus<strong>en</strong>s du discours. Le discours seul ne suffit pas non plus, c’est au travers des actes qu’il peut<strong>en</strong>fin dévoiler toute son int<strong>en</strong>tion.Le handicap n’est pas un état, il n’est tout au plus qu’un aléa de la vie qui peut frapper toutun chacun, sans logique <strong>et</strong> de façon inégalitaire. Si nous pouvons conceptualiser le handicap,vouloir le rapprocher de la qualité de travailleur handicapé n’apparaît pas comme uneévid<strong>en</strong>ce. Le groupe « handicap » que nous avons constitué via la RQTH est pour le moinshétérogène au point que nous nous sommes interrogée sur la pertin<strong>en</strong>ce d’un traitem<strong>en</strong>t àparité de situation. Cela nous obligerait à <strong>en</strong>visager deux sortes de handicap <strong>et</strong> cela aurai-ilun s<strong>en</strong>s ? Ce que nous pouvons dire, c’est que la RQTH est dev<strong>en</strong>ue un stigmate « marquevisible, signe appar<strong>en</strong>t de quelque chose de pénible, d'accablant ou d'avilissant » 57 qui nousdistingue visiblem<strong>en</strong>t au regard du monde du travail, même si le handicap, lui, peut resteranonyme, puisque 80% des handicaps ne voi<strong>en</strong>t pas 58 .Nous n’avons pas développé les concepts d’autonomie ni de dép<strong>en</strong>dances car l’un commel’autre sont liés au contexte, comme la situation de handicap d’ailleurs. Peut-on définir lehandicap seul, <strong>en</strong> l’abs<strong>en</strong>ce de ses attributs médicaux, ou ses successions de difficultés quivont l’accompagner, représ<strong>en</strong>tant autant de handicaps supplém<strong>en</strong>taires ?Pour conceptualiser le handicap générique, nous nous appuyons sur les travaux de MichelGouban (2007) qui nous <strong>en</strong>joign<strong>en</strong>t à nous interroger sur la relation autonomie/dép<strong>en</strong>dance.Nous sommes tous dép<strong>en</strong>dant de quelque chose ou de quelqu’un, notre quotidi<strong>en</strong> est régi parces chaînes de dép<strong>en</strong>dances qui nous plac<strong>en</strong>t <strong>en</strong> situation de les analyser pour s’<strong>en</strong> r<strong>en</strong>drelibre. Libre ne veut pas dire indép<strong>en</strong>dant, mais accepter que la relation de dép<strong>en</strong>dance existe,c’est à c<strong>et</strong>te frontière que comm<strong>en</strong>ce l’autonomie. Partant de ce postulat, nous pourrions direque « le handicap est une métamorphose, qui nous place devant la responsabilité de gérerautrem<strong>en</strong>t nos relations de dép<strong>en</strong>dances. » Indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t des représ<strong>en</strong>tations, si l’onintègre le message que nous adresse la société, nous ne pouvons qu’<strong>en</strong>tamer une démarched’introspection qui nous conduira, nous l’espérons, à accepter de reconnaître que« La défici<strong>en</strong>ce est une antiphilosophie. » (Blanc, 2006 : 94).57 Le Trésor de la <strong>Langue</strong> française Informatisé58 Source APF (2011) accédé le 14/04/2011 sur http://www.moteurline.apf.asso.fr/