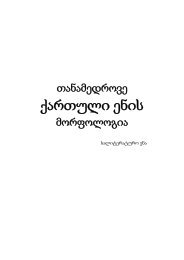iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba XXXIX
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba XXXIX
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba XXXIX
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
« Il n’y a pas de petites cultures » (Georges Charachidzé) 259<br />
Chercheur, il ne cessa jamais de l’être, mais il fut aussi enseignant. Il créa aux<br />
Langues’0 l’enseignement du géorgien, en 1965, enseignement qui aurait dû revenir à<br />
Dumézil dans les années 30, mais dont les foudres du prince N.Troubetskoy le privèrent<br />
à jamais. En 1983, l’intitulé s’élargit, comprenant désormais les Etudes géorgiennes et<br />
caucasiques. Dès 1969, il fut aussi chargé de conférences de langues et civilisations<br />
caucasiennes à l’Ecole pratique des hautes études, section des sciences philologiques.<br />
Aux Langues’O, il remplit de nombreuses fonctions administratives, il fut notamment le<br />
responsable de l’Unité de recherche « Caucase et monde indo-européen » , qui associait<br />
des chercheurs du C. N. R. S. A des chercheurs de l’Ecole. C’était un directeur<br />
extrêmement agréable, surtout pour quelqu’un qui – c’était mon cas – ne travaillait pas<br />
dans le même champ que lui. Les pesanteurs administratives ne lui échappaient pas,<br />
aussi, au moment des rapports d’activité à rendre périodiquement recevions-nous un<br />
mot de ce genre : « L’administration s’ingénie encore à nous faire perdre notre temps;<br />
aussi, envoyez-moi une note brève, je rédigerai moi-même le rapport. » Comme il était<br />
connu pour être un directeur très humain, il recevait parfois de nouveaux membres dont<br />
le profil n’était pas tout-à-fait celui de l’unité, mais qu’il était délicat d’intégrer ailleurs.<br />
Du reste, nous n’avions pas de local capable de nous abriter tous !<br />
La Revue Bedi Kartlisa, fondée en 1957 sous sa forme en langues de l’Europe de<br />
l’ouest, fut dirigée jusqu’en 1984 par son fondateur, K. Salia : il n’y avait pas place pour<br />
deux directeurs . . . Mais de 1985 à 1993, G. Charachidzé parvint à continuer la<br />
publication, sous son ancien sous-titre : Revue des études géorgiennes et caucasiennes.<br />
Il avait une vive conscience de ce que la conquête russe du XIX e siècle avait détruit<br />
dans le monde caucasique, et répétait avec tristesse : « Nous arrivons trop tard. » C’est<br />
pourquoi il ne comprenait pas, encore moins n’approuvait-il l’enthousiasme proimpérialiste<br />
de telle de ses<br />
compatriotes. Pour autant, il n’entrait aucunement dans les mouvements<br />
nationalistes géorgiens, ce qui parfois était incompris des Géorgiens de France ; jamais,<br />
évidemment, il n’avait soutenu le régime communiste. Sa lucidité sur les limitations des<br />
démocraties était d’ailleurs terrible ; qu’on relise les pages extrêmement fortes parues<br />
dans Le genre humain du printemps-été 1995, un numéro dont le thème était Les bons<br />
sentiments. Dans son article « Les Tchétchènes, un peuple en sursis » ; à l’ordinaire, il<br />
manie la provocation : « Je ne puis m’empêcher d’évoquer le « Monsieur Hitler » des<br />
tristes gazettes de 1938-1939 : il ne fallait surtout pas gêner « Monsieur Hitler ». Cette<br />
dénomination m’a toujours stupéfié. Aujourd’hui, c’est « Boris Eltsine » qu’il ne faut<br />
surtout pas gêner, au cas où cela l ‘empêcherait d’en finir une fois pour toutes avec les<br />
Tchétchènes et les Ingouches. » Voila donc quelqu’un qui n’avait pas d’illusions<br />
excessives sur le genre humain, surtout sur l’homme politique. Malgré la distance qu’il<br />
a toujours voulu garder à l’endroit des mouvements nationalistes, il avait de nombreux<br />
et fidèles amis dans la communauté géorgienne de Paris et de la région parisienne. Sa<br />
vaste culture, sa connaissance des êtres humains et son sens de l’humour – ajoutez à<br />
cela qu’il aimait bien vider un verre, à l’occasion d’une rencontre, - ont fait de lui l’un<br />
des thamadas, des animateurs de repas, très recherché, justifiant son assertion : « Nous<br />
avons affaire à des cultures pour lesquelles la fête est un élément central. Et plus<br />
précisément, le festin. »<br />
Il n’avait pas, me semble-t-il, la fibre arriviste. Il aurait certes aimé couronner sa<br />
carrière d’enseignant comme professeur au Collège de France. G. Dumézil ne le soutint<br />
pas et la chose ne se fit pas. G. Charachidzé a souffert de se voir parfois concurrencé par<br />
des personnes qui n’avaient pas ses vastes connaissances.