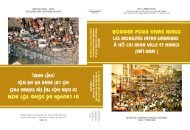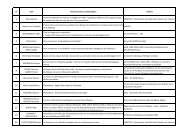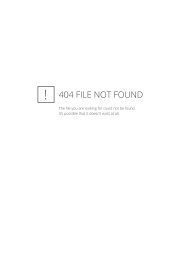PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>PRUD</strong> – <strong>projet</strong> n° <strong>37</strong> – <strong>rapport</strong> <strong>scientifique</strong> <strong>final</strong> (<strong>janvier</strong> 2004)tertiarisation tend à appauvrir les populations, alors que dans l’ensemble les régions anciennement« tertiarisées » exercent une influence positive sur le niveau de vie des populations. Il en va de mêmede l’appartenance aux régions agricoles par <strong>rapport</strong> aux régions industrielles. Ceci laisse entrevoir unedifficile adaptation des populations de la région des Montagnes – traditionnellement minière -, du Sud-Bandama, des Lacs et du N’zi-Comoé aux mutations de grande envergure, en particulier pour lespopulations non pauvres qui observent un bouleversement de leurs activités, l’émergence de nouveauxacteurs et éprouvent certaines difficultés à maîtriser les activités nouvelles.S’agissant de la thèse d’une urbanisation de la pauvreté, l’analyse fait apparaître que le fait derésider en ville améliore le bien-être matériel des ménages dans l’ensemble, et des riches enparticulier. Par ailleurs, le niveau des infrastructures économiques et sociales ne semble exercer qu’uneffet très modéré sur le niveau de vie des populations. En effet, seules les populations non pauvresvoient leur niveau de vie s’améliorer pour des infrastructures moyennes. Pire, la relative richesse desrégions ne semble exercer aucune influence sur le bien-être des populations : la richesse accumulée parles entreprises – valeur ajoutée par tête – ne profite pas aux populations, sans nul doute une résultantede l’extraversion des économies locales ivoiriennes. Dans ces conditions, il apparaît que la pauvreté76des ménages pourrait être imputable à la mauvaise répartition des ressources accumulées . Pour ce quiest de l’éventualité d’un certain effet de seuil sur le niveau de vie des ménages ivoiriens, l’analysemontre (tableau A6) que les grandes agglomérations ne semblent pas plus désavantageuses pour lesménages que les régions les plus faiblement urbanisée s.En définitive, l’impact des régions sur le niveau de vie des ménages semble assez modeste,comparé à celui des caractéristiques propres aux ménages. Une telle situation résulte inexorablementde ce que les ressources accumulées localement sont inégalement réparties entre les populations.Ainsi, alors que la valeur ajou tée des entreprises située s dans la région des 18 Montag nes – ramenée àla population de l a région - a été mu ltipliée p ar 8,5 , l’on observe u ne élévation de la pauvre té danscette région de 11% entre 1985 et 1995. Ceci dénote d’ une extraversion certain e des éco nomies localesivoiriennes telle que l’ont mon tré les études ECOLO C – économies locales – de 1997 à 2000. De fait,ces études ont souligné la forte dépendance financière des collectivités décentralisées – régions etcommunes – vis-à-vis de l’administration centrale. A cela, il faut ajo uter le faible réinvestissementeffectué par les entreprises qui rapatrient l’essentiel de leurs bé néfices.En outre, le niveau des infrastructures économiques et sociales n’ influenceque de façonmarginale le bien-être des population s ; ceci suggère que la densification des activités économiques – àtravers le dé veloppement de l’artisan at et du secteur informel, où l’on retrouv e une frange importantede la population et, notamme nt, des femmes - pourrait jouer un rôle primordia l dans le maintien duniveau de vie des populations. Cette mesure suppo se cependant une facilitati on des populations aumicro-crédit, surmontant les difficult és de gara ntie et de caution associé es aux prêts.En revanche, la spécialisation régionale apporte certai nes indications quant a ux déterminantsdu niveau de vie. En effet, cette variable met en évidence une certaine congestion sur le bien-être desménages dans les régions industrielles. De plus, on remarque que les mutations régionales sont à labase d’une réduction considérable du niveau de vie des ménages, en particulier les plus nantis. Parailleurs, le phénomène d’urbanisation – caractérisé par le taux d’urbanisation - ne semble exerceraucune incidence sur le niveau de vie des populations. Et, alors que l’idée d’une paupérisationcroissante des espaces urbains ne cesse de s’intensifier, on observe que le fait de vivre en villeaméliore le bien-être matériel des populations.Conclusion76 Rappelons à cet égard que la Côte d’Ivoire reste l’un des pays où la répartition des ressources est des plusinégalitaires, comme en témoigne son indice de Gini. En outre, Lachaud (1996a) indiquait que l’accroissementdu revenu moyen de 1% à Abidjan induisait une réduction du ratio de pauvreté de 0,85%.100