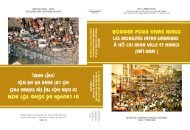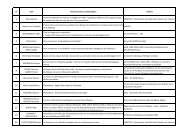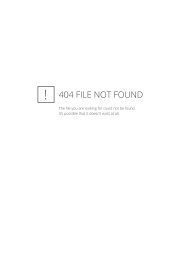PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>PRUD</strong> – <strong>projet</strong> n° <strong>37</strong> – <strong>rapport</strong> <strong>scientifique</strong> <strong>final</strong> (<strong>janvier</strong> 2004)Les industries maliennes sont inégalement réparties sur le territoire. L’intérêt de ce travail estd’appréhender cette localisation en tenant compte des effets d’agglomération et d’urbanisation.L’évolution de la localisation des industries depuis 1960 ne peut être séparée du contexte politique,historique et géographique : le Mali indépendant, engagé dans la voie socialiste comptait 36 unitésindustrielles dont la majorité était liée aux ressources naturelles agricoles et minérales. L’évolution del’ industrie et sa localisation ne peuvent être également séparées des caractéristiques géographiques etclimatiques : le Mali est un vaste pays sahélien situé au Sud du Sahara avec une superficie de 1 241300 km 2 , où dominent les conditions sahélienne et soudanienne.La problématique de cette recherche peut être résumée ainsi : quelle est la localisation des industriesau Mali et à quelle logique obéit -elle ? Nous nous posons les questions fondamentales suivantes :dans quelle mesure l’état des infrastructures économiques et sociales influence-t-il la dimension desagglomérations ? Dans quelle mesure la dimension des agglomérations influence-t-elle la productivitéglobale des facteurs et leurs productivités apparentes ? Comment est ce que les agglomérationscaptent-elles les infrastructures ? Quel est l’effet taille de l’agglomération sur la productivité desentreprises industrielles ? Est-ce que cet effet taille peut-il être appréhendé par les conditionsd’exploitation des entreprises liées aux facilités apportées par la ville et qui améliorent l’exploitationdes entreprises ? (offre de transport collectif et existence d’autres infrastructures procurant plusd’externalités positives que négatives) .L’ensemble de ces questions nous invite à explorer quelques pistes d’explication de la dyna mique desactivités régionales à travers l’étude des effets d’agglomération, des externalités et des économiesd’échelle.Il aurait également été intéressant d’analyser les charges d’exploitation des entreprises et voir leurcroissance par <strong>rapport</strong> à la taille de la ville. Est-ce qu’ elles croissent proportionnellement à la taille dela ville ou non ? Est-ce qu’il y a baisse ou hausse d’ une productivité dite efficace ? Ces différentesquestions pourront faire l’objet de futurs travau x de recherche.La méthodologie est variée. Mais les orientations théoriques décident des champs et des points de vue,d'observation. Les objets de recherche (comportement économique, institutions, branches ou secteursd'activité, marchés) seront étudiés suivant leurs aspects dont l'observation est favorable pour révisernos hypothèses de départ.Nous pouvons distinguer plusieurs méthodes d'investigation empirique et théorique.1) Du point de vue empirique, on peut les répartir dans trois sous-groupes :• Les sources non spécifiques telles que les recensements des entreprises, les études de différentsministères, les travaux universitaires, ainsi que tous les autres documents pouvant apporter unéclairage sur le sujet, même s'ils n'ont pas été conçus directement pour ce genre d'étude.• Les petites enquêtes qualitatives ne concernant qu'un échantillon réduit, utilisant un ou plusieursquestionnaires plus ou moins détaillés avec possibilité de traitement par ordinateur. Ces enquêtesqualitatives concernent un échantillon réduit, mais étudié durant une longue période. Elles utilisentégalement des entretiens avec les patrons, les ouvriers etc. permettant d'en apprendre sur lesdifférentes catégories socio-professionnelles et sur leurs relations entre-elles.• Les enquêtes lourdes, précédées d'un recensement employant un questionnaire détaillé privilégiantun traitement par ordinateur des différentes variables (analyse de régressions multiples, tris à plat,tris croisés…).• Méthode synthétique qui diversifie les volets suivants : typologie des activités industrielles,recensement exhaustif des établissements, monographies socio-économique utilisant notammentles entretiens dans les différents secteurs, sondage par stratification selon l'activité, la zone et lataille conduisant à des résultats plus quantitatifs. Les entretiens avec les responsables permettentde révéler la logique des comportements des firmes.Au-delà de la diversité d'objet et du débat qualitatif/quantitatif, peut-être que les diversitésméthodologiques tiennent-elles en fait à des différences de moyens financiers : nous sommes dans lacatégorie de chercheurs/universitaires qui est nettement bien moins lotie à côté du secteurintermédiaire des organismes nationaux qui lui-même l'est bien moins à côté de grandes organisationsinternationales. Le capital avancé jouerait-il comme barrière à l'entrée dans la recherche ?2) Du point de vue théorique, les conflits méthodologiques sont nombreux :46