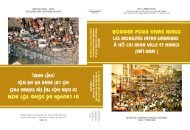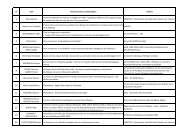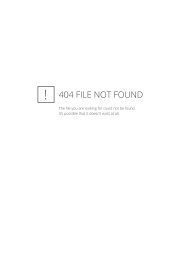PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>PRUD</strong> – <strong>projet</strong> n° <strong>37</strong> – <strong>rapport</strong> <strong>scientifique</strong> <strong>final</strong> (<strong>janvier</strong> 2004)Encadré 3. La notion de "secteur informel" et les débats théoriquesUn détour théorique sur la notion d'économie populaire ou de "secteur informel" et sur les choix conceptuels etterminologiques s'impose, pour reconstituer une image cohérente des différentes interprétations de l’économie"populaire", au-delà du voile qui l’entoure, de par la pluralité des approches théoriques et la profusion destravaux empiriques.L’ensemble socio-économique composé de micro-entreprises et d'activités d’auto-emploi, qualifié de "secteurinformel" a été le lieu d'intenses débats conceptuels et théoriques. Cet ensemble a été perçu comme (i) uneprécondition au développement en tant qu’étape nécessaire et transitoire, (ii) l’expression de la domination dusystème économique international, (iii) une revanche des acteurs contre l’Etat - courant libéral et courantautogestionnaire -, en tant qu’alternative au développement suite à l’échec des politiques d’industrialisation(small is beautifull) ou en tant que troisième voie – "entre don et marché"-, (iv) un lieu d’inventions socialesface à la précarité, en tant que développement spontané et amortisseur de la crise, ou encore (iv) un modespécifique de régulation et un type de <strong>rapport</strong> à l'Etat.Ces débats renvoient aux interprétations des formes de dualisme dans les économies à faibles revenus, auxdéfinitions privilégiées de l’informalité en termes de formes de production ou d’extra-légalité, aux choixméthodologiques et conceptuels (dualisme, systémisme, structuralisme, institutionnalisme).Le processus d’informalisation interroge le mode de développement économique et doit être spécifié. Il constitueun phénomène universel et pluriel dans le temps et dans l’espace. Mais la nature et la signification del’informalisation des économies sont à chaque fois différentes, compte tenu des structures productives etdémographiques, des modes d’accumulation et de régulation, des formes historiques de mise en place de l’Etat,de l’épaisseur historique des sociétés.Les modèles fondateurs du dualisme sectorialiste définissent le "secteur traditionnel" comme mode deproduction spécifique et autonome ; il y a autonomie des formes productives entre secteur moderne et secteur desubsistance (à partir de Lewis, 1954). A l'inverse, l'école radicale systémiste raisonne en termes de soumissionau capital, d'extra-légalité et d'économie informelle.Les extensions dualistes néo-keynésiennes et néo-structuralistes partent de la double interprétation del’hétérogénéité des activités informelles en tant que formes d’autonomie relative et formes d’interaction oud’intégration au reste de l’économie et à l’économie mondiale, dans une optique institutionnaliste, à l'échellesectorielle et macroéconomique. L’hétérogénéité du "secteur informel" et son caractère non capitaliste sont deuxpoints de départ qui conduisent à dépasser le dualisme méthodologique. Ces extensions relèvent dans uneoptique sectorielle, une hétérogénéité de subordination. Elles ouvrent la voie à l’exploitation de modèleséconométriques (MEGC), qui offrent une analyse plus fine des relations sectorielles, sans quitter labipolarisation sectorielle d’origine. Elles permettent notamment d’approfondir l’hypothèse du "missing middle"et soulèvent les contraintes posées à l’essor d’un tissu de PME.La synthèse néo-structuraliste et institutionnaliste insiste sur la spécificité des formes productives des petitesactivités urbaines, de par les stratégies de minimisation des risques en univers incertain et le chevauchement deslogiques domestique et marchande, par la présence de logiques hybrides à la fois marchandes et non marchandes,la prédominance des logiques de reproduction simple plutôt que d'accumulation (maximisation du profit), desfonctions sociales plutôt que des fonctions de production (en référence aux filiations théoriques classique etcambridgienne). Elle explique l’hétérogénéité des activités par la nature des relations intersectorielles etintrasectorielles et les structures sociales et politiques, en considérant les <strong>rapport</strong>s sociaux internes (Hugon etPourcet, 1995). L'essor de ces formes productives est une réponse de l’offre en termes de reproduction plusqu’en termes d’accumulation, sans s’accompagner d’une extension suffisante du marché intérieur. Il ne traduitpas une transition d'un stade de développement à un autre, mais le maintien durable de la "brouette auprès de lalocomotive", conduisant à des effets de gaspillage des potentiels productifs. A terme, il y a nécessairement uneévolution des facteurs structurels et l’issue n’est pas connue.Fondamentalement, les synthèses néo-structuralistes et institutionnalistes conduisent à changer de question : sil’interdépendance productive et la mobilité du travail entre les secteurs rentrent dans la définition même desactivités informelles, si les causes de la fragmentation ne sont plus exogènes - les secteurs étant définis par des<strong>rapport</strong>s d’intériorité et non d’extériorité -, l’hétérogénéité des formes productives et des formes d’emploi n’estplus source de sous-développement, mais modalité du fonctionnement de l’ensemble de l’économie et de lasociété. Il ne s’agit plus d’interpréter la dualité ou la fragmentation des formes productives comme insuffisanceliée au sous-développement et de préconiser le développement du secteur formel ou la formalisation du secteurinformel, mais de comprendre la nature et les spécificités de ce mode de développement. Les outils conceptuelsde l’approche néo-structuraliste permettent d’analyser les facteurs structurels et socio-historiques, ceux del’approche régulationniste révèlent les facteurs institutionnels et les <strong>rapport</strong>s spécifiques à l’EtatLes analyses régulationnistes montrent que l’informalité est une condition d’existence de l’Etat et non comme sanégation. Les modalités de formation et de distribution des revenus sont étroitement liées à la spécificité del’Etat, dans des sociétés à dominante non salariale, marquée par une topologie spécifique des ordres domestique,marchand et étatique (Théret, 1992).71