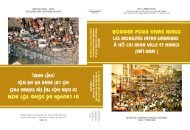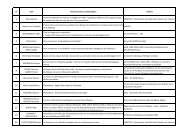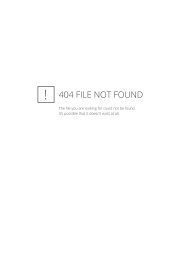PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
En conséquence, il s’avère indispensable de mettre en lumière cette activité qui intéresse vivement lesorganisations économiques sous-régionales et les gouvernements dont le souci et les besoinsd’intégration et de complémentarité économique se font pressants.Dans cette perspective, l’espace frontalier entre le Mali et la Côte d’Ivoire offre un cadreadéquat et nécessaire d’analyses.Nous abordons dans cet article, les trais relatifs à la réalité de l’espace frontalier ivoiro-malien,qui se veut un espace binational formé par un contact entre les deux souverainetés et les relationsqu’entretiennent les populations qui se meuvent dans cet espace.Le second axe traite du volume des produits échangés entre les espaces et les différentesmécanismes mises en œuvre par les populations et les opérateurs pour commercer entre eux. C’estlà également que nous évoquons les politiques économiques mises en œuvre par les Etats pourentreprendre les échanges entre les deux pays. Nous faisons également une analyse des réseauxmarchands dans le fonctionnement du commerce.Très structuré et dynamiques dans des formes institutionnelles de coordination, les acteurs quianiment les échanges se singularisent par les stratégies qui font pérenniser l’importance du commerce .Le dernier axe met l’accent sur les conséquences des échanges sur les espaces frontaliers.En effet s’il est vrai que les échanges entre le Mali et la Côte d’Ivoire sont importants, ils sont loind’atteindre le niveau auquel on est en droit de s’attendre. Ce décalage résulte des difficultés quirendent le volume des échanges peu important et le marché ivoirien peu accessible par lesopérateurs économiques : insécurité routières liée à la rébellion armée qui sévit dans le Nord de leCôte d’Ivoire, multiplication des faux frais, l’état de la principale voie reliant Bamako à Abidjanvoire du couloir de transport.I. REALITE D’UN ESPACE BINATIONAL1.1 Le cadre frontalier ivoiro-malienL’espace frontalier autour de la frontière ivoiro-malienne, se caractérise par une succession decuirasses latéritique. L’altitude moyenne est de 400m. C’est également dans ses cuirasses que lesprincipaux cours d’eaux qui servent de frontière naturelle aux deux pays, se frayent des chainaux. Ils’agit de Mahandiani à l’Est et de la Bagoué à l’Ouest. C’est également une zone savanicole. Eu égard,à ces caractéristiques, les marges territoriales du Nord de la Côte d’Ivoire et celles du Sud du Mali nesont pas un frein à la mobilité des populations. C’est donc dans cet ensemble homogène que lespopulations entretiennent des relations très anciennes pratiquent des échanges très actifs.1.2 Une histoire commune et mise en place de la populationLes populations vivant de part et d’autre de la frontière possèdent une histoire commune et ontdes traits socio-culturels similaires. Comme dans toute la zone de savane, l’actuel peuplement desmarges territoriales nord de la Côte d’Ivoire et du Sud du Mali est le produit de mouvementsmigratoires multiples, enchevêtrés et s’étalant sur près de cinq siècles. Sénoufos venus de Sikasso etde San, Mandé venus de Bougouni, Malinké venus de Djémé, Dioula venu de Kong. La région futpréalablement peuplée par les Sénoufos qui en perdirent le contrôle, à partir du 18 e siècle.L’implantation de tous ces peuples est l’aboutissement d’une densification progressive desmouvements d’échanges de biens et de personnes, amorcé à partir du 16 e siècle. Cette vaste région futtraversée par plusieurs axes marchands dont le plus significatif était celui traversant la localitéd’Odienné. Cet axe reliait les actuelles régions soudanaises maliennes à la forêt ivoirienne, par lequeltransitaient la noix de cola, le sel gemme, l’or et le bétail. Les mouvements caravaniers engendrés parces échanges suscitèrent peu à peu la création d’unités de peuplement malinké et bambara (Dioula)dans la zone.C’est donc cette activité de commerce forêt-savane, qui permis l’implantation des différentspeuples de part et d’autres de la frontière. Au total, les habitants de la zone sont liés par des alliancesanciennes et renouvelées, de part et d’autre des frontières. Le sentiment d’appartenance commune senourrit de la religion musulmane, des liens matrimoniaux et coutumiers et des activités économiqueset des échanges.148