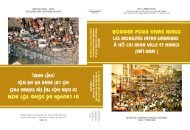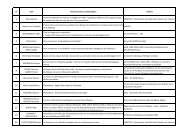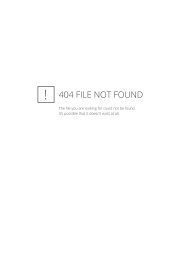PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>PRUD</strong> – <strong>projet</strong> n° <strong>37</strong> – <strong>rapport</strong> <strong>scientifique</strong> <strong>final</strong> (<strong>janvier</strong> 2004)économique avec la prise en compte des économies externes, que l’existence de processus relationnelsparticuliers et l’existence d’espaces privilégiés peuvent améliorer la productivité et favoriser ledéveloppement des firmes 32 . Le concept va ainsi trouver sa place dans les champs d’analyse à la foisde la théorie micro-économique et de la dynamique industrielle, auxquels se greffe l’économiespatiale.Initialement, les contributions parmi les plus marquantes notamment celles de Pigou (1920), Viner(1931), Ellis et Fellner (1943), Meade (1952), Scitovsky (1954), Bator (1958) amènent à spécifier leseffets externes (économies et deséconomies) comme des relations dans le marché concurrentiel parlesquelles des agents (producteurs ou consommateurs) affectent le résultat d’activités d’autres agents.Les effets externes peuvent être « pécuniaires » ou « technologiques ».. Dans ce dernier cas, il s’agitd’interdépendance directe c’est-à-dire non médiatisé par le système des prix, donc des « défaillance demarché », contrevenant à l’équilibre concurrentiel optimal au sens de Pareto. D’autres matériauxd’analyse app araissent à partir des années soixante qui précisent à la fois la nature et la portée duconcept en s’appuyant sur les travaux de Coase (1960), Buchanan (avec Stubbledine, 1962, Tullock,1962) sur la th éorie des biens collectifs impulsée par Samuelson et les développements de l’économiepublique, de l’économie des institutions et des droits de propriété. La localisation et lescaractéristiques spatiales d’émission et de réception constituent souvent une dimension essentielle desexternalités technologiques. Les effets externes spatiaux peuvent être géographiquement uniformes oudifférenciés à l’intérieur d’une aire de concernent comme ils peuvent être techniquement séparables ounon séparables (Catin, 1985). Ils peuvent être formalisés par une fonction de « distance-réponse »(Papageorgiou, 1978). De ma nière générale, les modèles d’équilibre d’affectation des ressources enprésence d’externalités spatiales peuvent envisager une localisation donnée et des comportementsd’adaptation des agents ou poser le problème général du choix de la localisation pour l’équilibreallocatif.On trouve une utilisation du concept d’externalité dans les théories de la croissance équilibrée(balancée) et déséquilibrée (non balancée) descriptive des processus et des stratégies dedéveloppement, dans la théorie des pôles de croissance et des effets de polarisation de Perroux, dansl’analyse du développement régional (Perrin, 1970), dans les études d’impact des politiquesd’investissements localisés etc.Lorsque les trajectoires de développement s’analysent comme un processus de création et ded’exploitation des externalités « dynamiques », par les agents, les phénomènes envisagés recouvrentune variété de modes de transmission et d’itinéraire de propagation, par le marché ou en dehors. Lesexternalités positives s’apparentent aux différents mécanismes de croissance-développementengendrés dans un milieu économique par son fonctionnement et par des implantations d’activité oud’équipements et elles embrassent souvent des notions familières utilisées par ailleurs dans la théorieéconomique : influence des économies d’agglomération et jeu des multiplicateurs 33 .Le terme d’externalités (ou effets externes) peut être utilisé pour désigner toute situation où lesactivités d’un ou de plusieurs agents économiques ont des conséquences sur le bien-être d’autresagents, sans qu’il y ait des échanges ou des transactions entre eux. Lorsque ces conséquences sontbénéfiques, on parle d’externalités positives, dans le cas contraire, on parle d’externalités négatives. Laprésence de ces externalités se traduit généralement par des inefficiences (au sens du critère de Pareto)dans la mesure où l’existence a priori de récompense ou de gain (à l’origine des externalités positives)et l’absence de sanctions (pour ceux qui engendrent des externalités négatives) provoque un « trop »de celles-ci et « pas assez » des autres.La question des externalités est importante en économie dans la mesure où elle amène à s’interrogersur le partage entre relation marchande et non marchande. Et la présence d’externalités invalide le32 Cet aspect était fortement négligé dans le jeu d’hypothèses par les théoriciens de l’équilibre concurrentiel del’époque.33Les multiplicateurs régionaux occasionnés par une activité nouvelle traduisent particulièrement les effetsd’entraînement inter sectoriels (qui se propagent dans la région à travers l’ensemble des relations input-output àpartir des achats en consommations intermédiaires de l’activité) et les effets d’induction (dus aux revenusdistribués par l’activité -c’est-à-dire les salaires et les profits- et la demande <strong>final</strong>e engendrée satisfaite parl’économie régionale).54