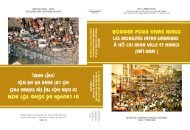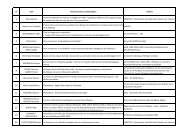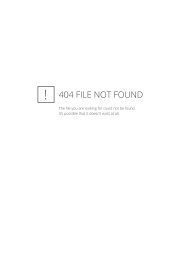PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I- EVALUATION DES CAPACITES D'EXPORTATION ET DES BESOINS D'IMPORTATIONCes évaluations pouvaient être faites suivant deux méthodes : suivant un schéma "produitdépense"ou par régionalisation du TES du Mali. La première méthode présentait l'avantage depermettre l'utilisation des distributions de la population active occupée par profession, et donc dedistinguer plusieurs types d'artisans, de commerçants, d'agents de l'Etat, avec leurs niveaux dequalification. Par exemple, l'utilisation de ces données permettait de distinguer les personnels desservices de santé, d'éducation et d'administration, et de les regrouper en deux ou trois niveaux dequalification. Mais cela nécessitait l'utilisation de données d'origine éparse (pondération de l'indice desprix à défaut d'enquête sur les budgets des ménages, "recensement" de la pauvreté, budget de l'Etat,enquêtes sur l'emploi dans le secteur informel, etc.) dont l'acquisition et la mise en cohérence posaientproblème. La seconde méthode posait moins de problèmes de mise en cohérence des données etpermettait de distinguer plusieurs types de flux d'échanges interurbains.Nous n'avons pas fait de choix à priori entre ces deux méthodes car les calculs prenaient beaucoupmoins de temps que l'acquisition, la transmission et la mise en cohérence des données. L'un ou l'autrecalcul a progressé, alternativement, tant qu'un besoin de données non satisfait ne bloquait pas sonavancement. Finalement, les données issues de différentes sources produisant des résultats tropincohérents, nous avons du renoncer à la première méthode. C'est pourquoi la première partie de ce<strong>rapport</strong> n'expose que les résultats obtenus avec la distribution par branche d'activité de la populationactive occupée. Un séjour à Bamako, consacré à des discussions avec les statisticiens, aurait peut-êtrepermis de résoudre certains de ces problèmes ; mais notre budget de missions était épuisé. Les deuxméthodes de calcul sont exposées dans les annexes II et III.La méthode d'évaluation des capacités d'exportation et des besoins d'importation parrégionalisation du TES permet de calculer six grandeurs : XLI ou exportations inter urbaines deconsommations intermédiaires, MLI ou importations interurbaines de consommations intermédiaires,X ou exportations vers l'étranger, M ou importations de l'étranger, XLF ou exportations interurbainesde biens <strong>final</strong>s, MLF ou importations interurbaines de biens <strong>final</strong>s, par branche et par localité.Avec 306 arrondissements et 19 branches d'activité, les résultats de ce calcul forment unensemble d'une douzaine de tableaux de dimension "306x19". Il n'est pas possible de les imprimer, deles présenter graphiquement ou de les cartographier. Cette information doit être conservée en vue dessimulations ultérieures, mais elle doit être synthétisée en vue de sa présentation immédiate. Deuxprocédures complémentaires permettent de réduire les tableaux sans perdre trop d'information sur leréseau urbain : 1-réduire le nombre des lignes (localités) à 100 en rattachant immédiatement les zonesrurales des arrondissements aux 100 centres urbains ; 2- réduire le nombre des colonnes de 19 à unepar tableau en calculant un indicateur d'attractivité.Nous supposons qu'un centre est d'autant plus attractif qu'il exporte et importe plus demarchandises à destination ou en provenance d'individus disséminés sur le territoire ; l'attractivité d'uncentre vis à vis d'un individu (ou de son lieu de résidence) décroît en raison de la distance et croît enraison de sa capacité d'échange avec l'extérieur. Pour calculer un indicateur spécifique (au bien i)d'attractivité, il suffit d'évaluer la capacité d'échange d'un centre l comme l'écart entre l'effectif réel etl'effectif théorique des producteurs du bien i résidant dans ce centre 9 . La distance doit être pondérée9 - Ceci n'est acceptable que si la productivité d'un travailleur de la branche ou de la profession i est identique entous points du territoire, et si sa demande du bien i est identique en tous points du territoire.Justification du choix de l'écart de Belson pour le calcul de l'attractivité:Hypothèses de calcul: Chaque spécialiste approvisionne le même nombre d'habitants (X/Xj), quelque soit sonlieu de résidence. La productivité apparente du travail est la même en tous lieux, égale à (Vj/V)…=Vij.la population approvisionnée par les Xij spécialiste de la production j dans la ville i = Xij.X/XjLa population non résidente approvisionnée… = Aij = (X/Xj).Xij-XiNB: Aij est négatif si la localité i est importatrice du bien j.Le nombre total de personnes non résidentes potentiellement approvisionnées par les Xi actifs de la localité iégale: Ai= ∑(Xij.X/Xj – Xi)Vj/V. Le nombre moyen de chalands par actif est : A'i = 1/Xi. Ai.Suivant ce calcul, l'unique chirurgien spécialiste du petit orteil gauche (dont tous les habitants du pays sontpotentiellement les patients, mais dont peu recourent à ses services) est plus attractif que le maraîcher auquel deschalands achètent tous les jours. Il faut pondérer l'attractivité des spécialistes suivant la part que leur production127