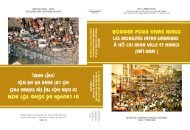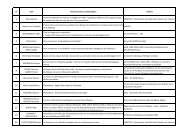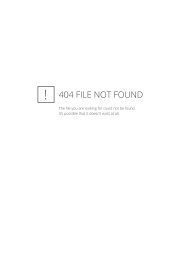PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Le fonctionnement et l’attrait des marchés frontaliers sont fonction de leur accessibilité. Il estdonc indispensable de porter un regard sur le réseau routier.2.4 LE RESEAU ROUTIER ET LE CHEMIN DE FERLe réseau routier est la voie la plus utilisée pour la fréquentation régulière des marchés etl’approvisionnement des villes en produits agricoles de consommation courantes et en produitsindustriels de base. Les principales villes de la zone sont reliées aux capitales des Etats par des axesroutiers en très bon état. Ces routes sont bitumées et praticables en toutes saisons. Ces principalesvoies, sont longues de 480 km mais ces axes sont en état de dégradation avancé, surtout du côté de laCôte d’Ivoire sur l’axe Ferké-Ouangolodoudou.Cet état de fait, est dû au non respect des poids alloués aux véhicules transportant desmarchandises vers le port d’Abidjan. Les camions du fait de l’absence de pont bascule sur les postesd’entrée font des surcharges. Ainsi un camion prévu pour 30 tonnes de marchandises, il n’est rare de levoir avec un chargement de 40 voire 50 tonnes de marchandises. Ce mauvais état des voies allonge ladurée du voyage. Ajouter à cela les faux frais de routes à débourser aux différents points de contrôleset surtout l’insécurité grandissante sur ces axes à partir d’une certaine heure (17 h) n’incite pas à lesemprunter.Les autres voies dont la viabilité reste précaire ou intermittente limitent les possibilitésd’évacuation des produits vers les grands centres urbains de la zone. Cette situation jouedéfavorablement sur les coûts des produits. Les commerçants développent des initiatives pourtitrer partie de la situation. Ainsi, des marchands ambulants sur vélo ou sur mobylette sillonnentles petits marchés de brousse, stockent les produits, qu’ils acheminent par la suite vers les marchésde regroupement. C’est à partir de ces derniers qu’une redistribution des produits est effectuéevers les marchés départementaux à l’aide des camions.Le chemin de fer reliant Ouagadougou à Abidjan reste la voie la plus importante pourtransporter une quantité importante de marchandises. Cet axe de circulation permet d’échapperaux tracasseries policières et reste de fait la voie la mieux indiquée et plus sûr pour faire deséchanges de longues distances. Ainsi pour la seule année de 2001 ce sont près de 200.000 tonnesde marchandises qui ont été convoyées par rail.Ce chiffre pouvait connaître une hausse si d’importants investissements avaient été entreprispour réhabiliter et moderniser ce chemin de fer vétuste de plusieurs dizaines d’années. Ajouter à celal’état de délabrement avancé des locomotives dont les vitesses maximales ne dépassent guère 40 km/h. Cette situation n’encourage pas les opérateurs à son utilisation. Pourtant rentabiliser ce chemin defer peut permettre aux opérateurs économiques de Sikasso et de Bobodioulasso de ne plus parcourirune si longue distance pour avoir une porte de sortie et d’entrée sur la façade océanique. La ville deOuangolodougou en Côte d’Ivoire pourrait jouer un rôle de port sec pour réceptionner les produitsdestinés à l’import et à l’export. Pour cela la construction d’entrepôts est nécessaire.2.5 Les acteurs des échanges.Les transactions commerciales dans la zone reposent sur l’activité conjointe de quatre typesd’agents économiques dont les plus importants sont les suivants : la gente féminine, la douane, lescommerçants et les passeurs (SOTRA PIEDS).A chaque type d’agent économique s’associe un type particulier de commerce. Ainsi, au niveaudu commerce de portée locale, où on note la forte présence de la gente féminine, les produits échangéssont les complémentarités productives agricoles ou un savoir faire particulier. C’est ce type decommerce que Labazée qualifie de commerce capillaire. Il s’agit de petites quantités de produitsagricoles comme le maïs, le sorgho, le mil, l’igname, le soumbara (arôme) et des feuilles de manioc.Ce type de commerce s’apparente à un « commerce de don » ou de troc.Un autre type commerce concerne le « trafic des fournis », selon HERRA (1995). Cecommerce à petite et moyenne échelle porte sur des produits manufacturés. Les sourcesd’approvisionnement de ces produits sont les marchés frontaliers. Les acteurs de ce commerce154