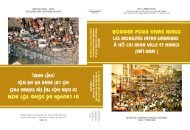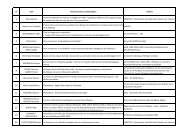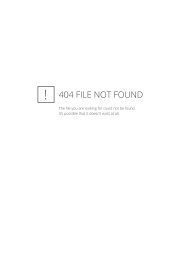PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>PRUD</strong> – <strong>projet</strong> n° <strong>37</strong> – <strong>rapport</strong> <strong>scientifique</strong> <strong>final</strong> (<strong>janvier</strong> 2004)Dynamiques de la pauvreté et structuration spatiale en Côte d’IvoireKoko Siaka KON E*1.IntroductionA la fin des années 1970, l’économie ivoirienne a été brutaleme nt secouée par u ne série dechocs extérieurs, en particuli er sur les marchés du café et du cacao. La situatio n a continué de sedégrader sous l’effet du f ardeau de la dette e t de la poursu ite d’une expansion démographiqueimportante – 3,8% par an. Les programmes d’ajustement structurel adopt és dès 1981, qui tentaient dejuguler une crise économique, au demeurant structurel le, sans pa rvenir à corriger les déséquilibresmacroéconom iques de l’économie ivoirienne et inver ser la baisse tendancielle de sa croissance,s’avèreront même dramatiques pour un e frange importa nte de la population 57 (K oné, 2002 a). De fait,de nombreux ménages sont devenus pauvres suite à une mauvaise récolte, ou à une chute des prix desmatières premières, ou encore à une pe rte d’emploi. Le phénomène a été accélé ré par l’abandon de« l’ambitieux » programme de développ ement du pays. En effet, la forte contraction de la capacitéd’investissement de l’Etat ivoirien 58 a renforcé les disparités existan t entre ré gions, les régions les pluspauvres étant abandonnées à elles-mê mes. Ainsi, le « Prog ramme d’ urgen ce » initié en 1974 en vue deréduire les considérables écarts régionaux en dotation d’ équipement et relever le niveau de vie despopulatio ns locales, ne put être mené à son terme, interro mpant, par exem ple, la volonté d’impulserdurablement une muta tion du Nord ivoirien 59 . A l’imag e de cett e aire géographique, de nombreusesautres ont fait l’objet d’un désengagement progressif de l’Etat, créant des disparités tout aussimarquées au sein même des strates régionales traditionnelles d’analyse e n vigueur en Côte d’Ivoire.En effet, même s’ils ne furent pas durables et ég alement ré partis, les proj ets de développement initiésau lendemain de l’indépendance ont contribué à enrichir certains opérateurs privés et à affirmersurtoute l’étendue du territoire un e classe moyenne densifiant les liens entre les villes et l’arrière-paysivoirien. Malheureus ement, l’inexiste nce d’un tissu économique local dynamique a étéparticulièrement dramatique pour les aires géographiques les moins bien dot ées et, parfois, pour cellesplus proches. Ainsi, de puis l’exacerbation de la crise à pa rtir de 1983-1984 , l’on a observé un exodemassif des populations des rég ions les m oins do tées – principalement les espac es ruraux - vers lescentres u rbains les plus dynamiques – ou du mo ins les plus à mê me de leur of frir du trava il et des* Université de Bouaké et CED-Un iversité Montesquieu Bordeaux IV. Email : ko kokoné@ yahoo.fr57 Toutefois, la montée de la pauvreté en C ôte d’Ivo ire ne saurait être totalement imputable à l’ajustement. SelonNshimyum uremyi (1998), elle résulterait d e l’absence ou de la fa iblesse de croissance écono mique, l’ajustementne jouant qu’un rôle secondaire. En effet, alors qu’entre 1985 et 1986, la reprise économiq ue entraîn e une baissede la pauvreté de près de 4 points de pourcentage, la recrudescence de la crise à partir de 1987 conduit à uneexplosion du phénomène qui, de 9% à cette date, touche en 1993, 31% de la population – une telle ex plosion esten partie inhérente aux ajustements d e la ligne de pauvreté en Côte d’Ivoi re, voir Koné (2002a, pp. 133 -134). Lafaible reprise amorcée à partir de 1993, la dévaluation du F.CFA en 1994, les produ ctions record des produits derente, l’aide internationale massi ve et l’accé lération des réformes se sont avérées insuffisantes pour inverse r leprocessus de paupérisatio n. Pire, l’ économ ie ivoirienne reste toujours très fortement dépendante de l’évolutiondes cours m ondiaux des matiè res premières et de la dégrada tion du contexte socio-politique qu i tende nt àinstaller de plus en plus de populations dans une pauvreté des plus aiguës.58 Le taux d’investissement public qui avait atteint 15% du PIB en 1976 est ramené à 10,5% en 1981 et à 6% en1985 (BENETD, 1997).5 9Comme nous le rappelle Labazée (2002, p. 324), « l’ambition d’un Nord ivoirien en mutation visait à terme àune intégration spatiale et économique des activités de transformation situées sur l’axe Korhogo-Sinématiali-par la création de chaînes de valorisation du coton, du riz, du sucre, du bétail, des maraîchers,Ferkessédougou,encadrés par des Sociétés d’Etat : CIDT, Soderiz, Sodesucre, Sodepra, Sodefel. … la lourdeur des subventions etle retournement de la conjoncture mirent rapidement un terme aux <strong>projet</strong>s de conserverie, d’huilerie, depapeterie, etc., dont la <strong>final</strong>ité était la transformation industrielle des produits locaux. »85