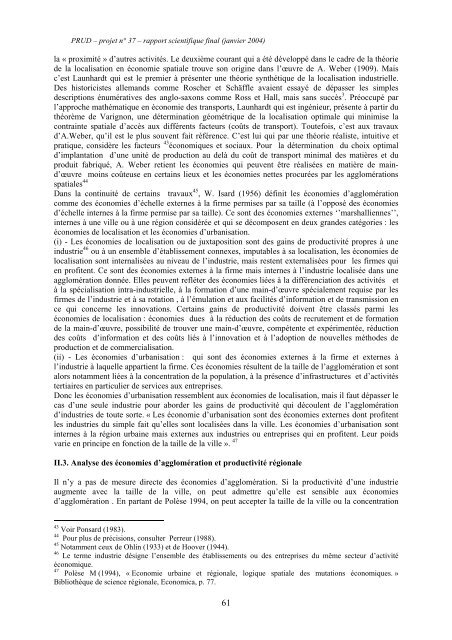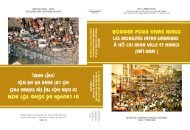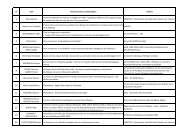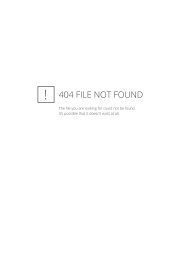PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
PRUD â projet n° 37 â rapport scientifique final (janvier ... - gemdev
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>PRUD</strong> – <strong>projet</strong> n° <strong>37</strong> – <strong>rapport</strong> <strong>scientifique</strong> <strong>final</strong> (<strong>janvier</strong> 2004)la « proximité » d’autres activités. Le deuxième courant qui a été développé dans le cadre de la théoriede la localisation en économie spatiale trouve son origine dans l’œuvre de A. Weber (1909). Maisc’est Launhardt qui est le premier à présenter une théorie synthétique de la localisation industrielle.Des historicistes allemands comme Roscher et Schäffle avaient essayé de dépasser les simplesdescriptions énumératives des anglo-saxons comme Ross et Hall, mais sans succès 3 . Préoccupé parl’approche mathématique en économie des transports, Launhardt qui est ingénieur, présente à partir duthéorème de Varignon, une détermination géométrique de la localisation optimale qui minimise lacontrainte spatiale d’accès aux différents facteurs (coûts de transport). Toutefois, c’est aux travauxd’A.Weber, qu’il est le plus souvent fait référence. C’est lui qui par une théorie réaliste, intuitive etpratique, considère les facteurs 43 économiques et sociaux. Pour la détermination du choix optimald’implantation d’une unité de production au delà du coût de transport minimal des matières et duproduit fabriqué, A. Weber retient les économies qui peuvent être réalisées en matière de maind’œuvremoins coûteuse en certains lieux et les économies nettes procurées par les agglomérationsspatiales 44Dans la continuité de certains travaux 45 , W. Isard (1956) définit les économies d’agglomérationcomme des économies d’échelle externes à la firme permises par sa taille (à l’opposé des économiesd’échelle internes à la firme permise par sa taille). Ce sont des économies externes ‘’marshalliennes’’,internes à une ville ou à une région considérée et qui se décomposent en deux grandes catégories : leséconomies de localisation et les économies d’urbanisation.(i) - Les économies de localisation ou de juxtaposition sont des gains de productivité propres à uneindustrie 46 ou à un ensemble d’établissement connexes, imputables à sa localisation, les économies delocalisation sont internalisées au niveau de l’industrie, mais restent externalisées pour les firmes quien profitent. Ce sont des économies externes à la firme mais internes à l’industrie localisée dans uneagglomération donnée. Elles peuvent refléter des économies liées à la différenciation des activités età la spécialisation intra-industrielle, à la formation d’une main-d’œuvre spécialement requise par lesfirmes de l’industrie et à sa rotation , à l’émulation et aux facilités d’information et de transmission ence qui concerne les innovations. Certains gains de productivité doivent être classés parmi leséconomies de localisation : économies dues à la réduction des coûts de recrutement et de formationde la main-d’œuvre, possibilité de trouver une main-d’œuvre, compétente et expérimentée, réductiondes coûts d’information et des coûts liés à l’innovation et à l’adoption de nouvelles méthodes deproduction et de commercialisation.(ii) - Les économies d’urbanisation : qui sont des économies externes à la firme et externes àl’industrie à laquelle appartient la firme. Ces économies résultent de la taille de l’agglomération et sontalors notamment liées à la concentration de la population, à la présence d’infrastructures et d’activitéstertiaires en particulier de services aux entreprises.Donc les économies d’urbanisation ressemblent aux économies de localisation, mais il faut dépasser lecas d’une seule industrie pour aborder les gains de productivité qui découlent de l’agglomérationd’industries de toute sorte. « Les économie d’urbanisation sont des économies externes dont profitentles industries du simple fait qu’elles sont localisées dans la ville. Les économies d’urbanisation sontinternes à la région urbaine mais externes aux industries ou entreprises qui en profitent. Leur poidsvarie en principe en fonction de la taille de la ville ». 47II.3. Analyse des économies d’agglomération et productivité régionaleIl n’y a pas de mesure directe des économies d’agglomération. Si la productivité d’une industrieaugmente avec la taille de la ville, on peut admettre qu’elle est sensible aux économiesd’agglomération . En partant de Polèse 1994, on peut accepter la taille de la ville ou la concentration43 Voir Ponsard (1983).44 Pour plus de précisions, consulter Perreur (1988).45 Notamment ceux de Ohlin (1933) et de Hoover (1944).46 Le terme industrie désigne l’ensemble des établissements ou des entreprises du même secteur d’activitééconomique.47Polèse M (1994), « Economie urbaine et régionale, logique spatiale des mutations économiques. »Bibliothèque de science régionale, Economica, p. 77.61