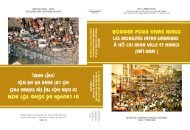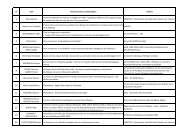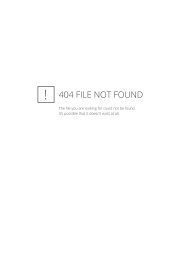<strong>PRUD</strong> – <strong>projet</strong> n° <strong>37</strong> – <strong>rapport</strong> <strong>scientifique</strong> <strong>final</strong> (<strong>janvier</strong> 2004)nationale, alors qu’elle ne renfermait que 39% des pauvres en 1985. Une telle situation est engrande partie imputable à la ville d’Abidjan – qui reste le plus grand centre industriel etcommercial du pays - où la pauvreté a atteint des proportions inquiétantes (cf. supra). Notonségalement un effritement de la production alimentaire destinée à l’autoconsommation dansl’espace périurbain de cette région (Tableau A5). A contrario, toutes les autres régions qui secaractérisent à la fois par un accroissement de la population des 10-29 ans, un chômage accrudans cette tranche d’âge et une réduction de leur participation au marché du travail, ont connuune baisse significative de la pauvreté. En particulier, le Moyen-Comoé – pourtant la moinsbien dotée de toutes - se distingue par une réduction de son niveau de pauvreté de près de 30points de pourcentage sur la période, ce qui la place au rang des régions ayant observé un trèsnet recul du phénomène - Agnéby, Moyen-Comoé, Zanzan, Worodougou et Sud-Bandama.Notons également que ces régions sont essentiellement industrielles – à l’exception de larégion des Lacs (voir carte n°1).En somme, il semblerait que la structuration spatiale exerce une certaine influence surle niveau de vie des populations, à travers leur exposition aux aléas de la migration. Bien queles instruments considérés ici – pour l’essentiel descriptif – ne soient pas d’une extrêmeprécision, ils permettent néanmoins d’en saisir quelques enseignements. En particulier, laforte progression de la pauvreté en région des Lagunes résulterait de la saturation de la villed’Abidjan consécutive à une percée notable de l’immigration inter et intra-régionale. Quelleportée une telle assertion revêt-elle ?Tableau 5 : Dynamique régionale de la pauvreté 1 en Côte d’Ivoire, 1985-19951985 1995Incidence Profondeur Intensité Incidence Profondeur IntensitéValeur Cont- 2 Valeur Cont- 2 Valeur Cont- 2 Valeur Cont- 2 Valeur Cont- 2 Valeur Cont- 2REGIONSLagunes 8,6 39,0 1,9 29,4 0,7 23,5 16,7 68,2 4,3 67,6 1,8 69,7Sud-Comoé 21,7 12,2 6,8 14,7 3,7 18,7 10,0 1,9 1,9 1,4 0,4 0,7Agnéby 46,0 10,9 14,6 12,9 6,4 13,2 10,0 1,6 1,6 1,0 0,3 0,4Haut-Sassandra 28,5 8,0 8,4 8,0 3,5 7,5 27,5 7,7 8,1 8,4 2,9 7,5Savanes 48,7 10,6 19,7 14,0 9,9 15,6 43,3 6,3 15,7 8,5 7,4 9,9Vallée du Bandama 31,6 5,3 11,1 6,0 5,3 6,3 24,0 4,4 4,8 3,3 1,4 2,5Moyen-Comoé 45,0 2,5 14,0 2,4 5,3 2,0 16,7 0,7 2,2 0,3 0,4 0,118 Montagnes 26,6 2,7 7,3 2,4 3,2 2,3 <strong>37</strong>,5 3,4 11,3 3,8 4,3 3,7Lacs 51,4 0,9 14,8 0,8 6,5 0,8 35,0 1,3 7,8 1,1 2,3 0,8Zanzan 73,8 2,2 30,5 2,9 15,7 3,2 28,0 1,1 8,7 1,3 3,6 1,3Bas-Sassandra 41,0 0,5 11,4 0,4 3,9 0,3 24,0 0,8 6,7 0,8 2,7 0,8N’zi-Comoé 71,0 2,1 33,8 3,0 19,6 3,7 66,7 1,2 19,9 1,3 8,5 1,4Marahoué 41,3 1,4 12,0 1,3 4,6 1,0 25,0 0,5 5,3 0,4 1,8 0,3Worodougou 61,0 0,9 26,5 1,2 14,5 1,4 25,0 0,2 9,8 0,3 5,6 0,5Denguélé - - - - - - 40,0 0,3 10,9 0,3 4,8 0,4Sud-Bandama 43,9 0,8 12,5 0,6 4,9 0,5 18,0 0,4 2,5 0,2 0,5 0,1Ensemble 34,2 100,0 11,9 100,0 5,7 100,0 25,4 100,0 6,8 100,0 2,7 100,0(1) Toutes les mesures FGT ont été multipliées par 100 ; (2) Il s’agit des contributions relatives ; (3) Le seuil de pauvreté pour 1985 est deZ 85 =126800 F.CFA par an, et celui de 1995 est Z 95 =144800 F.CFA par an.Source : A partir de l’EPAM 1985 et l’ENVM 1995 – Pondération normalisée.5. Spécificités régionales et bien-être des ménagesSelon Kuznets (1968), le développement économique se traduit, pour un pays – etcertainement à une échelle plus réduite, pour une région -, par la hausse soutenue – c’est-à-dire uneévolution de long terme ne se réduisant pas à des mouvements conjoncturels – et irréversible – c’est-àdires’appuyant sur des changements profonds de structure et de société qui, une fois accomplis, nepeuvent plus se défaire – de son revenu réel par habitant. Dans ce contexte, l’urbanisation – définie96
<strong>PRUD</strong> – <strong>projet</strong> n° <strong>37</strong> – <strong>rapport</strong> <strong>scientifique</strong> <strong>final</strong> (<strong>janvier</strong> 2004)comme une transformation sociale (Polèse et al., 1995) - et le développement économique seraientinséparables. Bien que ce lien entre développement économique et urbanisation fasse l’objet d’unelongue tradition de recherche (Breese, 1966), Polanyi (1944) évoquant même la « fatal irreversibilityof urbanization » quant à la faculté du développement économique à induire l’urbanisation, peut-onconsidérer la ville comme une condition suffisante de l’amélioration du niveau de vie despopulations 70 ? Les migrations de populations en vue d’une localisation optimale accroissant leursopportunités d’emplois et de revenus, et réduisant les coûts de localisation ont-elles un sens ? Si oui,jusqu’à quel niveau : à quel moment, à quelle taille (de ville) les économies externes sont-ellesrattrapées par les deséconomies externes ?Notre propos est de dire que les structurations régionales sont susceptibles d’avoir des impactsdifférenciés sur le niveau de vie des populations, la fatalité de l’urbanisation ne signifiant pas pourautant qu’elle se manifeste partout de la même manière. En effet, comme nous le rappellent Polèse etWolfe (1995), l’urbanisation est susceptible d’impliquer un « coût social » important, dont les couchesles plus démunies sont parfois les premières victimes. En fait, si les effets d’agglomérationsconstituent le plus souvent des externalités positives – et tendent à améliorer le bien-être des individus-, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent également être à la base d’une détérioration de leur niveaude vie. Ces effets de congestion pourraient être la source de l’urbanisation de la pauvreté en Côted’Ivoire. Comment ces externalités positives et négatives s’expriment-elles au niveau des régionsivoiriennes ? Les particularismes régionaux exercent-ils une quelconque incidence sur le niveau de viedes ménages ivoiriens ?Pour saisir cet impact régional différencié sur le bien-être des individus, la présente sections’appuie sur un examen des déterminants du niveau de vie de l’ensemble des ménages, d’une part, etdes ménages distingués selon leur niveau de vie, d’autre part. L’analyse a recours à une régressionlinéaire simple (MCO) et le logarithme des dépenses réelles par tête mesure le bien-être des ménages.Cette variable dépendante est soumise à deux groupes de variables explicatives : les caractéristiquesdes ménages, comme l’âge du chef, son sexe, son statut socioprofessionnel 71 ou encore la taille duménage ; les spécificités régionales telles que le taux d’urbanisation – l’analyse a recours à deux typesde mesures en ce qui concerne cette variable : (i) un taux d’urbanisation en valeur, tableau 6 et ; (ii)une variable dichotomique marquant la scission entre les régions ayant un taux d’urbanisation de plusde 60%, compte tenu du taux d’urbanisation ivoirien qui est de 53% ; ceci afin de saisir un éventueleffet seuil d’urbanisation qui agirait négativement sur le niveau de vie des ménages -, le niveau dedéveloppement de ses infrastructures économiques et sociales, la valeur ajoutée régionale par tête, laspécialisation agricole, industrielle ou tertiaire 72 .70 Rappelons à ce propos que Jacobs (1985), à l’instar d’une abondante littérature, insiste sur le fait que la villeconstitue une condition nécessaire du développement économique – et donc d’amélioration du bien-être despopulations.71 Considérant que les modes d’emplois vulnérables entretiennent des liens étroits avec des situations de pauvreté(Lachaud, 1996), la présente investigation transcende la dichotomie formelle – informelle pour appréhender lavulnérabilité des individus à la pauvreté, inhérentes aux caractéristiques des activités exercées. A cet égard, ilimporte de rappeler que la vulnérabilité du travail – et donc celle des individus – se caractérise par la précarité dutravail qui renvoie selon Rodgers et Rodgers (1991) à plusieurs facteurs : la continuité du travail, le contrôle dutravail, la protection des travailleurs, et le revenu. Une analyse en classification hiérarchique, basée sur unalgorithme inhérent au critère centroïde a permis de rassembler les travailleurs en groupes (clusters)suffisamment homogènes, de manière à ce que le degré d’association statistique soit élevé parmi les élémentsd’un même groupe. Pour de plus amples informations sur cette approche analytique, on pourra se reporter avecprofit à Rodgers (1986), Lachaud (1995) et Koné (2002a).72 L’évaluation de l’impact des variables régionales sur le niveau de vie des ménages ivoiriens n’est pasnouvelle. Par exemple, Kingsbury (1999) examine la question pour le Zanzan et suggère que certaines variablesprésentent une forte corrélation avec le niveau de vie des ménages telles que le temps d’isolement des villagespendant la saison des pluies, la distance séparant les ménages des bureaux de postes, le taux de scolarisation desfilles et la proportion des naissances à l’hôpital. S’agissant de la présente analyse, nous entendons dépasser leseul cadre du Zanzan pour appréhender, non seulement, l’ensemble du pays, mais également l’impact des effetsd’urbanisation. Les variables relatives aux spécificités régionales sont pour l’essentiel fournies par Sanogo(2001). Ainsi, la valeur ajoutée régionale est agrégée à partir des données issues de la Banque des données97
- Page 1:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 4:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 8 and 9:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 10 and 11:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 12 and 13:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 14 and 15:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 16 and 17:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 18 and 19:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 20 and 21:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 22 and 23:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 24 and 25:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 26 and 27:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 28 and 29:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 30 and 31:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 32 and 33:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 34 and 35:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 36 and 37:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 38 and 39:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 40 and 41:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 42 and 43:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 44 and 45:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 46 and 47:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 48 and 49: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 50 and 51: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 52 and 53: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 54 and 55: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 56 and 57: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 58 and 59: 12PRUD - projet n° 37 - rapport sc
- Page 60 and 61: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 62 and 63: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 64 and 65: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 66 and 67: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 68 and 69: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 70 and 71: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 72 and 73: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 74 and 75: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 76 and 77: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 78 and 79: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 80 and 81: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 82 and 83: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 84 and 85: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 86 and 87: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 88 and 89: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 90 and 91: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 92 and 93: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 94 and 95: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 96 and 97: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 100 and 101: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 102 and 103: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 104 and 105: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 106 and 107: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 108 and 109: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 110 and 111: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 112 and 113: Chapitre IILA CENTRALITE(RESEAU URB
- Page 114 and 115: LE RESEAU URBAIN DU MALIGuy Pourcet
- Page 116 and 117: - Distinguer l'influence des facteu
- Page 118 and 119: §1- L'existence d'un lien entre le
- Page 120 and 121: Graphe N° 1 : Ecarts entre les eff
- Page 122 and 123: Graphe N° 3 : Indicateurs de spéc
- Page 124 and 125: dans les 50 cercles puis dans les 1
- Page 126 and 127: Le calcul des écarts et du Khi² c
- Page 128 and 129: I- EVALUATION DES CAPACITES D'EXPOR
- Page 130 and 131: Le graphe N° 10, qui représente l
- Page 132 and 133: Appariement des flux d'échanges in
- Page 134 and 135: transport interurbains. Ce travail
- Page 136 and 137: (δu , δr) dBS >= CE= C° + CT(EA)
- Page 138 and 139: Annexe N° 1EVALUATION DES PRODUCTI
- Page 140 and 141: Cadre de cohérenceT blσ bl = σ b
- Page 142 and 143: locales du centre l. Cela permet de
- Page 144 and 145: 143
- Page 146 and 147: ECHANGES TRANSFRONTALIERS ENTRE LA
- Page 148 and 149:
Situées aux frontières, les princ
- Page 150 and 151:
1.3 Données ethniques et fragmenta
- Page 152 and 153:
espaces d’échanges, des espaces
- Page 154 and 155:
d’opportunité qu’offre ces der
- Page 156 and 157:
sont non seulement les commerçants
- Page 158 and 159:
Tableaux 3: Volume des produits agr
- Page 160 and 161:
loi du marché, des distances et de
- Page 162 and 163:
Prix des produits manufacturés de
- Page 164 and 165:
La zone frontalière est objet d’
- Page 166 and 167:
échapper aux contrôles des forces
- Page 168 and 169:
Faso. Ces deux voies importantes lu
- Page 170 and 171:
les populations communes de la Côt
- Page 172 and 173:
LE SYSTEME DES PLACES DE MARCHE DAN
- Page 174 and 175:
* en produits de cueillette, de cha
- Page 176 and 177:
trans-frontaliers et l’orpaillage
- Page 178 and 179:
Ces 43 marchés hebdomadaires sont
- Page 180 and 181:
D. Les fonctionsLes marchés de la
- Page 182 and 183:
concertées destinées à améliore
- Page 184 and 185:
Ces dispositions s’articuleront a
- Page 186 and 187:
détail pour faire des bénéfices.
- Page 188 and 189:
- de la gestion de façon durable d
- Page 190 and 191:
ANNEXE 2- RESULTAT DES ENQUETESProf
- Page 192 and 193:
LE SYSTEME DES PLACES DE MARCHE DE
- Page 194 and 195:
déplacent en utilisant les sotrama
- Page 196 and 197:
la mairie du District, la BHM et la
- Page 198 and 199:
l’Etat a reconstruit 412 places d
- Page 200 and 201:
2. L’analyse des facteurs de loca
- Page 202 and 203:
Les épouses qui exercent une activ
- Page 204 and 205:
Les questions de l’enquête ont p
- Page 206 and 207:
ConclusionAu terme de cette étude,
- Page 208 and 209:
Chapitre IIILA GOUVERNANCE(Gestion
- Page 210 and 211:
LE FINANCEMENT DU SERVICE DES DECHE
- Page 212 and 213:
2001 : 551 milliersd’eurosAccra M
- Page 214 and 215:
1 - Ouagadougou et Bobo-DioulassoAN
- Page 216 and 217:
mondiale (Accra a été réintégr
- Page 218 and 219:
Rétrospectivement, la mise en plac
- Page 220 and 221:
LA GESTION DES ORDURES MENAGERES A
- Page 222 and 223:
1-1- L’organisation du secteur de
- Page 224 and 225:
Selon Adam Smith, les services coll
- Page 226 and 227:
financé par les propriétaires de
- Page 228 and 229:
Tout d’abord, il est vrai et dit
- Page 230 and 231:
fontaines etc. Sur les 420 employé
- Page 232 and 233:
la communauté qui désire réalise
- Page 234 and 235:
Voisinage 33 22,6Compétences techn
- Page 236 and 237:
ecruter d'autres afin d'assurer le
- Page 238 and 239:
En plus, comme il n’existe aucun
- Page 240 and 241:
s’annonce très difficile tant qu
- Page 242 and 243:
DECENTRALISATION ET ACCES AUX RESSO
- Page 244 and 245:
- la taxe sur les carrières et l
- Page 246 and 247:
Tableau n° 2 : Evolution des impô
- Page 248 and 249:
Désignation Prévisions Réalisati
- Page 250 and 251:
Yirimadio.7.009 habitantsSource : R
- Page 252 and 253:
Les activités professionnelles rep
- Page 254 and 255:
PrévisionsF CFARéalisationF CFATa
- Page 256 and 257:
Au niveau du District, les difficul
- Page 258 and 259:
Source : Compte administratif de la