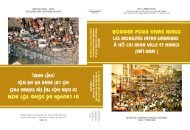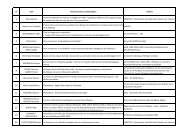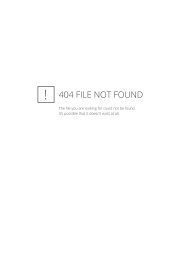<strong>PRUD</strong> – <strong>projet</strong> n° <strong>37</strong> – <strong>rapport</strong> <strong>scientifique</strong> <strong>final</strong> (<strong>janvier</strong> 2004)persistants de la crise tendent à montrer le poids écrasant de la récession et de la faible croissance 68 . Eneffet, sous l’action conjuguée d’une baisse des performances macro-économiques et d’une croissancedémographique entretenue (environ 3% par an) durant la décennie 1980, la Côte d’Ivoire a vu sonPNB par tête chuter en moyenne de 4% par an, de sorte qu’en 1991, le revenu per capita ne valait plusque 60% de son niveau de 1980. Et ce, en dépit du fait qu’entre 1981 et 1993, le pays ait bénéficié deneuf prêts d’ajustement, dont six sectoriels, tous appuyés par la Banque mondiale. Les politiques destabilisation du FMI et les PAS de la Banque mondiale, sans parvenir à enrayer la crise financière etéconomique du pays, ont eu, par ailleurs, des coûts sociaux particulièrement pénibles pour lespopulations pauvres. En outre, la dévaluation du F.CFA, intervenue en <strong>janvier</strong> 1994, a prolongé lespolitiques macro-économiques menées durant les années antérieures. Et, si elle n’a pasfondamentalement modifié la nature du débat soulevé par les conséquences sociales de l’ajustement,elle a posé et, de façon beaucoup plus pressante, la question de l’urbanisation de la pauvreté en Côted’Ivoire.En fait, l’évolution de la pauvreté en Côte d’Ivoire est intimement liée aux fluctuations de lacroissance économique, comme nous le rappelle Nshimyumuremyi (1998). Cependant, au-delà de laseule association croissance-pauvreté, il est important de souligner les difficultés qu’éprouventcertains individus à s’émanciper de la tutelle de l’Etat, et à faire face aux chocs intérieurs et extérieurs.A ce sujet, Sanogo (2001) pense que la convergence observée en matière de pauvreté en Côte d’Ivoirese fait par le bas et au détriment des régions anciennement favorisées par la politique volontariste del’Etat. De sorte que si l’on observe une amélioration de la situation de certains groupes socioéconomiques,cette dernière se fait sur la base de la création de nouveaux antagonismes sociauxconsacrant de nouveaux pauvres. Dans ce contexte, il semblerait que les effets de congestion aientcontribué à la paupérisation progressive des villes.4. Dynamiques socio-démographiques et structuration de l’espaceLa crise et le désengagement de l’Etat ont induit des stratégies locales, au nombre desquellesles migrations des populations vers les régions les plus productives ou tout simplement à même de leuroffrir du travail. Par exemple, nombreux sont les jeunes gens qui ont dû quitter le département deKorhogo vers les centres miniers de Dianra ou de Tortiya. Plusieurs éléments permettent decomprendre ces déplacements ainsi que leurs conséquences : les taux de chômage, les taux departicipation aux activités économiques, les spécialisations régionales, les performances desentreprises, etc. Comment ces mouvements de populations se caractérisent-ils au niveau national ? Laprésente analyse tente d’appréh ender le phéno mène à travers l’examen des données des enquêtesménages réalisées en 1985 et 1995 – les analyses s’ a ppuient également sur les résulta ts fournis parSanogo (2001) pour c e qui relève des performance s régionales. Bien évidemment, cette approchecomporte certaine s limites dont la plu s marquante demeu re le décalage en tre une t elle entrepr ise – àl’échelle des régions - e t les objec tifs – do nc le p lan de stratifica tion – desdites enquêt es. Néanmoins,elles restent d’un préci eux recours pour appréhender à la fo is l’ évolution du niveau de vie etlastructuration spatiale e n Côt e d’Ivoire.68 A ce propos, Grootaert (1996) – à partir d’un panel de données d’enquêtes sur le niveau de vie réalisées auprèsdes ménages ivoiriens entre 1985 et 1988 - estime, en effet, que si la croissance économique n’avait pas éténégative, la pauvreté, en raison de la réduction des inégalités, aurait baissé de 20% et l’extrême pauvreté de 40%.Plus précisément, la montée de la pauvreté en Côte d’Ivoire nous ramène à la question du lien entre pauvreté,inégalités et croissance – voir Koné (2002, p.59) pour un rappel théorique à ce sujet. En effet, une autreappréciation des résultats de Grootaert est que si la croissance négative a eu tendance à augmenter la pauvreté,les variations de la distribution des revenus en revanche, en réduisant les inégalités, ont plutôt eu pour effet de laréduire. A cet égard, Lachaud (1996a) souligne, dans le cadre d’une étude sur certaines capitales africaines –Abidjan, Bamako, Conakry, Ouagadougou, et Yaoundé - la pertinence d’une telle causalité pour l’appréhensionde la dynamique de la pauvreté en Côte d’Ivoire. Il montrait en substance que, l’accroissement du revenu moyende 1% à Abidjan induisait une réduction du ratio de pauvreté de 0,85%, toutes choses égales par ailleurs. End’autres termes, la montée de la pauvreté résultait plus d’une baisse des performances nationales – etcertainement régionales - que d’une mauvaise répartition des revenus, même si cette dernière ne peut êtreignorée comme l’un des fondements de la pauvreté du plus grand nombre d’individus.94
<strong>PRUD</strong> – <strong>projet</strong> n° <strong>37</strong> – <strong>rapport</strong> <strong>scientifique</strong> <strong>final</strong> (<strong>janvier</strong> 2004)Bien que les disparités régionales de revenus soient susceptibles de correspondre auxdisparités de dotations en infrastructures, il importe d’être particulièrement vigilant. En effet, à unniveau élevé d’infrastructures peuvent être associées une fréquentation et une utilisationparticulièrement élevées de ces dernières. Dès lors, il devient difficile de hiérarchiser les régions entenant uniquement compte de la description des infrastructures. Ainsi, lorsque nous nous intéressons,par exemple, à la densité du réseau routier – définie par le nombre de kilomètres de route au km² -, onobserve que les régions les mieux dotées sont dans l’ordre l’Agnéby, les Lagunes, le Moyen-Comoé,et la région des Lacs, loin devant le Bas-Sassandra, le Denguélé, le Worodougou ou la Marahoué. Parcontre, lorsque nous envisageons la charge démographique – mesurée par le nombre d’habitants parcentre de santé -, on remarque que les centres les plus chargés sont ceux des Lagunes, du Bas-Sassandra, du Haut-Sassandra, de la Marahoué et ceux du Sud-Bandama, alors que les régions desLacs, du Sud-Comoé, du Zanzan, des Savanes et du Denguélé se caractérisent par une fréquentationdémographique relativement faible. Cependant, il est certainement plus correct de nuancer les propos,car cette charge démographique peut traduire, à bien des égards, un dépeuplement progressif desdernières régions vers les régions les plus dynamiques – offrant des opportunités d’emploi supérieureset de revenus. Le Tableau A1, indiquant les niveaux d’infrastructures économiques et sociales parrégions en 1995, nous en apprend davantage sur les ambiguïtés potentiellement associées auxinteractions entre les caractéristiques régionales et le niveau de vie des populations. Dans ce contexte,les critères démographiques et socio-économiques sont susceptibles d’offrir beaucoup plusd’indications quant à la dynamique et à la structuration des région s. Il en va par exemple ainsi del’évolution des taux d’activités (Tableau A3), du chô mage (Tableau A4) ou de la structu re de lapopulation par sexe et par âge (Tableau A2).Le chômage est appréhendé dans sa plus simple expression, c’est-à-dire le chômagedéclaré ne tenant nullement compte des situations limites entre emploi et inactivité, liéesnotamment à l’existence d’activités marginales. Ainsi, ne sont considérés comme chômeursque les individus en âge de travailler n’ayant pas travaillé au cours des sept derniers jours etayant déclaré être à la recherche d’un emploi sur la période consid érée. Le taux de chômagedéfinit alors le <strong>rapport</strong> entre le nombre de chômeurs et la population active, cette dernièreétant l’ensemble des individus âgés de 10 ans et plus qui sont, soit employés, soit sous-upés ou encore au chômage. Le tableau A4 fait apparaître que, globalement, bien qu’iloccreste assez faible, le chômage se serait accru en Côte d’Ivoire entre 1985 et 1995 : il est passéde 2,3% à 5% sur la période. Le phénomène demeure, néanmoins, essentiellement urbain ettouche tant les femmes que les hommes, avec cependant une acuité notable pour les premières– le chômage a en effet plus que doublé pour elles. Il s’agit principalement d’un chômage dejeunes affectant particulièrement les régions des Lacs, des Lagunes, du Moyen-Comoé et lavallée du Bandama. Cette situation est d’autant plus inquiétante que l’on observe une certainecontraction de la capacité de ces régions à absorber la main-d’œuvre jeune. En effet, danschacune des régions où le chômage des 10-29 ans s’est accru, les taux d’offre de travail 69 ontfortement chuté, singulièrement dans les espaces urbains qui se caractérisent pourtant par unenette progression de la proportion des individus concernés (voir Tableaux A3, A2). Il est doncprobable que l’on observe dans ces régions une importante immigration intra-zone vers lescentres urbains les plus dynamiques. Et ce, d’autant plus que ces régions disposentd’infrastructures économiques et sociales élevées (voir carte n°2). A ce jeu migratoire, il estmanifeste que la région des Lagunes ait connu une certaine saturation, ce qui expliquerait enpartie pourquoi la pauvreté y ait doublé en dix ans - passant de 8,6% en 1985 à 16,7% en1995 ; de sorte qu’en 1995, cette seule région contribuait à près de 70% de la pauvreté69L’offre de travail est définie comme le montant de travail offert par une population de taille donnée. Parconséquent, n’offrent leur travail que les individus ayant une activité économique ou engagés dans un processusde recherche d’emploi. Ainsi, pour un groupe donné, le taux d’offre de travail est obtenu en <strong>rapport</strong>ant l’effectifdes actifs – employés, sous-employés et chômeurs – à celui de la population totale du groupe.95
- Page 1:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 4:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 8 and 9:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 10 and 11:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 12 and 13:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 14 and 15:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 16 and 17:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 18 and 19:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 20 and 21:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 22 and 23:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 24 and 25:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 26 and 27:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 28 and 29:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 30 and 31:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 32 and 33:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 34 and 35:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 36 and 37:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 38 and 39:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 40 and 41:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 42 and 43:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 44 and 45:
PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 46 and 47: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 48 and 49: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 50 and 51: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 52 and 53: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 54 and 55: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 56 and 57: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 58 and 59: 12PRUD - projet n° 37 - rapport sc
- Page 60 and 61: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 62 and 63: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 64 and 65: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 66 and 67: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 68 and 69: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 70 and 71: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 72 and 73: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 74 and 75: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 76 and 77: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 78 and 79: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 80 and 81: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 82 and 83: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 84 and 85: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 86 and 87: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 88 and 89: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 90 and 91: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 92 and 93: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 94 and 95: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 98 and 99: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 100 and 101: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 102 and 103: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 104 and 105: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 106 and 107: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 108 and 109: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 110 and 111: PRUD - projet n° 37 - rapport scie
- Page 112 and 113: Chapitre IILA CENTRALITE(RESEAU URB
- Page 114 and 115: LE RESEAU URBAIN DU MALIGuy Pourcet
- Page 116 and 117: - Distinguer l'influence des facteu
- Page 118 and 119: §1- L'existence d'un lien entre le
- Page 120 and 121: Graphe N° 1 : Ecarts entre les eff
- Page 122 and 123: Graphe N° 3 : Indicateurs de spéc
- Page 124 and 125: dans les 50 cercles puis dans les 1
- Page 126 and 127: Le calcul des écarts et du Khi² c
- Page 128 and 129: I- EVALUATION DES CAPACITES D'EXPOR
- Page 130 and 131: Le graphe N° 10, qui représente l
- Page 132 and 133: Appariement des flux d'échanges in
- Page 134 and 135: transport interurbains. Ce travail
- Page 136 and 137: (δu , δr) dBS >= CE= C° + CT(EA)
- Page 138 and 139: Annexe N° 1EVALUATION DES PRODUCTI
- Page 140 and 141: Cadre de cohérenceT blσ bl = σ b
- Page 142 and 143: locales du centre l. Cela permet de
- Page 144 and 145: 143
- Page 146 and 147:
ECHANGES TRANSFRONTALIERS ENTRE LA
- Page 148 and 149:
Situées aux frontières, les princ
- Page 150 and 151:
1.3 Données ethniques et fragmenta
- Page 152 and 153:
espaces d’échanges, des espaces
- Page 154 and 155:
d’opportunité qu’offre ces der
- Page 156 and 157:
sont non seulement les commerçants
- Page 158 and 159:
Tableaux 3: Volume des produits agr
- Page 160 and 161:
loi du marché, des distances et de
- Page 162 and 163:
Prix des produits manufacturés de
- Page 164 and 165:
La zone frontalière est objet d’
- Page 166 and 167:
échapper aux contrôles des forces
- Page 168 and 169:
Faso. Ces deux voies importantes lu
- Page 170 and 171:
les populations communes de la Côt
- Page 172 and 173:
LE SYSTEME DES PLACES DE MARCHE DAN
- Page 174 and 175:
* en produits de cueillette, de cha
- Page 176 and 177:
trans-frontaliers et l’orpaillage
- Page 178 and 179:
Ces 43 marchés hebdomadaires sont
- Page 180 and 181:
D. Les fonctionsLes marchés de la
- Page 182 and 183:
concertées destinées à améliore
- Page 184 and 185:
Ces dispositions s’articuleront a
- Page 186 and 187:
détail pour faire des bénéfices.
- Page 188 and 189:
- de la gestion de façon durable d
- Page 190 and 191:
ANNEXE 2- RESULTAT DES ENQUETESProf
- Page 192 and 193:
LE SYSTEME DES PLACES DE MARCHE DE
- Page 194 and 195:
déplacent en utilisant les sotrama
- Page 196 and 197:
la mairie du District, la BHM et la
- Page 198 and 199:
l’Etat a reconstruit 412 places d
- Page 200 and 201:
2. L’analyse des facteurs de loca
- Page 202 and 203:
Les épouses qui exercent une activ
- Page 204 and 205:
Les questions de l’enquête ont p
- Page 206 and 207:
ConclusionAu terme de cette étude,
- Page 208 and 209:
Chapitre IIILA GOUVERNANCE(Gestion
- Page 210 and 211:
LE FINANCEMENT DU SERVICE DES DECHE
- Page 212 and 213:
2001 : 551 milliersd’eurosAccra M
- Page 214 and 215:
1 - Ouagadougou et Bobo-DioulassoAN
- Page 216 and 217:
mondiale (Accra a été réintégr
- Page 218 and 219:
Rétrospectivement, la mise en plac
- Page 220 and 221:
LA GESTION DES ORDURES MENAGERES A
- Page 222 and 223:
1-1- L’organisation du secteur de
- Page 224 and 225:
Selon Adam Smith, les services coll
- Page 226 and 227:
financé par les propriétaires de
- Page 228 and 229:
Tout d’abord, il est vrai et dit
- Page 230 and 231:
fontaines etc. Sur les 420 employé
- Page 232 and 233:
la communauté qui désire réalise
- Page 234 and 235:
Voisinage 33 22,6Compétences techn
- Page 236 and 237:
ecruter d'autres afin d'assurer le
- Page 238 and 239:
En plus, comme il n’existe aucun
- Page 240 and 241:
s’annonce très difficile tant qu
- Page 242 and 243:
DECENTRALISATION ET ACCES AUX RESSO
- Page 244 and 245:
- la taxe sur les carrières et l
- Page 246 and 247:
Tableau n° 2 : Evolution des impô
- Page 248 and 249:
Désignation Prévisions Réalisati
- Page 250 and 251:
Yirimadio.7.009 habitantsSource : R
- Page 252 and 253:
Les activités professionnelles rep
- Page 254 and 255:
PrévisionsF CFARéalisationF CFATa
- Page 256 and 257:
Au niveau du District, les difficul
- Page 258 and 259:
Source : Compte administratif de la