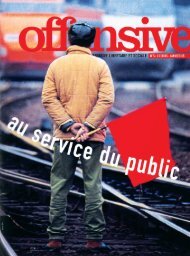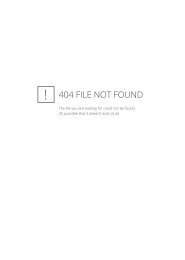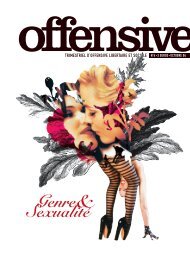Agone n° 18-19 - pdf (1090 Ko) - Atheles
Agone n° 18-19 - pdf (1090 Ko) - Atheles
Agone n° 18-19 - pdf (1090 Ko) - Atheles
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
44<br />
NEUTRALITÉ DU SAVOIR & AUTONOMIE DE SA PRODUCTION<br />
question. Exercer le métier de savant, c’est adhérer à un système de<br />
valeurs particulier dont la finalité est de produire, d’une manière<br />
particulière, un savoir d’un genre particulier – que l’on qualifie<br />
d’objectif en ce qu’il ne suit d’autre programme que celui,<br />
historiquement défini, d’une pratique de la raison par une<br />
communauté ayant réunit les conditions sociales d’un exercice<br />
indépendant. (Il serait fastidieux d’exposer ici, dans le détail, les<br />
principes épistémologiques d’un tel exercice dans lequel entrent, au<br />
moins, une certaine sanction par l’épreuve de la vérification<br />
expérimentale et la libre délibération de résultats que ne contrarient,<br />
par exemple, ni exigence de rentabilité ni mise au service partisane.)<br />
Rien là que de très classiquement wébérien. Mais une épistémologie<br />
wébérienne qui, privée de la référence si ambiguë à la neutralité,<br />
engage au moins les sciences à défendre ses valeurs constitutives, qui<br />
seules garantissent la validité de ses productions – que Bourdieu voit<br />
par définition subversives.<br />
Revenons, pour finir, aux conceptions de Weber, qui appelle une<br />
« action rationnelle » celle qui résulte, après information objective et<br />
libre réflexion, de la décision qui donne le plus de chance d’atteindre<br />
le but que l’on s’est donné : l’adéquation des moyens à une fin. Si<br />
Weber ne doutait donc pas que l’on puisse se comporter<br />
rationnellement, que l’on puisse agir rationnellement sur le monde, et<br />
ce grâce au savoir objectif que produit une science « axiologiquement<br />
neutre », il était, par contre, désespérément certain qu’il nous était<br />
impossible, une fois définie la « meilleure chance d’atteindre le but »,<br />
d’avoir la moindre certitude rationnelle que ce but soit le bon. C’est<br />
sur les derniers contreforts de la frontière entre la théorie et la<br />
pratique que butait Weber – divergence déjà évoquée entre Weber et<br />
Bourdieu, non pas épistémologique mais philosophique (pour aller<br />
vite). Bien que sans illusion, Weber tomba-t-il dans ce que Bourdieu<br />
appelle l’« illusion scolastique », qui compte sur la « seule force de la<br />
prédication rationnelle pour faire avancer la cause de la raison » ? et<br />
donc désespère de toute « construction d’un rationalisme élargi et<br />
réaliste du raisonnable […] capable de défendre les raisons<br />
spécifiques de la raison pratique » ?