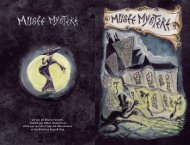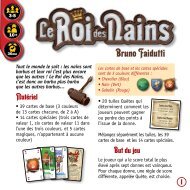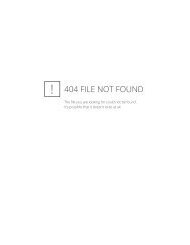- Page 1 and 2:
IMAGES ET CONNAISSANCE DE LA LICORN
- Page 3 and 4:
2.1 - ANDRE THEVET, COSMOGRAPHE, LE
- Page 5 and 6:
Les récits de voyage sont l’une
- Page 7 and 8:
Les textes La licorne, les unicorne
- Page 9 and 10:
La Cosmographie universelle d’And
- Page 11 and 12:
eussent eu la connaissance des chos
- Page 13 and 14:
êtes sauvages par un bout et l’a
- Page 15 and 16:
j’ai dit ailleurs, il y a autant
- Page 17 and 18:
vu la centième partie de ce qui es
- Page 19 and 20:
Singularités africaines Écrit par
- Page 21 and 22:
seulement sur les mots. C’est à
- Page 23 and 24:
directe, du moins une inspiration,
- Page 25 and 26:
audacieuse approximation, mais elle
- Page 27 and 28:
Le Camphurch des Paralipomènes de
- Page 29 and 30:
drogues du pharmacien parisien Pier
- Page 31 and 32:
Ambroise Paré, tout comme il l’a
- Page 33 and 34:
animaux unicornes, de l’invraisem
- Page 35 and 36:
comme un cheval, les pieds d’él
- Page 37 and 38:
Boethius avait sans doute vu des co
- Page 39 and 40:
heureusement contre la peste, contr
- Page 41 and 42:
2.2 - AMBROISE PARE, POURFENDEUR DE
- Page 43 and 44:
Le Discours de la Licorne d’Ambro
- Page 45 and 46:
venins, et il est clair que ces deu
- Page 47 and 48:
Pontife de Rome» (la fameuse lettr
- Page 49 and 50:
soupçonnait peut-être déjà, com
- Page 51 and 52:
Enfin, Paré attribue certains des
- Page 53 and 54:
met en butte à tous les autres ois
- Page 55 and 56:
déserts inaccessibles avec les lic
- Page 57 and 58:
La Réponse au discours de la licor
- Page 59 and 60:
grande envie de quereller. Car qui
- Page 61 and 62:
donner le nom de licorne 56 .» L
- Page 63 and 64:
Quand on a à faire l’histoire d
- Page 65 and 66:
savants, ont pris la défense du pr
- Page 67 and 68:
nous nous intéresserons, mais il i
- Page 69 and 70:
constitué dans les dernières ann
- Page 71 and 72:
Catelan se trompait quelque peu dan
- Page 73 and 74:
ebis en Amérique», a été utilis
- Page 75 and 76:
imaginaire et fabuleuse, et que les
- Page 77 and 78:
L’onagre ou âne des Indes, gravu
- Page 79 and 80:
l’onagre ou âne sylvestre et le
- Page 81 and 82:
des deux autres auteurs cités en m
- Page 83 and 84:
faveur de l’existence réelle de
- Page 85 and 86:
approche bien plus du sauvage monoc
- Page 87 and 88:
géographiques de Catelan laissent
- Page 89 and 90:
différentes. La première, d’un
- Page 91 and 92:
lanche trempât sa corne dans l’e
- Page 93 and 94:
La corne de monsieur Catelan Toutes
- Page 95 and 96:
Néanmoins, Catelan laisse entendre
- Page 97 and 98:
Galien rapporte aux vieux métaux l
- Page 99 and 100:
Il y a alchimiste et alchimiste Rev
- Page 101 and 102:
ien dans des eaux cordiales, in aqu
- Page 103 and 104:
fréquemment ces autres panacées q
- Page 105 and 106:
vertu n’a point été connue des
- Page 107 and 108:
les animaux crever étant approché
- Page 109 and 110:
peu sympathique, bien éloignée de
- Page 111 and 112:
propriétés 121 ». C’était aus
- Page 113 and 114:
plus précieuse et plus importante,
- Page 115 and 116:
Lorsque Laurent Catelan écrivit so
- Page 117 and 118:
11 La licorne solitaire ne peut pas
- Page 119 and 120:
licorne en décoction ne succombe p
- Page 121 and 122:
3.1 - LA LICORNE EXISTE-T-ELLE ? Na
- Page 123 and 124:
Utrum sit unicornu 1 «Dans tous le
- Page 125 and 126:
Ceux qui croyaient à la licorne, c
- Page 127 and 128:
Bien sûr, nous n’avons considér
- Page 129 and 130:
OUI ou plutôt oui. Beschreibung de
- Page 131 and 132:
OUI ou plutôt oui. -131- non, mais
- Page 133 and 134:
Jules Camus, note sous l’Histoire
- Page 135 and 136:
Dictionnaire de P. Bescherelle, 188
- Page 137 and 138:
Le Départ de la chasse. Tapisserie
- Page 139 and 140:
Cette scène paradisiaque, illustra
- Page 141 and 142:
la noble silhouette du cheval, elle
- Page 143 and 144:
La Création n’était désormais
- Page 145 and 146:
d’explication scientifique de l
- Page 147 and 148:
La Description de tous les quadrup
- Page 149 and 150:
griffon resurgit parfois, assimilé
- Page 151 and 152:
ne l’aient point fait défiler da
- Page 153 and 154:
dégage néanmoins de cette littér
- Page 155 and 156:
A gauche, La Création des animaux,
- Page 157 and 158:
Au XVIIème siècle, la licorne fig
- Page 159 and 160: Au XVIIème siècle, malgré la br
- Page 161 and 162: En 1732, le naturaliste suisse Joha
- Page 163 and 164: d’André Thevet que l’on voit a
- Page 165 and 166: des auteurs du XVIIème siècle, re
- Page 167 and 168: Frontispice de l’édition de 1678
- Page 169 and 170: éformer l’économie française 7
- Page 171 and 172: laquelle on le peint le plus commun
- Page 173 and 174: éléments 88 . Et s’il se trouve
- Page 175 and 176: unicornes, il se contente d’affir
- Page 177 and 178: araignée, jamais l’une ni l’au
- Page 179 and 180: n’avoir point de témoignage qu
- Page 181 and 182: vertu, déjà grande, lorsqu’elle
- Page 183 and 184: là, particulièrement à la peste,
- Page 185 and 186: point parvenus à la capturer. Fina
- Page 187 and 188: A gauche: Le Monocéros de la carte
- Page 189 and 190: Carte de la côte occidentale du Gr
- Page 191 and 192: Narval 132 . S’il y affirme, avec
- Page 193 and 194: apparence, a incité princes et roi
- Page 195 and 196: gravure représentant deux défense
- Page 197 and 198: expliqué, citant Ole Worm, que sa
- Page 199 and 200: Ovide, aux livres X et XI des Méta
- Page 201 and 202: Dans un jeu de tarots imprimé à P
- Page 203 and 204: Bermudez, rapporte déjà, dans sa
- Page 205 and 206: 3.2 - LA LICORNE ET LE RHINOCEROS L
- Page 207 and 208: De nombreuses hypothèses ont été
- Page 209: On connaît le monocéros de Pline,
- Page 213 and 214: qui «n’ont qu’une corne et don
- Page 215 and 216: simplement oublié le rhinocéros e
- Page 217 and 218: aison il est appelé en grec rhinoc
- Page 219 and 220: Pompée 21 , et la classique légen
- Page 221 and 222: avisés 27 notèrent que l’animal
- Page 223 and 224: Chargement à Goa du rhinocéros en
- Page 225 and 226: En haut: Le rhinocéros d’Albrech
- Page 227 and 228: Le combat du rhinocéros et de l’
- Page 229 and 230: «tous ceux qui sont allés dans le
- Page 231 and 232: Bengala s’en servent contre les p
- Page 233 and 234: Cardan et Scaliger Il y eut certes
- Page 235 and 236: Gravures d’Antonio Tempesta extra
- Page 237 and 238: l’histoire ont estimé que deux d
- Page 239 and 240: semble ressortir qu’il tenait, lu
- Page 241 and 242: ces animaux, et d’autres qui vena
- Page 243 and 244: Licorne terrestre, dixième planche
- Page 245 and 246: de la licorne. Il convient donc d
- Page 247 and 248: traduit 84 , et les notes quand il
- Page 249 and 250: égales 91 .» La description qui s
- Page 251 and 252: 3.3 - LA BETE PRODIGUE Bien que des
- Page 253 and 254: Derniers échos d’un vieux débat
- Page 255 and 256: mais je crois que ce serpent ne se
- Page 257 and 258: espèces inanimées, et que dans le
- Page 259 and 260: chinois, qui a «le ventre comme ce
- Page 261 and 262:
classiques asinus indicus, et l’o
- Page 263 and 264:
attribuées à ces lances d’ivoir
- Page 265 and 266:
signifie pas que l’on croyait alo
- Page 267 and 268:
emarquable: il ne s’agit plus ici
- Page 269 and 270:
A gauche: squelette de licorne foss
- Page 271 and 272:
Contrairement à l’impression que
- Page 273 and 274:
cité, et l’auteur de l’article
- Page 275 and 276:
de la licorne, [qui] a exercé long
- Page 277 and 278:
Les récits des voyageurs contempor
- Page 279 and 280:
de doute qu’un tel animal ait exi
- Page 281 and 282:
nom d’Abou Qarn et ne le confonda
- Page 283 and 284:
népaliens appellent la vallée de
- Page 285 and 286:
termine sur une citation de Buffon
- Page 287 and 288:
En 1863 cependant, le Dictionnaire
- Page 289 and 290:
le Reem biblique au bos primigenius
- Page 291 and 292:
Comme ceux-ci, les dictionnaires de
- Page 293 and 294:
donnèrent à l’écrivain l’occ
- Page 295 and 296:
Les Licornes et La Licorne, deux to
- Page 297 and 298:
Oh, c’est elle, la bête qui n’
- Page 299 and 300:
Les questions que l’historien pos
- Page 301 and 302:
Les fées et les garous, les dragon
- Page 303 and 304:
Les derniers écrits de Victor Sega
- Page 305 and 306:
-305-
- Page 307 and 308:
TABLE DES ILLUSTRATIONS Lorsque l
- Page 309 and 310:
p.189: Carte de James Hall, 1605. R
- Page 311 and 312:
p.292, droite: Gravure de Maurice S
- Page 313 and 314:
Boccone (Paolo),270 Bochart (Samuel
- Page 315 and 316:
Fossiles,62,64,65,97,115,116,117,15
- Page 317 and 318:
Maillet (Benoit de),271 Malte-Brun
- Page 319 and 320:
Shakespeare (William),131,153 Shepa
- Page 321 and 322:
Ms fr.12469: Richard de Fournival,
- Page 323 and 324:
1.2 TEXTES 1.2.1 TEXTES ET AUTEURS
- Page 325 and 326:
CHASTELAIN (GEORGES), Œuvres, éd.
- Page 327 and 328:
PSEUDO-CALLISTHENE, Le Roman d’Al
- Page 329 and 330:
BACCI (ANDREA), De Monocerote seu U
- Page 331 and 332:
BROWNE (THOMAS), Essas sur les erre
- Page 333 and 334:
FRANTZE (WOLFGANG), Historia Animal
- Page 335 and 336:
LA PEYRERE (ISAAC DE), Relation du
- Page 337 and 338:
MOCQUET (JEAN), Voyages, Paris, 161
- Page 339 and 340:
REUSNER (NICOLAS), Emblemata, parti
- Page 341 and 342:
TOPSELL (EDWARD), The History of Fo
- Page 343 and 344:
DOUET D’ARCQ (L.), “Mémoires d
- Page 345 and 346:
WAROQUIER DE COMBLES (COMTE DE), ta
- Page 347 and 348:
2. ÉTUDES ET ARTICLES 2.1 DOCUMENT
- Page 349 and 350:
PLANCHE (ALICE), “La Double Licor
- Page 351 and 352:
BERNARDI (LUCIANO), “Toxines, her
- Page 353 and 354:
DRUCE (GEORGE C.), “The Mediaeval
- Page 355 and 356:
JOMARD (M.), Les Monuments de la g
- Page 357 and 358:
PANOFSKY (ERWIN), La Camera di San
- Page 359 and 360:
SOLOMON (HOWARD), Public Welfare, S
- Page 361 and 362:
TABLE DES MATIERES DU SECOND TOME 2