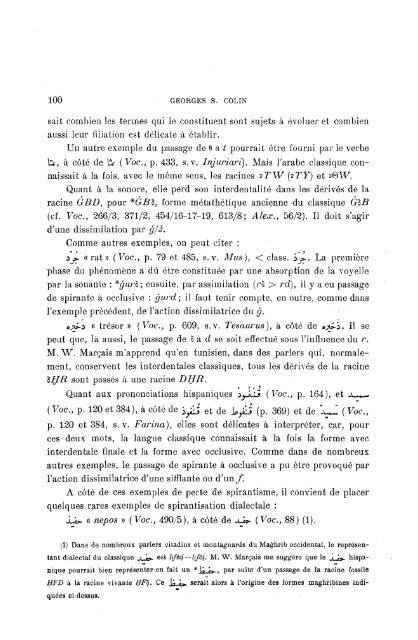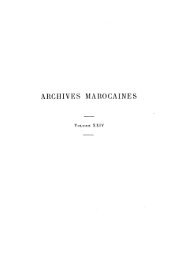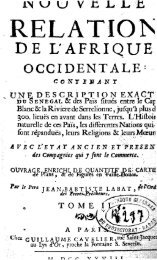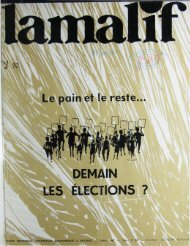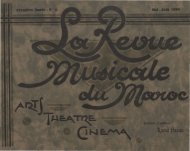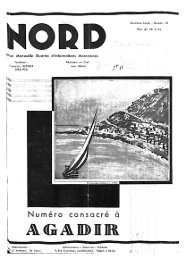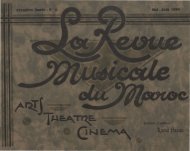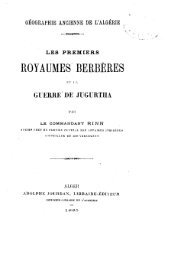1 - Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
1 - Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
1 - Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
100 GEORGES S. COLIN<br />
sait combien les termes qui le constituent sont sujets à évoluer et combien<br />
aussi leur filiation est délicate à établir.<br />
Un autre exemple <strong>du</strong> passage de 0 à t pourrait être fourni par le verbe<br />
\:c, à côté de t. (Voc., p. 433, s: v. lnjuriari). Mais l'arabe classique connaissait<br />
à la fois, avec le même sens, les racines 3T W ('3 TY) et 38W.<br />
Quant à la sonore, elle perd son interdentalité dans les dérivés de la<br />
racine GBD, pour *GBo, forme métathétique ancienne <strong>du</strong> classique GoB<br />
(cf. Voc., 266/3, 371/2, 454/16-17-19, 613/8; Alex., 56/2). Il doit s'agir<br />
d'une dissimilation par fJ/i.<br />
Comme autres exemples, on peut citer:<br />
:J; « rat)) (Voc., p. 79 et 485, s. v. A1us), < class. );. La première<br />
phase <strong>du</strong> phénomène a dû être constituée par une absorption de la yoyelle<br />
par la :;onante : *fjUl'O; ensuite, par assimilation (1'0 > rd), il y a eu passage<br />
de spirante à occlusive: fjurd; il faut tenir compte, en outre, comme dans<br />
l'exemple précédent, de l'action dissimilatrice <strong>du</strong> fJ.<br />
o~; « trésor» (Voc ... p. 609, S.v. Tesaurus), à côté de o~;';.'Il se<br />
peut que, là aussi, le passage de 0 à d se soit effectué sous l'influence <strong>du</strong> f'.<br />
M. W. Marçais m'apprend qu'en tunisien, dans des parlers qui, normalement,<br />
conservent les interdentales classiques, tous les déri vés de la racine<br />
oijR sont passés à une racine DijR.<br />
Quant aux prononciations hispaniques ~;.:j (Voc., p. 164), et ~<br />
(Voc., p. 120 et 384), à côté de ~;:;<br />
et de 1.,';:.; (p. 369) et de ~ (Voc.,<br />
p. 120 et 384, s. v. Farina), elles sont délicates à interpréter, car, pour<br />
ces deux mots, la langue classique connaissait à<br />
la fois la forme avec<br />
interdentale finale et la forme avec occlusive. Comme dans de nombreux<br />
autres exemples, le passage de spirante à occlusiye a pu être provoqué par<br />
l'action dissimilatrice d'une sifflante ou d'unf<br />
A côté de ces exemples de perte de spirantisme, il convient de placer<br />
quelques rares exemples de spirantisation dialectale:<br />
+ « nepos » (Voc., 490/5), à côté de ~ (Voc... 88) (1).<br />
(1) Dans de nombreux parlers citadins et montagnards <strong>du</strong> Maghrib occidental, le représentant<br />
dialectal <strong>du</strong> classique w\..À> est (ifë4-bfët. M. W. Marçais me suggère que le ~> hispa-<br />
~ M<br />
nique pourrait bien représenter en fait un *.1;..4>, par suite d'un passage de la racine fossile<br />
ljFD à la racine vivante f:lF9' Ce ..l;..Â> serait alors à l'origine des formes maghribines indi-<br />
. .<br />
quées ci-dessus.