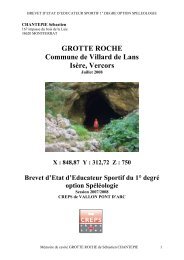- Page 1 and 2:
Université de Bourgogne UFR.STAPS
- Page 3 and 4:
REMERCIEMENTS Nous voudrions remerc
- Page 5 and 6:
SOMMAIRE Introduction générale ..
- Page 7 and 8:
3. - Méthodologie 2.1.5 - L'analys
- Page 9 and 10:
2.6.2.2.B.b - Analyse des données
- Page 11 and 12:
3.1.1 - Les conduites engagées pr
- Page 13 and 14:
2.1.B.3. - Tâche et consignes ....
- Page 15 and 16:
centre de la terre", le Ministère
- Page 17 and 18:
ibliographie ; ce travail est en ef
- Page 19 and 20:
ses recommandations pour une pédag
- Page 21:
PLAN SIMPLIFIE Le cadre (caractéri
- Page 24 and 25:
spare time activities, sports spele
- Page 26 and 27:
attaquées par les acides qu'elle t
- Page 29 and 30:
la pluviométrie, car un plus grand
- Page 31 and 32:
ELEMENTS DE TERMINOLOGIE EN KARSTOL
- Page 33 and 34:
1.2 - Les difficultés techniques d
- Page 36 and 37:
COMMENTAIRES TECHNIQUES La descente
- Page 38 and 39:
Les aptitudes mises en jeu dans ces
- Page 40 and 41:
1.2.7 Les accidents Pour conclure c
- Page 42 and 43:
licenciés FFS était d'environ 800
- Page 44 and 45:
(voir la deuxième partie de ce cha
- Page 46 and 47:
Dans les réponses au questionnaire
- Page 48 and 49:
1.3.1.5 - Tentative de synthèse :
- Page 50 and 51:
Une définition précise du sport,
- Page 52 and 53:
léologues. Ils ont fait passer à
- Page 54 and 55:
Par régression fantasmatique, ces
- Page 56 and 57:
- le héros épique, l'homme exempl
- Page 58 and 59:
mort, il descend aux Enfers. De plu
- Page 60 and 61:
CONCLUSION Nous pouvons souligner l
- Page 62 and 63:
plafond s'effondre brusquement). Un
- Page 67 and 68:
2.2 - Les démarches scientifiques
- Page 69 and 70:
Il existe même une branche de la m
- Page 71 and 72:
2.3 - Les pratiques de loisir Elles
- Page 73 and 74:
2.5 - La démarche pédagogique (vo
- Page 75 and 76:
secours sous terre demande de gros
- Page 77 and 78:
- sur l'engagement des membres comm
- Page 79 and 80:
chez le pratiquant. Pour cela, nous
- Page 81 and 82:
PLAN SIMPLIFIE Introduction Revue d
- Page 83 and 84:
- Basic aptitudes : understanding o
- Page 85 and 86:
notion d'activité renvoie, elle,
- Page 87 and 88:
En spéléologie comme dans les aut
- Page 89 and 90:
existe une configuration initiale e
- Page 91 and 92:
cette étude, par l'intermédiaire
- Page 93 and 94:
2.3 - Le modèle taxonomique de Fle
- Page 95 and 96:
Tableau 3
- Page 97 and 98:
D'autre part, la connaissance des a
- Page 99 and 100:
C'est donc avec M. MEYSONNIER, Cons
- Page 101 and 102:
interviewées, présentée sur un h
- Page 103 and 104:
6 7 4 6 5 7 6 4 4 7 7 7 7 7 4 6 5 7
- Page 105 and 106:
DEFINITION 4.3 - Analyse pour chacu
- Page 107 and 108:
DEFINITION cats RESULTATS 4.3.2 - L
- Page 109 and 110:
DEFINITION 4.3.3 - LA COORDINATION
- Page 111 and 112:
DEFINITION 4.3.4 - L'EQUILIBRE CORP
- Page 113:
DEFINITION 4.3.6. - LA FORCE DYNAMI
- Page 116 and 117:
DEFINITION 4.3.8 - LA FORCE STATIQU
- Page 118 and 119:
DEFINITION RESULTATS 4.3.10 - LA SO
- Page 120 and 121:
4.3.12 - CONNAISSANCE DU MATERIEL E
- Page 122 and 123:
DEFINITION 4.3.13 - LA PLASTICITE D
- Page 124 and 125:
DEFINITION 4.3.15 - L'ORIENTATION S
- Page 126 and 127:
DEFINITION 4.3.17 - LA MEMORISATION
- Page 128 and 129:
DEFINITION 4.3.19 - LA COMPREHENSIO
- Page 130 and 131:
DEFINITION 4.3.20 - LA COOPERATION
- Page 132 and 133:
DEFINITION 4.3.22 - LA CONFIANCE Co
- Page 134 and 135:
DEFINITION RESULTATS 4.3.24 - LA CO
- Page 136 and 137:
DEFINITION 4.3.26 - LE CONTROLE DE
- Page 138 and 139:
DEFINITION 4.3.28 - LA MAITRISE DE
- Page 140 and 141:
DEFINITION 4.3.30 - LA RUSTICITE Co
- Page 142 and 143:
4.4 - Analyse des propositions comp
- Page 144 and 145:
l'aptitude à identifier les passag
- Page 146 and 147:
mais le rapport entre motivation et
- Page 148 and 149:
3.2 1 15 18 6 6,5 0,56 3.3 1 6 6 16
- Page 150 and 151:
l'écoute et l'attention aux autres
- Page 152 and 153:
au moins le niveau 4 dans une éche
- Page 155 and 156:
un administrateur qui facilite la v
- Page 157 and 158:
7. - UNE APPLICATION : INTRODUCTION
- Page 159 and 160:
le contrôle émotionnel (CE) qui a
- Page 163 and 164:
7.3.1 - Le désir de réussite (DR)
- Page 165 and 166:
chez les spéléologues. Il faudra
- Page 167 and 168:
nécessaire de trouver un autre ins
- Page 169 and 170:
7.4.2 - Etude de cas n° 2 Nous avo
- Page 171 and 172:
sportive. Il en est de même pour l
- Page 173 and 174:
8. - CONCLUSION Notre travail sur l
- Page 175 and 176:
QUESTIONNAIRE SUR L'EVALUATION DES
- Page 177 and 178:
Définition : 2.4 - L'équilibre co
- Page 179 and 180:
mise en place d'habiletés et font
- Page 181 and 182:
Définition : 5.2 - Ecoute et atten
- Page 183 and 184:
Définition : 6.7 Le plaisir de pra
- Page 185 and 186:
Requiert une activité physique de
- Page 187 and 188:
Exige une faible utilisation de la
- Page 189 and 190:
Exige une faible utilisation de la
- Page 191 and 192:
Exige une faible utilisation de la
- Page 193 and 194:
EQUILIBRE CORPOREL GENERAL Définit
- Page 195 and 196:
COORDINATION GENERALE Définition :
- Page 197 and 198:
SOUPLESSE STATIQUE Définition : c'
- Page 199 and 200:
ANNEXE 2 : LES APTITUDES MISES EN J
- Page 201 and 202:
PARUTIONS ET COMMUNICATIONS CHAPITR
- Page 203 and 204:
léologie, quelques notions de budg
- Page 205 and 206:
speleology so far, are gradually le
- Page 207 and 208:
1. - METHODES DE RECUEIL DES DONNEE
- Page 209 and 210:
communiqués par P. BRUNET, alors p
- Page 211 and 212:
L'ancienneté est donc largement su
- Page 214 and 215:
Allemagne ............... Autriche
- Page 216 and 217:
Nous allons maintenant envisager le
- Page 218:
sur 161 femmes : 85 "individuelles"
- Page 221 and 222:
TABLEAU 9 L'âge des randonneurs p
- Page 223 and 224:
ural au sein de la FFS, que nous ve
- Page 225 and 226:
2.6 - La répartition géographique
- Page 227 and 228:
spéléologues, il y a des régions
- Page 229 and 230:
Cela permet de définir 3 classes d
- Page 231 and 232:
2.6.2.A - Les données brutes : En
- Page 233 and 234:
2.6.2.B - L'analyse statistique : N
- Page 235 and 236:
des données démographiques et "ph
- Page 237 and 238:
général, toutes disciplines confo
- Page 239 and 240:
ayant eu le plus de personnes secou
- Page 241 and 242:
Nous développerons moins le cas d'
- Page 243 and 244:
du gouffre Berger nécessite donc d
- Page 245 and 246:
donné par rapport au nombre total
- Page 247 and 248:
à proximité (régions E, F et G).
- Page 249 and 250:
Non réponse (2%) Plus d'une sortie
- Page 251 and 252:
Non réponse (1%) Recherche de prem
- Page 253 and 254:
81 citations concernent l'escalade
- Page 255 and 256:
nombre de couples qui pratiquent en
- Page 257 and 258:
83 (31 à 40 %). Encore une fois, l
- Page 259 and 260:
En plus des liaisons déjà évoqu
- Page 261 and 262:
l'importance du stock de matériel
- Page 263 and 264:
moment spécifique à la spéléolo
- Page 265 and 266:
FF Course orientation .............
- Page 267 and 268:
analysées dans le tableau). Le sex
- Page 269 and 270:
ANNEXE 3 : 1 - Comparaison du nombr
- Page 271 and 272:
ANNEXE 3 : 2. Comparaison du rappor
- Page 273 and 274:
ANNEXE 4 : ANALYSE EN COMPOSANTES P
- Page 275 and 276:
9 95 37804 136598 29727 116371 12 1
- Page 277 and 278:
85 7 142201 509231 141098 10 86 74
- Page 279 and 280:
ANNEXE 4 : tableau 26 (suite) REGIO
- Page 281 and 282:
ANNEXE 4 : Tableau 27 MATRICE DES D
- Page 283 and 284:
-1.4222 0.1626 -1.0042 -1.0216 -1.0
- Page 285 and 286:
-1.4586 -0.6834 -0.8594 -0.6655 -0.
- Page 287 and 288:
ANNEXE 4 : Tableau 14 (rappel) 1 2
- Page 289 and 290:
ANNEXE 5 : LES CARACTERISTIQUES DU
- Page 291 and 292:
ANNEXE 6 : 1. Evolution quantitativ
- Page 293 and 294:
ANNEXE 6 : 3. Rapport entre le nomb
- Page 295 and 296:
ANNEXE 7 : QUESTIONNAIRE POUR LES L
- Page 297 and 298:
au niveau de votre club au niveau
- Page 299 and 300:
PARUTIONS ET COMMUNICATIONS - JOVIG
- Page 301 and 302:
2.1 - La dimension culturelle de la
- Page 303 and 304:
Nous soulignerons d'abord les rappo
- Page 305 and 306:
2- Didactic analysis of speleology
- Page 307 and 308:
principle of action precisely. We h
- Page 309 and 310:
est au contraire tout à fait connu
- Page 311 and 312:
adaptation des techniques et du mat
- Page 313 and 314:
l'impression de ne pas pouvoir teni
- Page 315 and 316:
A notre avis, une forme de pratique
- Page 317 and 318:
afférentes: Nous allons illustrer
- Page 319 and 320:
(1964) ("l'aptitude est une caract
- Page 321 and 322:
Figure 24 Les principes d'action en
- Page 323 and 324:
des aptitudes importantes : la coo
- Page 325 and 326:
Nous reviendrons de façon plus pr
- Page 327 and 328: diversification de la pratique vers
- Page 329 and 330: l'accoutrement et le matériel ont
- Page 331 and 332: l'apprentissage technique, principa
- Page 333 and 334: 2.2.3. - ETAPE 3 Elle commence lors
- Page 335 and 336: corde où il s'épuise. On peut ain
- Page 337 and 338: 2.2.4.1 - les pratiques de recherch
- Page 339 and 340: abandonné depuis plus ou moins de
- Page 341 and 342: savoir brancarder en zone chaotique
- Page 343 and 344: capable d'observer et de prélever
- Page 345 and 346: a - équiper en sécurité : 1° ê
- Page 347 and 348: 3. - L'APS A DES FINS D'ENSEIGNEMEN
- Page 349 and 350: la spéléologie serait une APN, ce
- Page 351 and 352: contenu riche. En effet, la découv
- Page 353 and 354: 3.2.2 - Quelles adaptations matéri
- Page 355 and 356: encontre habituellement. En revanch
- Page 357: Quelles procédures d'évaluation s
- Page 360 and 361: PLAN SIMPLIFIE Revue de question -
- Page 362 and 363: Simplified plan 1 Review of the mat
- Page 364 and 365: INTRODUCTION 1. -REVUE DE QUESTION
- Page 366 and 367: (égocentré) d'où la "photographi
- Page 368 and 369: la compréhension du milieu l'espr
- Page 370 and 371: 1.1.2.2.2 - Les aptitudes cognitive
- Page 372 and 373: Cette notion de difficulté de la t
- Page 374 and 375: certainement une longue résistance
- Page 376 and 377: provienne d'un plus grand entraîne
- Page 380 and 381: course puisse avoir lieu dans des c
- Page 382 and 383: anticipée des situations, l'analys
- Page 384 and 385: devient le héros, tantôt épique
- Page 386 and 387: peut conjecturer en revanche que l'
- Page 388 and 389: 1.4.3 - Les moyens d'orientation de
- Page 390 and 391: (1988), et BLADES et SPENCER (1989)
- Page 392 and 393: Les tâches que nous allons propose
- Page 394 and 395: 104
- Page 396 and 397: Les chiffres parlent d'eux-mêmes :
- Page 398 and 399: coefficient de corrélation par ran
- Page 400 and 401: Ceci implique qu'il n'y aurait pas
- Page 402 and 403: donc largement les moyens de résou
- Page 404 and 405: (au sens strict) brun aux circonvol
- Page 406 and 407: 2.1.B.1. - But et hypothèses : EXP
- Page 408 and 409: 2.1.B.5.1. - Visite de la carrière
- Page 410 and 411: d'orientation. la dimension restrei
- Page 412 and 413: 2 groupes de 2 enfants. Les enfants
- Page 414 and 415: 2.2.1. - Buts EXPERIENCE N°2 L'ORI
- Page 416 and 417: 126
- Page 418 and 419: tout autonomes. Par contre, ceux qu
- Page 420 and 421: phase d'adaptation, l'exercice a re
- Page 422 and 423: faire), le stress lié à un enviro
- Page 424 and 425: ALVARES KM. et HULIN CL. (1973)- An
- Page 426 and 427: DAVISSE A. et LOUVEAU C. (1991)- Sp
- Page 428 and 429:
GUILLAUME P. (1969)- Manuel de psyc
- Page 430 and 431:
MULOT J (1993)- Qu'en est-il de nos
- Page 432 and 433:
SEILER R. (1990)- Decision making p
- Page 434 and 435:
Tableau 9 L'âge des randonneurs p
- Page 436:
146