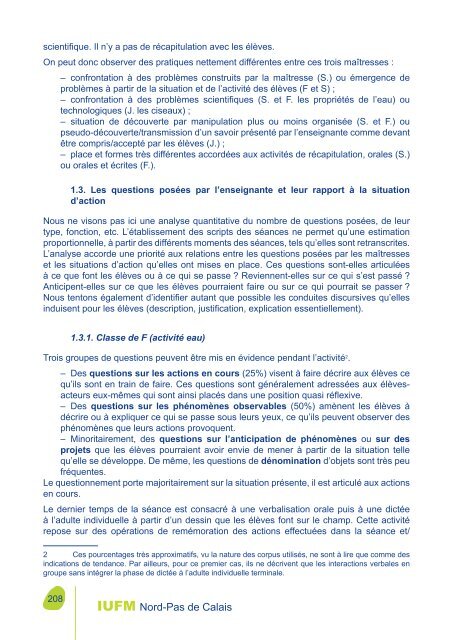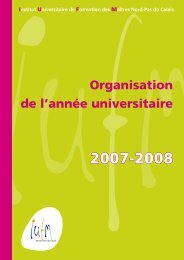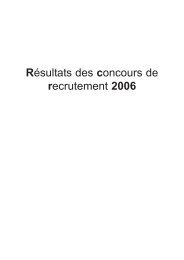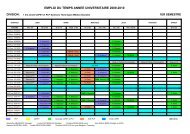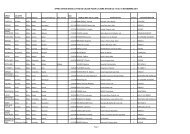Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
scientifique. Il n’y a pas de récapitulation avec <strong>le</strong>s élèves.<br />
On peut donc observer des pratiques nettement différentes entre ces trois maîtresses :<br />
0<br />
– confrontation à des problèmes construits par la maîtresse (S.) ou émergence de<br />
problèmes à partir de la situation et de l’activité des élèves (F et S) ;<br />
– confrontation à des problèmes scientifiques (S. et F. <strong>le</strong>s propriétés de l’eau) ou<br />
technologiques (J. <strong>le</strong>s ciseaux) ;<br />
– situation de découverte par manipulation plus ou moins organisée (S. et F.) ou<br />
pseudo-découverte/transmission d’un savoir présenté par l’enseignante comme devant<br />
être compris/accepté par <strong>le</strong>s élèves (J.) ;<br />
– place et formes très différentes accordées aux activités de récapitulation, ora<strong>le</strong>s (S.)<br />
ou ora<strong>le</strong>s et écrites (F.).<br />
1.3. Les questions posées par l’enseignante et <strong>le</strong>ur rapport à la situation<br />
d’action<br />
Nous ne visons pas ici une analyse quantitative du nombre de questions posées, de <strong>le</strong>ur<br />
type, fonction, etc. L’établissement des scripts des séances ne permet qu’une estimation<br />
proportionnel<strong>le</strong>, à partir des différents moments des séances, tels qu’el<strong>le</strong>s sont retranscrites.<br />
L’analyse accorde une priorité aux relations entre <strong>le</strong>s questions posées par <strong>le</strong>s maîtresses<br />
et <strong>le</strong>s situations d’action qu’el<strong>le</strong>s ont mises en place. Ces questions sont-el<strong>le</strong>s articulées<br />
à ce que font <strong>le</strong>s élèves ou à ce qui se passe ? Reviennent-el<strong>le</strong>s sur ce qui s’est passé ?<br />
Anticipent-el<strong>le</strong>s sur ce que <strong>le</strong>s élèves pourraient faire ou sur ce qui pourrait se passer ?<br />
Nous tentons éga<strong>le</strong>ment d’identifier autant que possib<strong>le</strong> <strong>le</strong>s conduites discursives qu’el<strong>le</strong>s<br />
induisent pour <strong>le</strong>s élèves (description, justification, explication essentiel<strong>le</strong>ment).<br />
1.3.1. Classe de F (activité eau)<br />
Trois groupes de questions peuvent être mis en évidence pendant l’activité .<br />
– Des questions sur <strong>le</strong>s actions en cours ( %) visent à faire décrire aux élèves ce<br />
qu’ils sont en train de faire. Ces questions sont généra<strong>le</strong>ment adressées aux élèvesacteurs<br />
eux-mêmes qui sont ainsi placés dans une position quasi réf<strong>le</strong>xive.<br />
– Des questions sur <strong>le</strong>s phénomènes observab<strong>le</strong>s ( 0%) amènent <strong>le</strong>s élèves à<br />
décrire ou à expliquer ce qui se passe sous <strong>le</strong>urs yeux, ce qu’ils peuvent observer des<br />
phénomènes que <strong>le</strong>urs actions provoquent.<br />
–<br />
Minoritairement, des questions sur l’anticipation de phénomènes ou sur des<br />
projets que <strong>le</strong>s élèves pourraient avoir envie de mener à partir de la situation tel<strong>le</strong><br />
qu’el<strong>le</strong> se développe. De même, <strong>le</strong>s questions de dénomination d’objets sont très peu<br />
fréquentes.<br />
Le questionnement porte majoritairement sur la situation présente, il est articulé aux actions<br />
en cours.<br />
Le dernier temps de la séance est consacré à une verbalisation ora<strong>le</strong> puis à une dictée<br />
à l’adulte individuel<strong>le</strong> à partir d’un dessin que <strong>le</strong>s élèves font sur <strong>le</strong> champ. Cette activité<br />
repose sur des opérations de remémoration des actions effectuées dans la séance et/<br />
Ces pourcentages très approximatifs, vu la nature des corpus utilisés, ne sont à lire que comme des<br />
indications de tendance. Par ail<strong>le</strong>urs, pour ce premier cas, ils ne décrivent que <strong>le</strong>s interactions verba<strong>le</strong>s en<br />
groupe sans intégrer la phase de dictée à l’adulte individuel<strong>le</strong> termina<strong>le</strong>.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais