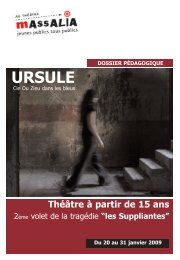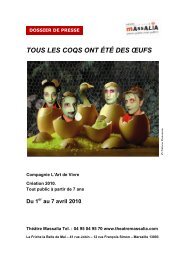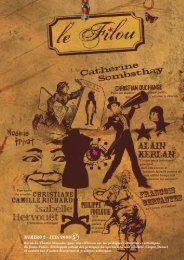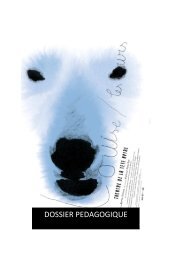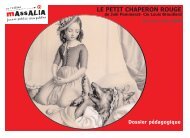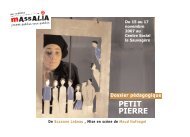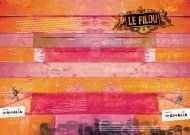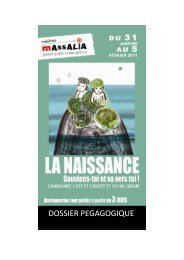Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
“Déroutes” de Mathilde Monnier par Gérard May<strong>en</strong><br />
on peut ret<strong>en</strong>ir trois motifs qu’on va remarquer tout au long de ce travail :<br />
- Le motif du souffle, qui revi<strong>en</strong>t beaucoup dans la description presque clinique qu’on a<br />
de L<strong>en</strong>z dans son rapport au monde, dans un rapport de compression ou de grande<br />
ext<strong>en</strong>sion, un li<strong>en</strong> au monde qui passe par le souffle comme écriture première de notre<br />
relation au monde. Dans son cas, ça passe par des amplifications, des restrictions.<br />
- Le motif de la glace. Dans les extraits, on voit qu’ils travaill<strong>en</strong>t avec des blocs de glace.<br />
Il me semble que c’est lié à plusieurs notations du texte, où il se jette dans une fontaine<br />
d’au glacée. Il y a un rapport avec la température, la glace très prés<strong>en</strong>t.<br />
- Le motif de la marche. Ces marches incessantes, à pertes de vue qui sont dans « L<strong>en</strong>z ».<br />
Pour rev<strong>en</strong>ir à ce qu’on voyait à l’image, on est vraim<strong>en</strong>t dans des élém<strong>en</strong>ts de<br />
composition. On est dans une espèce de nappe, comme une sorte de gouffre<br />
d’horizontalité, dans ce plateau paysage, on est dans une sorte de nappe de marche,<br />
quelque chose qui met <strong>en</strong> cause nos perceptions habituelles de la perspective, <strong>en</strong> tout<br />
cas les aiguise, qui, pour ma part, les excite. On pourrait considérer que la marche est le<br />
lieu de traitem<strong>en</strong>t perman<strong>en</strong>t du rapport horizontalité/verticalité. Cette insistance dans<br />
la marche vi<strong>en</strong>t exciter, problématiser cette figure.<br />
Autre élém<strong>en</strong>t de composition ess<strong>en</strong>tiel, avant de recomm<strong>en</strong>cer à observer les choses. Je<br />
parlais de ces <strong>en</strong>trées multiples. Que se passe t-il ? Chaque interprète, y compris dans<br />
des travaux seuls à seuls avec Mathilde Monnier, <strong>en</strong> tout petits groupes de deux ou à<br />
trois, produit des boucles : des boucles de déplacem<strong>en</strong>ts, des boucles de marche, des<br />
boucles de façon de s’<strong>en</strong>gager dans le monde et dans ce plateau paysage. Ces boucles<br />
débord<strong>en</strong>t du plateau. Elle s’insinu<strong>en</strong>t, apparaiss<strong>en</strong>t et disparaiss<strong>en</strong>t par des <strong>en</strong>trées et<br />
sorties multiples, et on perçoit bi<strong>en</strong> qu’elles se réalis<strong>en</strong>t <strong>en</strong> dehors du plateau lui-même.<br />
On perçoit tout ceci plus ou moins consciemm<strong>en</strong>t.<br />
Il faut savoir qu’un grand nombre des élém<strong>en</strong>ts de composition ne sont pas manifestes<br />
et visibles à l’œil nu. Ça ne veut pas dire qu’ils ne travaill<strong>en</strong>t pas, qu’ils ne produis<strong>en</strong>t<br />
ri<strong>en</strong>. C’est sot de p<strong>en</strong>ser que la danse est un art de l’image, un art de photographie mise<br />
<strong>en</strong> mouvem<strong>en</strong>t. Je p<strong>en</strong>se que la photographie a fait beaucoup de mal, dans la perception<br />
de la danse que nous avons habituellem<strong>en</strong>t, car nous sommes <strong>en</strong> att<strong>en</strong>te de jolis mouvem<strong>en</strong>ts<br />
successifs. On peut estimer que la danse n’est pas ça. Dans ce cas là, ce que<br />
nous percevons confusém<strong>en</strong>t de ces trajectoires qui après tout, doiv<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> se terminer<br />
quelque part, puisque l’interprète a disparu d’un côté, et va réapparaître deux minutes<br />
après de l’autre côté, au fond. On se demande ce qui se passe, s’il y a des arrières-scènes,<br />
des couloirs, si ça continue, s’il sort de la salle complètem<strong>en</strong>t.<br />
Par ailleurs, je vais évoquer un autre élém<strong>en</strong>t de composition dont je ne me suis r<strong>en</strong>du<br />
compte qu’<strong>en</strong> visionnant la vidéo, même <strong>en</strong> ayant vu la pièce huit fois, et ceci grâce à<br />
cette vidéo moche. Je me suis mis à retranscrire le parcours, (je reconnais les<br />
interprètes), et à les tracer. Ils sont tous très singularisés. J’ai attiré votre att<strong>en</strong>tion sur<br />
Herman, parce que, pour le coup, singulier des singuliers, il a un parcours particulièrem<strong>en</strong>t<br />
manifeste et systématisé. Les autres ont aussi véritablem<strong>en</strong>t des qualités de<br />
trajectoires très singulières. Je vais faire de la micro-danse, ultra minimale. (Il montre sur<br />
la scène ces trajectoires). Vous allez avoir des trajectoires régulières, sur des courbes<br />
légèrem<strong>en</strong>t elliptiques, d’autres vont faire de longues traversées. D’autres, au contraire,<br />
vont avoir des inscriptions « au carré », je dirais. Certains ont des séqu<strong>en</strong>ces très<br />
définies, <strong>en</strong> six pas par exemple. Et puis, tout d’un coup, ils font quelque chose qu’on<br />
n’arrive plus du tout à repérer ou à saisir. D’autres font des boucles.<br />
On a manifestem<strong>en</strong>t, contrairem<strong>en</strong>t à ce qu’on pourrait croire, une singularisation, chacun<br />
individuellem<strong>en</strong>t saisi, produit une matière particulière, au travers même des trajectoires.<br />
On va rev<strong>en</strong>ir à de l’image. Je vous invite à vous intéresser plus particulièrem<strong>en</strong>t à la nature<br />
physique, ou la qualité physique de la relation <strong>en</strong>tre eux, qu’est-ce que ça produit comme<br />
espace. Comm<strong>en</strong>t se travaill<strong>en</strong>t les espaces <strong>en</strong>tre eux. Est-ce qu’on se rapproche ? Est-ce<br />
qu’on se touche ? Les rapprochem<strong>en</strong>ts sont-ils nets, ou moins saisissables ? Sont-ils fréqu<strong>en</strong>ts<br />
? Ont-ils l’air délibérés ? On y va.<br />
Ça comm<strong>en</strong>ce par une longue plage, sinon d’obscurité, de pénombre profonde. On va<br />
passer. J’accélère d’emblée. L’observation que je vous propose, on aurait pu la conduire<br />
de manière plus riche sur l’autre cassette, mais là, on r<strong>en</strong>tre dans les qualités de prés<strong>en</strong>ce,<br />
les manières d’être à l’égard de l’autre, et on voit quand même suffisamm<strong>en</strong>t le<br />
travail des trajectoires, des espaces.<br />
100