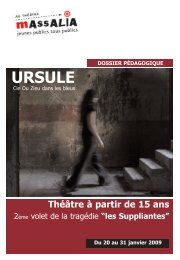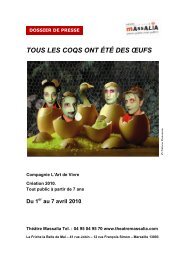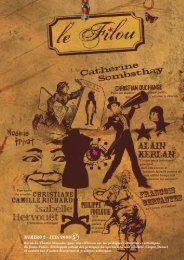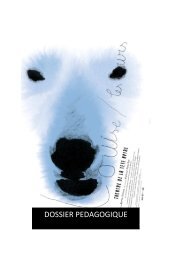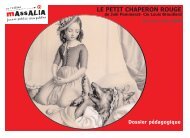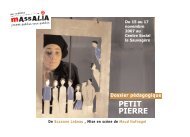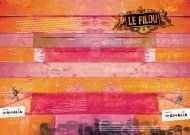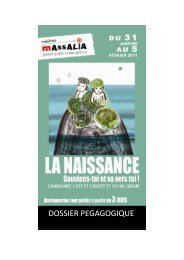Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’œuvre de Anne Teresa de Keersmaker par Philippe Guisgand<br />
explique que parfois, ce qu’on appelle chez elle les "flower patterns", ce que vous voyez,<br />
les espèces de traits, comme ça, qui stri<strong>en</strong>t le praticable, le tapis de danse, ne sont pas<br />
seulem<strong>en</strong>t une manière de faire de jolis tapis, ce sont aussi des repères très importants<br />
de placem<strong>en</strong>t pour les danseurs. Ils sont dans une telle complexité de l’occupation de<br />
l’espace, que sans ces repères, ils peuv<strong>en</strong>t être perdus. Je vous montrerais peut-être tout<br />
à l’heure, des choses. Ce qu’on voit là, ce n’est pas une ombre portée, c’est des gros<br />
points noirs, on voit des lignes continues, des lignes pointillées, qui occup<strong>en</strong>t tout<br />
l’espace. On voit ça aussi dans « Rain ». Alors dans ce spectacle, c’est comme un<br />
gymnase <strong>en</strong> désordre, comme si on avait secoué tout un gymnase et que toute les lignes<br />
qui marqu<strong>en</strong>t les différ<strong>en</strong>ts terrains se retrouvai<strong>en</strong>t mélangés dans tous les s<strong>en</strong>s.<br />
Je voulais vous dire <strong>en</strong>core quelque chose la-dessus. Par rapport à la notion de polyphonies,<br />
elle a quand même une préfér<strong>en</strong>ce pour un processus musical particulier, qui est le<br />
palindrome, la lecture inversée, que l’on voit dans « Rain », qui date de 2000. La lecture<br />
inversée, c’est (il montre des mouvem<strong>en</strong>ts). Je pr<strong>en</strong>ds un mouvem<strong>en</strong>t, une première<br />
séqu<strong>en</strong>ce qui peut être simplem<strong>en</strong>t (il montre) et je l’inverse. Si je fais palindrome plus<br />
accumulation, je vais avoir une première cellule rétrograde, donc inversion, première<br />
cellule, deuxième cellule, rétrograde, et inversion, première cellule, deuxième cellule,<br />
troisième cellule, deuxième, première et j’ai l’inversion, etc. Donc on retrouve un<br />
mouvem<strong>en</strong>t qui s’<strong>en</strong>richit finalem<strong>en</strong>t, non pas de choses qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t s’accumuler et qui<br />
vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t d’ailleurs, mais qui simplem<strong>en</strong>t sont nourries de la réflexion, de la manière<br />
dont on peut voir le mouvem<strong>en</strong>t, de son point de vue, de son s<strong>en</strong>s, de son inversion, qui<br />
sont des processus d’écriture relativem<strong>en</strong>t classiques et anci<strong>en</strong>s <strong>en</strong> musique.<br />
Enfin troisième temps de la périodisation, dont peut-être la pièce « Rain » constitue le<br />
mom<strong>en</strong>t magique, c’est celui où les ressorts formels de la construction de la partition ne<br />
sont plus regardés que d’assez loin. La danse s’impose finalem<strong>en</strong>t comme une sorte de<br />
contrepoint de ce qu’est la musique. On assiste plutôt à une prise de distance où un<br />
dialogue peut s’instaurer.<br />
Le quatrième élém<strong>en</strong>t qui se met <strong>en</strong> place à cette époque là du point de vue de la<br />
composition, c’est le passage assez progressif de l’unisson, qui faisait la force de « Fase »<br />
et de « Rosas danst rosas », au contrepoint, qui va aller <strong>en</strong> se complexifiant au fur et à<br />
mesure des créations. Cette notion d’unisson disparaît progressivem<strong>en</strong>t à partir de<br />
« Stella » qui est la cinquième pièce, alors qu’elle avait initialem<strong>en</strong>t fascinée<br />
Keersmaeker, de « Fase », où on voit les deux danseuses véritablem<strong>en</strong>t dans le même<br />
mouvem<strong>en</strong>t, à « Mikrokosmos » dans le Quatuor n°4. La chorégraphe comm<strong>en</strong>ce à s’<strong>en</strong><br />
éloigner à partir de « ERTS ». On a vu tout à l’heure dans la Grande Fugue, qu’on était<br />
déjà dans l’incarnation de la musique de Beethov<strong>en</strong>, avec forcém<strong>en</strong>t, une occupation de<br />
l’espace qui r<strong>en</strong>voie à la manière sont est structurée <strong>en</strong> contrepoint, cette fugue. Alors<br />
Keersmaeker ne va pas lâcher ces trois grands registres initiaux dont on a parlé, et qui se<br />
sont imposés dès la première pièce, qui sont la répétition, l’accumulation, et la variation.<br />
Au fil des pièces, ces principes vont se multiplier, se complexifier, <strong>en</strong> s’inspirant des<br />
structures musicales, qui sont l’unisson, le contrepoint, l’alternance, le développem<strong>en</strong>t<br />
d’un motif, etc. Mais la déclinaison à partir d’une séqu<strong>en</strong>ce restreinte va demeurer l’un<br />
des fondem<strong>en</strong>ts de la composition et de la construction du vocabulaire, qui fait que la<br />
grande majorité des œuvres chorégraphiées d’Anne Teresa de Keersmaeker, cré<strong>en</strong>t un<br />
monde qui est à la fois toujours le même et toujours un autre.<br />
La fréqu<strong>en</strong>tation de son œuvre dans la durée impose presque un zoom du regard. Vous<br />
pouvez pr<strong>en</strong>dre la pièce pour ce qu’elle est, indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t de toutes les autres,<br />
évidemm<strong>en</strong>t, elle porte son univers <strong>en</strong> soi. En même temps, si vous la regardez d’un peu<br />
plus loin, et que vous la resituez dans le travail, elle porte aussi une généalogie très<br />
importante située dans les pièces précéd<strong>en</strong>tes, parfois de très anci<strong>en</strong>nes, des dizaines<br />
d’années <strong>en</strong> arrière. Avec des petites choses qui revi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t dans son travail, c’est<br />
toujours de l’ordre de la réminisc<strong>en</strong>ce.<br />
Cet « autre » se situe aussi dans ce qu’on a évoqué tout à l’heure, comme une espèce de<br />
marge, d’espace de liberté laissé aux interprètes. C’est le cas notamm<strong>en</strong>t dans « Rain ».<br />
Il importe finalem<strong>en</strong>t pour Keersmaeker assez peu que dans une diagonale de jetés, la<br />
photo est particulièrem<strong>en</strong>t révélatrice de ça, les bras d’un danseur ou d’une danseuse<br />
soi<strong>en</strong>t un peu plus haut ou un peu plus bas que ce qu’on appelle l’unisson de manière<br />
académique. Ce qui est important, c’est que la même dynamique guide tout le monde,<br />
et guide cette vague qui se propulse d’un côté et de l’autre de la scène.<br />
La composition chorégraphique de Keersmaeker est donc classique. Elle est classique <strong>en</strong><br />
84