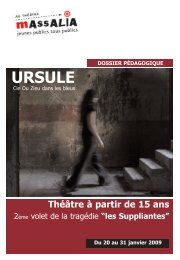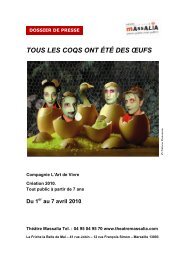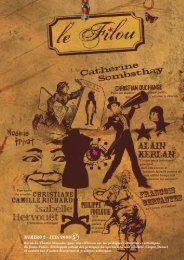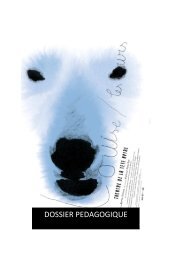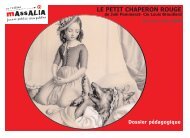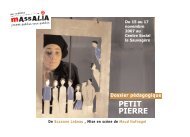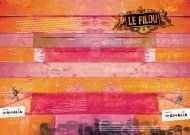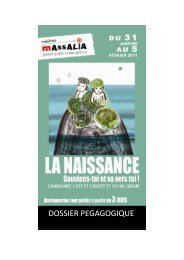Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’œuvre de Anne Teresa de Keersmaker par Philippe Guisgand<br />
corporelles répétées indéfinim<strong>en</strong>t, déclinées, interprétées avec des int<strong>en</strong>sités de<br />
nuances assez variées. Il a été reçu <strong>en</strong> Belgique véritablem<strong>en</strong>t comme une provocation,<br />
<strong>en</strong>traînant des réactions très <strong>en</strong>thousiastes, mais aussi vraim<strong>en</strong>t des réactions de haine.<br />
La pièce annonce peut-être plus discrètem<strong>en</strong>t la composition complexe qui sera<br />
développée, notamm<strong>en</strong>t dans la pièce suivante, qui s’appelle « Rosas danst rosas » et un<br />
statut de l’interprétation qui différ<strong>en</strong>cie peut-être Anne Teresa de Keersmaeker de la<br />
froideur et de la distance qui peut apparaître parfois chez les post-modernes américains<br />
de cette même époque. Après le succès de « Fase », elle crée sa compagnie qu’elle<br />
appelle Rosas <strong>en</strong> 1983, où elle élabore « Rosas danst rosas », qui est un imm<strong>en</strong>se succès.<br />
En trois ans, elle va s’imposer comme une espèce de figure du proue de la nouvelle<br />
danse <strong>en</strong> Belgique. Son répertoire va s’<strong>en</strong>richir <strong>en</strong> 1984, d’une nouvelle création appelée<br />
« El<strong>en</strong>a’s aria ». Peu de g<strong>en</strong>s l’ont vue car elle a été jouée 20 ou 25 fois. Par contre, on<br />
connaît mieux le docum<strong>en</strong>taire de Marie André qui s’appelle « Répétitions », un film qui<br />
suit le travail de création, jusqu’à la veille de la première. C’est un film de danse sans<br />
danse, dans lequel on voit plutôt les questionnem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong>tre la chorégraphe et ses interprètes.<br />
Il révèle une question c<strong>en</strong>trale : Est-ce qu’il faut continuer dans une manière qui<br />
a contribué au succès foudroyant de cette chorégraphe ou bi<strong>en</strong> chercher d’autres voies<br />
artistiques ? C’est de toute évid<strong>en</strong>ce la deuxième solution qui sera choisie.<br />
Je vais proposer qu’on jette un premier regard sur le style, et de temps <strong>en</strong> temps, je vais<br />
avancer comme ça comme deux fils <strong>en</strong>trecroisés sur le plan biographique, ce qui vous<br />
permettra de garder des repères. Comme je l’ai dit <strong>en</strong> introduction, pour compr<strong>en</strong>dre<br />
comm<strong>en</strong>t est structurée cette œuvre, il faut sans arrêt rev<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> avant, <strong>en</strong> arrière. C’est<br />
un voyage assez particulier.<br />
Une grammaire de la danse.<br />
Cette journée est placée sous le terme de l’écriture,<br />
qui prés<strong>en</strong>te pour moi une analogie avec la<br />
langue et convoque aussi les termes de syntaxe et de grammaire. Une grammaire de la<br />
danse, ça pourrait compr<strong>en</strong>dre dans un premier temps une morphologie, c’est à dire une<br />
étude des formes et des structures, c’est à dire, ce qu’on pourrait danser « à la manière<br />
de » Keersmaeker. Incontestablem<strong>en</strong>t, il y a eu une évolution. Entre une phrase issue de<br />
« Rosas danst rosas », qui serait (il montre la phrase dansée), 1982, et une phrase de<br />
« Rain », <strong>en</strong> 2000 qui serait (il montre la phrase dansée), vous voyez que ce n’est pas du<br />
tout le même travail formel.<br />
Dans un second temps, cette grammaire pourrait inclure une syntaxe, c’est à dire un ag<strong>en</strong>cem<strong>en</strong>t<br />
de formes au sein de ces phrases corporelles. C’est ce que de Keersmaeker appelle<br />
des phrases de base. Basic phrase. Ce concept de phrases corporelles est<br />
absolum<strong>en</strong>t c<strong>en</strong>tral dans son processus artistique et conditionne, d’une certaine manière,<br />
toute son esthétique. Alors, qu’est-ce que c’est qu’une phrase de base ? C’est une<br />
séqu<strong>en</strong>ce de mouvem<strong>en</strong>ts qui est conçue comme un germe, comme une cellule<br />
originelle et qui se déploie dans l’œuvre toute <strong>en</strong>tière, <strong>en</strong> compositions savantes, comme<br />
si on avait une graine qui se développait de plus <strong>en</strong> plus. Pour repr<strong>en</strong>dre la phrase que je<br />
vous ai montrée, (il montre la phrase), la phrase de base de « Rosas danst rosas » est<br />
construite sur une base rythmique assez complexe, qui est une addition d’une mesure à<br />
huit temps, plus sept temps, plus six temps, plus cinq temps, plus quatre, plus trois, plus<br />
deux, plus un. Celle que j’ai montrée, si je la découpe rythmiquem<strong>en</strong>t, ça va donner :<br />
« 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,1, 2, 1 »,<br />
et ça repart à 8. Ça, c’est la phrase de base. Et là dedans, il y a des mom<strong>en</strong>ts où on va<br />
incruster quelque chose pour faire une variation, par exemple, je vais changer la mesure<br />
de 7. Et ça va donner : « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 », et je retombe sur mon 6,<br />
mon 5, mon 4, mon 3, mon 2, mon 1. Je peux <strong>en</strong>suite changer le 6 et le 5 par exemple.<br />
Donc je retrouve le 8, le 7, et là, je vais changer, et je retombe sur le 4, le 3, le 2, le 1. A<br />
partir de cette phrase, qui est une phrase relativem<strong>en</strong>t simple, je vais développer, varier,<br />
accumuler, qui sont aussi les principes de construction chorégraphique de toute la postmodern<br />
danse. Si vous regardez le travail de Trisha Brown, de Lucinda Childs, on retrouve<br />
ces principes là : déclinaison, répétition, déformation. Mais je p<strong>en</strong>se que l’analogie avec<br />
la linguistique finalem<strong>en</strong>t, l’idée que la danse serait un langage au s<strong>en</strong>s premier du<br />
terme, évidemm<strong>en</strong>t s’arrête là, parce que les formes dansées sont souv<strong>en</strong>t des formes<br />
abstraites, et n’ont pas vocation à dev<strong>en</strong>ir des langues.<br />
Mais le terme d’écriture du mouvem<strong>en</strong>t se manifeste aussi à travers des figures de<br />
composition. L’<strong>en</strong>semble de ces procédures finit par révéler un style, c’est à dire, ce que<br />
j’appelais tout à l’heure, ce qui assimile l’œuvre à son créateur, ou finalem<strong>en</strong>t, la<br />
78