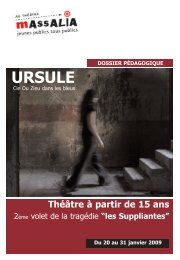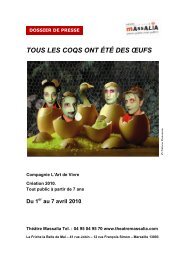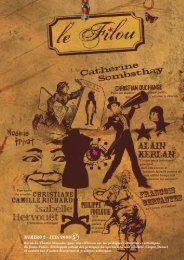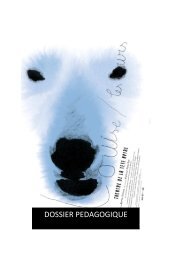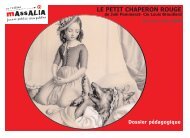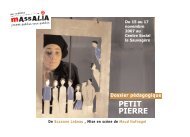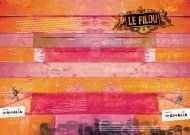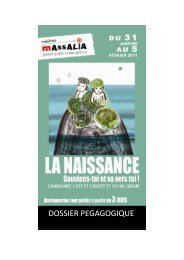Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’œuvre de Anne Teresa de Keersmaker par Philippe Guisgand<br />
un cinéaste et un compositeur.<br />
Je ne vais pas développer, parce que je vais vous inviter à lire ce qu’il y a dans le dossier.<br />
On a choisi cet article que j’avais écrit il y a quelques années pour une revue de cinéma,<br />
et non une revue de danse, qui s’appelle Vertigo, qui date de 2005, et dans laquelle j’ai<br />
essayé justem<strong>en</strong>t d’analyser tous ces rapports différ<strong>en</strong>ts. C’est au départ le film de<br />
Thierry de Mey sur un solo d’Anne Teresa, qui est <strong>en</strong> fait un peu le prétexte à essayer de<br />
dégager l’<strong>en</strong>semble des problématiques qui travers<strong>en</strong>t l’<strong>en</strong>semble de la danse et l’image.<br />
Vous pourrez prolonger la réflexion grâce à votre dossier.<br />
Quand même, sur l’image, j’<strong>en</strong> parle dans l’article, mais là, c’est quand même intéressant,<br />
c’est assez emblématique, je dois parler de la création qui s’appelle « Cantor’s phrases<br />
», qui n’est pas une création à proprem<strong>en</strong>t parler de Keersmaeker, mais qui est une<br />
sorte de réponse à au compositeur Pascal Dusapin, qui s’étonnait qu’on trouve normal<br />
de voir de la danse accompagnée de musique <strong>en</strong>registrée, et jamais l’inverse. En discutant<br />
de ça avec Thierry de Mey, ils ont, <strong>en</strong> 2004, choisi de faire l’inverse. Ils ont choisi de<br />
prés<strong>en</strong>ter, pour l’Ensemble Ictus qui était <strong>en</strong> concert, des films de danse qui défilai<strong>en</strong>t<br />
au-dessus de la tête des musici<strong>en</strong>s. Je vais vous <strong>en</strong> montrer un petit extrait. Là, pour le<br />
coup, on a de la musique vivante, mais de la danse <strong>en</strong>registrée. Vous allez voir l’image se<br />
difracter <strong>en</strong> deux ou trois écrans. Ils sont le quart de la taille de celui-ci <strong>en</strong> vérité. Quand<br />
vous voyez deux écrans, c’est à peu près de la taille de la grande image dans le<br />
processus. Les musici<strong>en</strong>s sont sur le plateau, et les trois écrans sont au-dessus de leurs<br />
têtes. Ce sont dix petits films qui accompagn<strong>en</strong>t dix morceaux de musique commandés<br />
spécialem<strong>en</strong>t à dix compositeurs contemporains.<br />
[Extrait de Cantor’s phrases]<br />
Keersmaeker n’est pas seulem<strong>en</strong>t une chorégraphe, même si elle a su, on l’a dit, s’<strong>en</strong>tourer<br />
de g<strong>en</strong>s très compét<strong>en</strong>ts dans le domaine musical, dans le domaine théâtral, dans la<br />
dramaturgie, ou même du point de vue cinématographique. C’est aussi quelqu’un qui a<br />
créé de nombreuses formes spectaculaires qui mêl<strong>en</strong>t les disciplines. Elle a fait de la<br />
mise <strong>en</strong> scène de théâtre, d’opéra. On se conc<strong>en</strong>tre sur la danse, mais c’est quelqu’un qui<br />
a une activité assez protéiforme, la musique, le chant, le cinéma. Et chacun de ces essais<br />
là, qui n’est pas forcém<strong>en</strong>t réussi d’ailleurs, je ne fais pas une apologie de Keersmaeker,<br />
dévoile une sorte d’espace d’articulation <strong>en</strong>tre ces élém<strong>en</strong>ts, ces disciplines, qui parfois<br />
ailleurs, peuv<strong>en</strong>t paraître de simples r<strong>en</strong>contres, de simples accolem<strong>en</strong>ts. Du même<br />
coup, c’est ce qui est difficile à faire quand on suit son travail, c’est que l’idée de la<br />
possibilité d’appréh<strong>en</strong>der chaque art séparém<strong>en</strong>t est repoussée un peu plus loin.<br />
Cette r<strong>en</strong>contre <strong>en</strong>tre les arts, c’est souv<strong>en</strong>t au spectateur, d’un point de vue esthétique,<br />
de désigner ce qui pourrait faire synthèse des arts chez elle. C’est une question que je<br />
continue à creuser précisém<strong>en</strong>t avec Jean-Luc Plouvier, à partir de ce questionnem<strong>en</strong>t<br />
qu’on a eu sur le rapport <strong>en</strong>tre texte et danse, parfois à la lueur de textes théorique d’un<br />
musicologue qui s’appelle François Nicolas. Je vous invite à le lire. Il génère des hypothèses<br />
sur cette question d’espace <strong>en</strong>tre les arts qui sont assez intéressantes. Je ne r<strong>en</strong>tre pas<br />
là-dedans, parce que c’est vraim<strong>en</strong>t théorique et que ça nous ferait sortir du sujet.<br />
Deuxième chose importante, mais qui va avec, c’est l’idée d’une danse comme espèce<br />
d’organisme, comme métabolisation des arts. C’est à dire, ça peut paraître un peu barbare,<br />
mais ça correspond aussi à la manière dont la chorégraphe dit appréh<strong>en</strong>der les<br />
matériaux qu’elle reti<strong>en</strong>t pour construire les pièces. Elle dit : « Je ress<strong>en</strong>s très souv<strong>en</strong>t les<br />
choses, et aussi le cont<strong>en</strong>u, sous une forme charnelle, matérielle ». Cette logique déjoue<br />
presque toujours les oppositions critiques qu’on peut lui faire, et qui se sont très<br />
souv<strong>en</strong>t arrêtées à une conception statique qui mettait Keersmaeker grosso modo à<br />
mi-chemin <strong>en</strong>tre la danse et le théâtre. Alors que précisém<strong>en</strong>t, je p<strong>en</strong>se que son problème,<br />
ce n’est pas de trouver ce point d’équilibre <strong>en</strong>tre la danse et le théâtre, mais plutôt<br />
d’être <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>ce dans une perception plus dynamique de l’équilibre où chacun<br />
des arts vi<strong>en</strong>t perturber l’autre, le questionner, et donc d’être plutôt dans une oscillation.<br />
Ce fonctionnem<strong>en</strong>t, pourquoi je le dis métabolique, c’est parce que parfois, et notamm<strong>en</strong>t<br />
dans ce dialogue danse/musique, on se retrouve avec des gestes qui sont des gestes de<br />
même nature. Le geste musical est aussi le geste du danseur. On voit cette gestuelle commune<br />
<strong>en</strong>tre la danse et la musique, dans « Quatuor n°4 », qui date de l’époque de<br />
« Mikrokosmos », mais <strong>en</strong>core <strong>en</strong> 1998 avec « Drumming », dont j’aimerais bi<strong>en</strong> vous passer<br />
un extrait. C’est souv<strong>en</strong>t particulièrem<strong>en</strong>t le cas, bon, là, cette pièce, c’est une musique<br />
de Steve Reich, qui est donc préexistante à la danse, mais c’est aussi le cas, chaque<br />
89