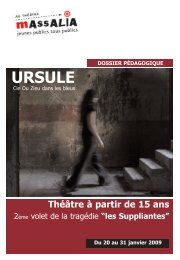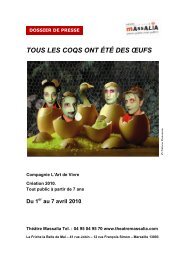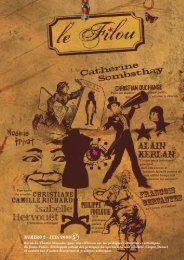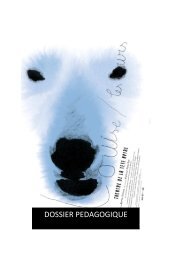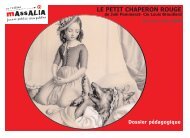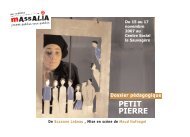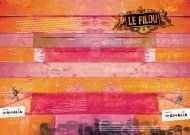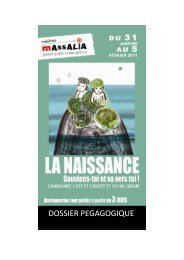Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’œuvre de Anne Teresa de Keersmaker par Philippe Guisgand<br />
à ce mom<strong>en</strong>t là, il y a peut-être un peu de cette relation musique-mouvem<strong>en</strong>t.<br />
Ce saut qu’on vi<strong>en</strong>t de voir, ou du moins, ces déclinaisons autour d’un saut, vi<strong>en</strong>t d’une<br />
manière dont Keersmaeker a cerné des registres moteurs spontanés qui étai<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>ts<br />
chez les hommes et chez les femmes. Ça peut paraître un peu contradictoire de dire ça<br />
quand on vous propose une pièce où apparemm<strong>en</strong>t, les rôles peuv<strong>en</strong>t être indifféremm<strong>en</strong>t<br />
t<strong>en</strong>us par des hommes ou par des femmes. Mais elle dit, au mom<strong>en</strong>t de « ERTS » : « La<br />
femme bouge avec la pesanteur, l’homme bouge contre ». L’homme, pour elle, avec sa<br />
prés<strong>en</strong>ce différ<strong>en</strong>te et sa motricité qui est quand même relativem<strong>en</strong>t inédite, elle n’a pas<br />
<strong>en</strong>core beaucoup travaillé avec des hommes, apparaît au départ dans « Mikrokosmos »,<br />
c’est à dire dans la création précéd<strong>en</strong>te. Il semble bi<strong>en</strong> qui la chorégraphe ait du mal à<br />
cerner la motricité de l’homme, si on <strong>en</strong> juge par la manière dont elle choisit, pour ce<br />
premier duo dans « Mikrokosmos », ses interprètes. Là, c’est Oliver Koch, mais au départ,<br />
à la création, c’était Jean-Luc Ducourt, ou Martin Kilvady, qui sont des danseurs très<br />
grands, et qui ont un air un peu dégingandé, parfois presque malhabile, notamm<strong>en</strong>t pour<br />
Jean-Luc Ducourt.<br />
Le saut apparaît avec l’arrivée des hommes dans la compagnie. Avant, dans les pièces<br />
précéd<strong>en</strong>tes, il n’y a vraim<strong>en</strong>t aucun rapport avec cette asc<strong>en</strong>sion verticale. Un saut qui<br />
va dev<strong>en</strong>ir typique : c’est un cloche-pied. On ne le voit pas ici parce qu’il est un peu<br />
différ<strong>en</strong>t, c’est vraim<strong>en</strong>t les premières images où on voit des susp<strong>en</strong>sions. Un clochepied<br />
qui est réalisé sur une jambe t<strong>en</strong>due, et avec l’autre jambe qui est retirée au g<strong>en</strong>ou<br />
ou à la cheville. Il est souv<strong>en</strong>t accompagné d’un port de bras <strong>en</strong> seconde qui l’équilibre<br />
et <strong>en</strong> même temps lui donne une composante esthétique horizontale. On peut même<br />
dire que ce saut, qui est fait des dizaines et des dizaines de fois dans la Grande Fugue,<br />
est véritablem<strong>en</strong>t emblématique de son style. Notamm<strong>en</strong>t dans cet ultime saut, qui vous<br />
voyez là, dans la Grande Fugue, c’est un saut sans retombée. Vous avez un saut à l’unisson<br />
des huit danseurs, et qui est saisi dans un cut au noir. C’est à dire que vous ne voyez<br />
pas les danseurs retomber. Ils s’<strong>en</strong>vol<strong>en</strong>t presque définitivem<strong>en</strong>t. Ça fait un peu p<strong>en</strong>ser<br />
à Nijinski dans « Le Spectre de la Rose », il s’<strong>en</strong>vole par la f<strong>en</strong>être, on ne voit pas la<br />
retombée du saut.<br />
Deuxième élém<strong>en</strong>t du style de cette époque, c’est<br />
le statut du sol, la manière dont Keersmaeker<br />
Le statut du sol.<br />
conçoit le rôle du sol, qui gagne <strong>en</strong> importance, et qui est toujours un dialogue, un<br />
travail dynamique <strong>en</strong>tre le corps et le sol. Le sol est une aide. C’est une surface qui va<br />
contribuer à tisser des li<strong>en</strong>s avec une danse qui devi<strong>en</strong>t une danse véritablem<strong>en</strong>t de<br />
dép<strong>en</strong>se. Un peu comme celle, à la même époque que propose un Lloyd Newson, un<br />
Edouard Lock au Canada, ou un Wim Vandekeybus aussi <strong>en</strong> Flandre. Mais chez<br />
Keersmaeker, la desc<strong>en</strong>te n’est jamais suivie d’une immobilité, comme c’est le cas chez<br />
Edouard Lock, ou d’une déflagration, comme c’est le cas chez Vandekeybus. Au contraire,<br />
c’est toujours une accélération qui permet de relancer le corps et qui lui permet de s’ériger,<br />
pour mieux rebondir à nouveau. On retrouve ce rôle du sol dans « Stella », dans<br />
« Achterland », dont vous voyez <strong>en</strong> haut une photo, ou dans « ERTS ».<br />
La troisième caractéristique qui est finalem<strong>en</strong>t une des caractéristiques majeures,<br />
prés<strong>en</strong>te dans toute l’œuvre, c’est évidemm<strong>en</strong>t le rapport amoureux à la musique. C’est<br />
un vaste sujet, que je ne vais faire qu’évoquer ici, tout simplem<strong>en</strong>t parce que je ne suis<br />
pas musici<strong>en</strong> de formation. Pour y répondre, j’ai comm<strong>en</strong>cé à travailler avec Jean-Luc<br />
Plouvier, qui est le directeur artistique d’Ictus, avec lequel on va publier la semaine prochaine,<br />
dans une revue que vous connaissez peut-être, qui est la revue Repères, éditée par<br />
la Bi<strong>en</strong>nale du Val de Marne, qui sort un numéro précisém<strong>en</strong>t sur « Musique et danse ».<br />
Donc là, on a essayé de creuser un peu la question. Ce qui est sûr, c’est que Keersmaeker,<br />
et là il n’y a pas besoin d’être musici<strong>en</strong> pour le dire, est allée vers des formes de musique<br />
assez variées, et presque maint<strong>en</strong>ant vers toutes les musiques. Elle a utilisé le<br />
Baroque, Purcell, Bach ; le Classique, avec Mozart, Beethov<strong>en</strong> ; la musique moderne,<br />
Berg, Schönberg, Webern, Bartók ; la musique contemporaine, Cage, Ligeti, Steve Reich,<br />
Thierry de Mey ; la musique d’opéra, Monteverdi ; la musique populaire, « Wants » est<br />
fait sur des chansons de Joan Baez ; le jazz, avec Miles Davis et John Coltrane ; ce qu’on<br />
appelle les musiques du monde, notamm<strong>en</strong>t les raga indi<strong>en</strong>s, dans une pièce plus<br />
réc<strong>en</strong>te qui s’appelle « Desh », créée <strong>en</strong> 2005.<br />
Qu’est-ce que c’est que cette relation à la musique ? Il y a des indices. Les premiers sont<br />
qu’il y a de nombreux titres de Rosas qui repr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t le nom des compositeurs, ou des<br />
partitions. « Fase », c’est le raccourci, mais le titre global, c’est « Fase, quatre mom<strong>en</strong>ts<br />
sur une musique de Steve Reich ». « Bartók annoté », « Woud, trois mom<strong>en</strong>ts sur une<br />
82