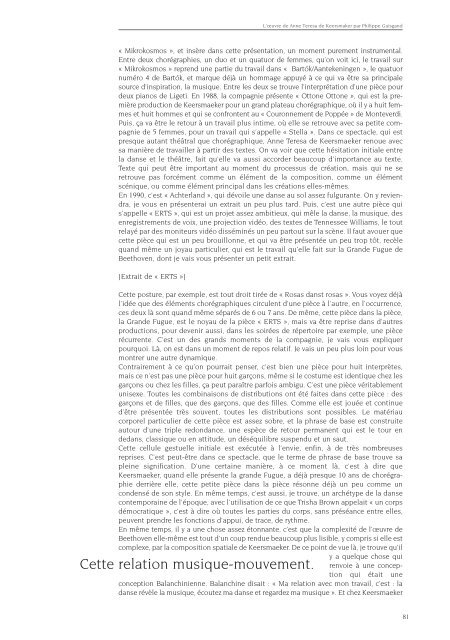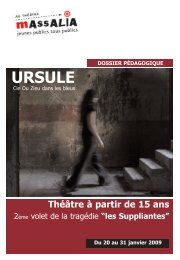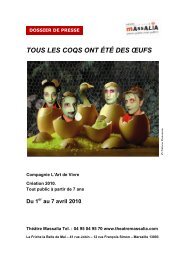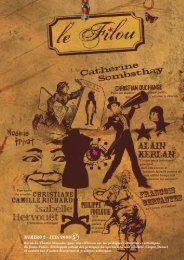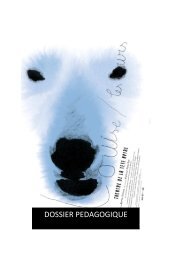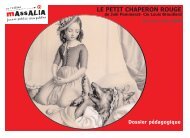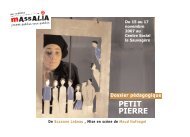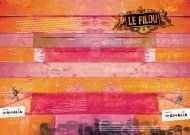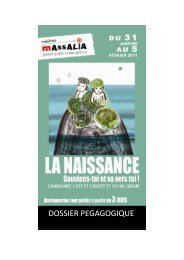Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’œuvre de Anne Teresa de Keersmaker par Philippe Guisgand<br />
« Mikrokosmos », et insère dans cette prés<strong>en</strong>tation, un mom<strong>en</strong>t purem<strong>en</strong>t instrum<strong>en</strong>tal.<br />
Entre deux chorégraphies, un duo et un quatuor de femmes, qu’on voit ici, le travail sur<br />
« Mikrokosmos » repr<strong>en</strong>d une partie du travail dans « Bartók/Aantek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> », le quatuor<br />
numéro 4 de Bartók, et marque déjà un hommage appuyé à ce qui va être sa principale<br />
source d’inspiration, la musique. Entre les deux se trouve l’interprétation d’une pièce pour<br />
deux pianos de Ligeti. En 1988, la compagnie prés<strong>en</strong>te « Ottone Ottone », qui est la première<br />
production de Keersmaeker pour un grand plateau chorégraphique, où il y a huit femmes<br />
et huit hommes et qui se confront<strong>en</strong>t au « Couronnem<strong>en</strong>t de Poppée » de Monteverdi.<br />
Puis, ça va être le retour à un travail plus intime, où elle se retrouve avec sa petite compagnie<br />
de 5 femmes, pour un travail qui s’appelle « Stella ». Dans ce spectacle, qui est<br />
presque autant théâtral que chorégraphique, Anne Teresa de Keersmaeker r<strong>en</strong>oue avec<br />
sa manière de travailler à partir des textes. On va voir que cette hésitation initiale <strong>en</strong>tre<br />
la danse et le théâtre, fait qu’elle va aussi accorder beaucoup d’importance au texte.<br />
Texte qui peut être important au mom<strong>en</strong>t du processus de création, mais qui ne se<br />
retrouve pas forcém<strong>en</strong>t comme un élém<strong>en</strong>t de la composition, comme un élém<strong>en</strong>t<br />
scénique, ou comme élém<strong>en</strong>t principal dans les créations elles-mêmes.<br />
En 1990, c’est « Achterland », qui dévoile une danse au sol assez fulgurante. On y revi<strong>en</strong>dra,<br />
je vous <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>terai un extrait un peu plus tard. Puis, c’est une autre pièce qui<br />
s’appelle « ERTS », qui est un projet assez ambitieux, qui mêle la danse, la musique, des<br />
<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>ts de voix, une projection vidéo, des textes de T<strong>en</strong>nessee Williams, le tout<br />
relayé par des moniteurs vidéo disséminés un peu partout sur la scène. Il faut avouer que<br />
cette pièce qui est un peu brouillonne, et qui va être prés<strong>en</strong>tée un peu trop tôt, recèle<br />
quand même un joyau particulier, qui est le travail qu’elle fait sur la Grande Fugue de<br />
Beethov<strong>en</strong>, dont je vais vous prés<strong>en</strong>ter un petit extrait.<br />
[Extrait de « ERTS »]<br />
Cette posture, par exemple, est tout droit tirée de « Rosas danst rosas ». Vous voyez déjà<br />
l’idée que des élém<strong>en</strong>ts chorégraphiques circul<strong>en</strong>t d’une pièce à l’autre, <strong>en</strong> l’occurr<strong>en</strong>ce,<br />
ces deux là sont quand même séparés de 6 ou 7 ans. De même, cette pièce dans la pièce,<br />
la Grande Fugue, est le noyau de la pièce « ERTS », mais va être reprise dans d’autres<br />
productions, pour dev<strong>en</strong>ir aussi, dans les soirées de répertoire par exemple, une pièce<br />
récurr<strong>en</strong>te. C’est un des grands mom<strong>en</strong>ts de la compagnie, je vais vous expliquer<br />
pourquoi. Là, on est dans un mom<strong>en</strong>t de repos relatif. Je vais un peu plus loin pour vous<br />
montrer une autre dynamique.<br />
Contrairem<strong>en</strong>t à ce qu’on pourrait p<strong>en</strong>ser, c’est bi<strong>en</strong> une pièce pour huit interprètes,<br />
mais ce n’est pas une pièce pour huit garçons, même si le costume est id<strong>en</strong>tique chez les<br />
garçons ou chez les filles, ça peut paraître parfois ambigu. C’est une pièce véritablem<strong>en</strong>t<br />
unisexe. Toutes les combinaisons de distributions ont été faites dans cette pièce : des<br />
garçons et de filles, que des garçons, que des filles. Comme elle est jouée et continue<br />
d’être prés<strong>en</strong>tée très souv<strong>en</strong>t, toutes les distributions sont possibles. Le matériau<br />
corporel particulier de cette pièce est assez sobre, et la phrase de base est construite<br />
autour d’une triple redondance, une espèce de retour perman<strong>en</strong>t qui est le tour <strong>en</strong><br />
dedans, classique ou <strong>en</strong> attitude, un déséquilibre susp<strong>en</strong>du et un saut.<br />
Cette cellule gestuelle initiale est exécutée à l’<strong>en</strong>vie, <strong>en</strong>fin, à de très nombreuses<br />
reprises. C’est peut-être dans ce spectacle, que le terme de phrase de base trouve sa<br />
pleine signification. D’une certaine manière, à ce mom<strong>en</strong>t là, c’est à dire que<br />
Keersmaeker, quand elle prés<strong>en</strong>te la grande Fugue, a déjà presque 10 ans de chorégraphie<br />
derrière elle, cette petite pièce dans la pièce résonne déjà un peu comme un<br />
cond<strong>en</strong>sé de son style. En même temps, c’est aussi, je trouve, un archétype de la danse<br />
contemporaine de l’époque, avec l’utilisation de ce que Trisha Brown appelait « un corps<br />
démocratique », c’est à dire où toutes les parties du corps, sans préséance <strong>en</strong>tre elles,<br />
peuv<strong>en</strong>t pr<strong>en</strong>dre les fonctions d’appui, de trace, de rythme.<br />
En même temps, il y a une chose assez étonnante, c’est que la complexité de l’œuvre de<br />
Beethov<strong>en</strong> elle-même est tout d’un coup r<strong>en</strong>due beaucoup plus lisible, y compris si elle est<br />
complexe, par la composition spatiale de Keersmaeker. De ce point de vue là, je trouve qu’il<br />
y a quelque chose qui<br />
r<strong>en</strong>voie à une conception<br />
qui était une<br />
conception Balanchini<strong>en</strong>ne. Balanchine disait : « Ma relation avec mon travail, c’est : la<br />
danse révèle la musique, écoutez ma danse et regardez ma musique ». Et chez Keersmaeker<br />
Cette relation musique-mouvem<strong>en</strong>t.<br />
81