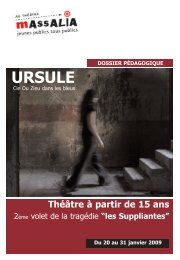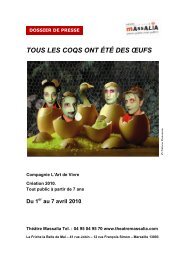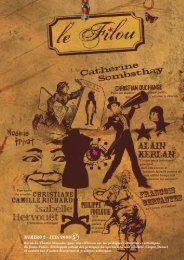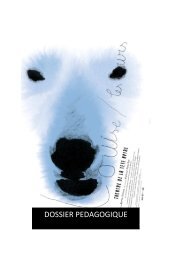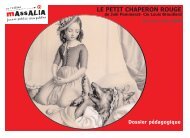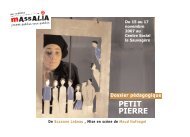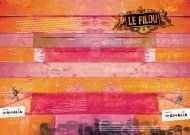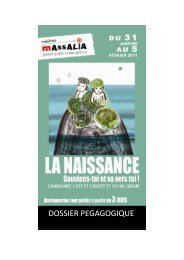Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
“Déroutes” de Mathilde Monnier par Gérard May<strong>en</strong><br />
sommes devant une cage de scène. Pour avancer un peu plus dans cette idée, là, je vais<br />
changer de cassette.<br />
J’<strong>en</strong> profite pour faire une petite leçon générale. Soyez toujours vigilants sur les supports<br />
au travers lesquels vous abordez le monde. Toute image est déjà une production, c’est déjà<br />
tout un travail. Vous allez compr<strong>en</strong>dre ce que je vi<strong>en</strong>s de dire. Nous v<strong>en</strong>ons de voir le travail<br />
d’une vidéaste de danse, de r<strong>en</strong>om, reconnue professionnellem<strong>en</strong>t, qu’on connaît.<br />
Pour ma part, je dirais qu’elle s’est beaucoup attachée au figural, aux personnages. Je<br />
p<strong>en</strong>se qu’ on peut parler de personnages dans cette pièce, mais pas au s<strong>en</strong>s<br />
théâtral classique, pas au s<strong>en</strong>s de l’anecdote ou d’un déroulem<strong>en</strong>t dramaturgique narratif.<br />
Néanmoins, elle s’est beaucoup fixée sur l’action, si j’ose dire. C’est manifeste. Ça a été<br />
capté <strong>en</strong> février 2003 à la salle du Corum, de l’Opéra Berlioz à Montpellier. Le plateau a des<br />
caractéristiques conv<strong>en</strong>tionnelles. C’est un très grand et magnifique plateau. Mais la pièce<br />
n’avait pas été créée là. Elle avait été créée à G<strong>en</strong>nevilliers. Dans cette salle<br />
précisém<strong>en</strong>t, il y a une caractéristique toute particulière. Je vous laisse regarder et saisir ça.<br />
Cette cassette là, c’est une prise de vue de travail, qui n’a pas vocation à être diffusée. Ce<br />
que je vous ai montré avant, c’est plutôt ce qu’on destine aux diffuseurs, aux programmateurs.<br />
Ça doit être attirant à l’œil, ça doit être léché, attractif. Là, c’est un travail brut,<br />
fait depuis la régie <strong>en</strong> situation de générale, sans public. C’est une captation. Il y a une<br />
caméra tout <strong>en</strong> haut. C’est un plan fixe. On n’a pas de mouvem<strong>en</strong>ts de caméra. C’est vu<br />
de loin. On n’y voit pas grand chose, sauf peut-être des élém<strong>en</strong>ts ess<strong>en</strong>tiels qu’on n’a pas<br />
vus, ou beaucoup moins, dans la première cassette, élém<strong>en</strong>ts qui ont trait à la question<br />
de l’espace.<br />
Comme je disais, à G<strong>en</strong>nevilliers, c’est particulier parce que la scène dispose d’une<br />
arrière-scène qui est carrém<strong>en</strong>t un second théâtre, <strong>en</strong> temps normal. C’est un théâtre<br />
d’essai. On y met des gradins, on peut produire des pièces. C’est un rapport scénique<br />
totalem<strong>en</strong>t inhabituel. On a un plateau d’une très grande profondeur. Un rapport largeur/profondeur<br />
qui est à peu près deux fois et demie supérieur au rapport habituel. Ça<br />
n’est pas neutre. On n’a pas choisi ce plateau parce qu’on ne savait pas où aller et que<br />
celui-ci était libre. C’est éminemm<strong>en</strong>t choisi. Je caractérise ça comme un gouffre d’horizontalité.<br />
Au lieu d’être vertical. En tout cas, ça opère une sorte de dégagem<strong>en</strong>t. C’est un<br />
plateau qu’on pourrait qualifier de paysage. Qu’est-ce que j’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ds par paysage par rapport<br />
à un plateau, une cage scénique classiquem<strong>en</strong>t ordonné ? C’est qu’il est d’emblée<br />
plus ouvert, plus déployé, avec des lignes qui échapp<strong>en</strong>t, avec une manière dont le<br />
regard est obligé de se prom<strong>en</strong>er selon ses propres critères depuis le devant de scène, à<br />
plus profondém<strong>en</strong>t, à plus loin etc. Le regard est sans doute beaucoup moins cadré,<br />
conduit, que dans un dispositif scénique habituel. Ça ti<strong>en</strong>t aussi à la nature de l’action,<br />
à la manière dont est composée l’évolution de la pièce. On va y rev<strong>en</strong>ir. Mais on a d’emblée<br />
la s<strong>en</strong>sation d’un plateau paysage, avec cette possibilité pour l’œil d’aller soit dans<br />
le général, soit dans le détail, soit dans le proche, soit dans le lointain. Une liberté est<br />
laissée au spectateur. Liberté qui peut être extrêmem<strong>en</strong>t perturbante. Elle n’est pas forcém<strong>en</strong>t<br />
un gage de confort. Ret<strong>en</strong>ez que ça n’est à aucun mom<strong>en</strong>t une pièce qui emballe,<br />
qui séduit, qui emporte son monde, qui conduit le regard d’une manière évid<strong>en</strong>te. Voici<br />
la première caractéristique.<br />
Il y <strong>en</strong> a une seconde qui est aussi ess<strong>en</strong>tielle, on y revi<strong>en</strong>dra. Vous devez remarquer des<br />
élém<strong>en</strong>ts de ce type : des panneaux métalliques, des perches métalliques, des portiques,<br />
des cadres. Je passe sur ce qu’ils peuv<strong>en</strong>t signifier, symboliser, quel type de rapport au<br />
monde, ça a été spécifié, dans le rapport au quotidi<strong>en</strong>. La plupart sont difficiles à définir,<br />
ainsi que leur fonction év<strong>en</strong>tuelle dans le quotidi<strong>en</strong>. C’est difficile de les ram<strong>en</strong>er à un<br />
usage évid<strong>en</strong>t dans le quotidi<strong>en</strong>. On va s’intéresser à un des élém<strong>en</strong>ts les plus manifestes,<br />
c’est qu’ils formerai<strong>en</strong>t presque comme un second cadre de scène. On aurait le cadre<br />
que ferait le bâtim<strong>en</strong>t lui-même, les structures <strong>en</strong> béton. Et puis on aurait là une espèce<br />
d’<strong>en</strong>ceinte, de pourtour de scène, tracé, poreux, qui laisserait de nombreuses ouvertures,<br />
qui serait inconstant, qui va parfaitem<strong>en</strong>t dans la lignée mais qui néanmoins structure,<br />
vi<strong>en</strong>t poser un second cadre.<br />
Ça nous amène à une troisième caractéristique, regardez bi<strong>en</strong> d’où provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t les<br />
personnages, les interprètes pardon, comm<strong>en</strong>t ils font leurs apparitions ou au contraire,<br />
comm<strong>en</strong>t ils quitt<strong>en</strong>t le plateau. On a neuf points d’<strong>en</strong>trée et de sortie. C’est une caractéristique<br />
qui n’est pas des plus courantes, d’autant qu’ils sembl<strong>en</strong>t guidés par un pur<br />
aléatoire. Ri<strong>en</strong> ne semble être imposé par une hiérarchie évid<strong>en</strong>te, un déroulé évid<strong>en</strong>t de<br />
la représ<strong>en</strong>tation, qui va faire qu’on att<strong>en</strong>d l’<strong>en</strong>trée ou la sortie de tel ou tel interprète<br />
98