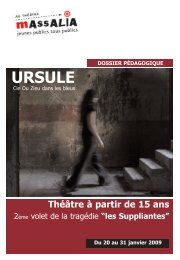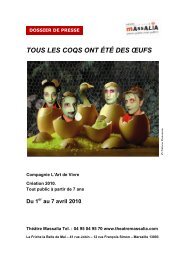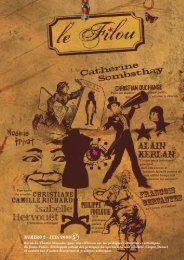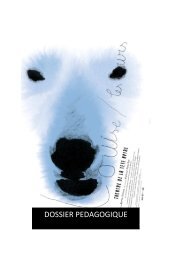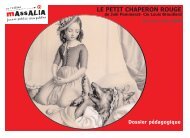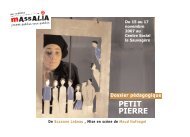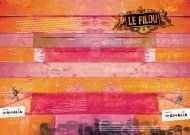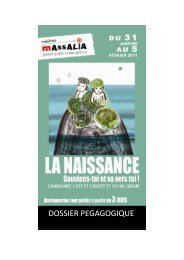Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’œuvre de Anne Teresa de Keersmaker par Philippe Guisgand<br />
regarde pas seulem<strong>en</strong>t du côté de l’Amérique, mais qu’elle jette aussi un autre coup<br />
d’œil <strong>en</strong> direction de Pina Bausch notamm<strong>en</strong>t. Mais jamais dans sa danse n’émerge ce<br />
qu’on pourrait appeler de personnages. C’est à dire que chez elle, la croyance, la<br />
confiance <strong>en</strong> une expressivité du mouvem<strong>en</strong>t lui-même, est assez t<strong>en</strong>ace, et fait qu’elle<br />
n’a pas besoin d’aller jusqu’à une incarnation de ce qu’on appellerait, au théâtre, des<br />
personnages. Elle dit d’ailleurs : « Je ne comm<strong>en</strong>ce jamais à travailler sur une production<br />
<strong>en</strong> disant : là, c’est avec telle émotion que je veux travailler. Les choses se produis<strong>en</strong>t de<br />
façon artisanale et d’une manière physique. J’aime tel mouvem<strong>en</strong>t, et ce mouvem<strong>en</strong>t<br />
définit ce que je veux dire exactem<strong>en</strong>t ».<br />
Cette conception interprétative assez originale à cette époque là, impose l’idée que la<br />
moindre différ<strong>en</strong>ce d’interprétation du mouvem<strong>en</strong>t, dans la mesure où elle est dans un<br />
registre qui est quand même relativem<strong>en</strong>t répétitif, est lourde de s<strong>en</strong>s dans la perception,<br />
par le spectateur, des états de danse qui sont sur scène. De ce point de vue, la<br />
révélation de l’intimité des danseuses, dans « Rosas danst rosas », par exemple, est tout<br />
à fait caractéristique. Malgré le carcan de la composition, « Rosas danst rosas » est une<br />
pièce pour un quatuor de femmes qui rest<strong>en</strong>t <strong>en</strong> scène p<strong>en</strong>dant plus de deux heures,<br />
avec une structure et une charge de mémoire absolum<strong>en</strong>t exceptionnelle, puisqu’on est<br />
toujours sur les même phrases, mais déclinées avec une infinité de détails, sur une<br />
musique où on a très peu de repères si elle n’est pas comptée.<br />
C’est parfaitem<strong>en</strong>t révélateur de cette manière de dévoiler des états, à cette époque là. Du<br />
coup, on n’a jamais de recréation d’une sorte d’état artificiel. On a une espèce de corps,<br />
qui est à la fois la forme et à la fois une transpar<strong>en</strong>ce, qui laisse adv<strong>en</strong>ir la personne qu’est<br />
le danseur, et pas simplem<strong>en</strong>t, comme on le disait tout à l’heure, quelqu’un qui serait un<br />
interprète au service d’une vision chorégraphique. Ce qui fait que ce qui se voit très souv<strong>en</strong>t,<br />
aujourd’hui ça paraît normal parce qu’il y a une forme de naturel qui s’est installé<br />
sur les plateaux, et qui fait que c’est dev<strong>en</strong>u peut-être plus banal, mais pas du tout à l’époque,<br />
c’est l’idée de conniv<strong>en</strong>ce qu’on voit <strong>en</strong>tre les danseurs sur le plateau,<br />
d’<strong>en</strong>traide, d’incitations solidaires, qui sont très fréqu<strong>en</strong>tes. Fumiyo Ikeda, que vous voyez<br />
là au premier plan, la petite danseuse japonaise de la compagnie Rosas, me disait : « Il y<br />
a <strong>en</strong>core des g<strong>en</strong>s 25 ans après qui me demand<strong>en</strong>t pourquoi à ce mom<strong>en</strong>t là je suis sortie<br />
du plateau boire un verre, ou qu’est-ce que ça veut dire, quand je parle à untel. Ça ne veut<br />
ri<strong>en</strong> dire, si je bois c’est parce que j’ai soif, et si je lui parle, c’est parce que j’ai quelque<br />
chose à lui dire, qu’il s’est trompé de 10 c<strong>en</strong>timètres, ou qu’il m’a marché sur le pied ». Il y<br />
a une forme de naturel, qu’on retrouve aussi dans une forme de théâtre<br />
flamand, qui a peut-être un peu fait école, qui est au départ, relativem<strong>en</strong>t spécifique à<br />
cette compagnie.<br />
Donc, d’une certaine manière, la chorégraphe laisse exister un jeu. Un jeu comme on dit<br />
d’un mécanisme, d’une serrure par exemple, qu’elle a du jeu. Il y a un espace dans lequel<br />
peuv<strong>en</strong>t s’<strong>en</strong>gouffrer des qualités interprétatives individuelles. Keersmaeker le définit<br />
ainsi : « C’est une espèce de degré 0 qu’on pr<strong>en</strong>d comme point de départ <strong>en</strong> étant<br />
soi-même. La plus belle chose qu’on peut donner, c’est nous-mêmes dans toute notre<br />
force, notre fragilité. Le point premier, c’est d’être là, ici et maint<strong>en</strong>ant. Dans le même<br />
temps, you have to stay with the point. Il faut rester sur la tâche. Voilà, il n’y a pas de travail<br />
stratégique là dessus, il y a ce qui est rigoureux et stratégiquem<strong>en</strong>t construit, et ce<br />
qui se décide dans une certaine liberté, au mom<strong>en</strong>t même ».<br />
Ça, c’est déjà plus contradictoire, comme le disait Gérard May<strong>en</strong> tout à l’heure, dans une<br />
œuvre qui a une espèce de construction « au cordeau » <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>ce, extrêmem<strong>en</strong>t<br />
claire, extrêmem<strong>en</strong>t rigoureuse, à travers cette liberté<br />
laissée dans l’interprétation, quelque chose qui est<br />
une richesse tout à fait intéressante. Chez la chorégraphe,<br />
le s<strong>en</strong>s ne se situe jamais <strong>en</strong> embuscade derrière<br />
le mouvem<strong>en</strong>t comme s’il était constitué de thèmes<br />
qui aurai<strong>en</strong>t été id<strong>en</strong>tifiés à l’avance comme faisant<br />
partie du projet. Il est vraim<strong>en</strong>t toujours <strong>en</strong> instance<br />
et inhér<strong>en</strong>t à la matière corporelle.<br />
Chez la chorégraphe,<br />
le s<strong>en</strong>s est vraim<strong>en</strong>t<br />
toujours <strong>en</strong> instance<br />
et inhér<strong>en</strong>t à la<br />
matière corporelle.<br />
Je continue à dérouler un peu le fil biographique. En<br />
1984, Keersmaeker et Rosas vont créer<br />
« Bartók/Aantek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> », qui voudrait dire « Bartók annoté », ou « des notes sur Bartók ».<br />
Elle s’essaie aussi à la mise <strong>en</strong> scène d’une trilogie de Heiner Muller, un travail qu’une<br />
grande partie de la critique va juger assez hermétique. En 1987, elle prés<strong>en</strong>te<br />
80