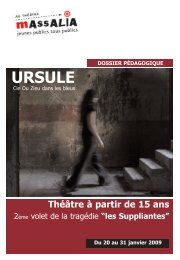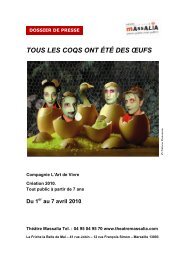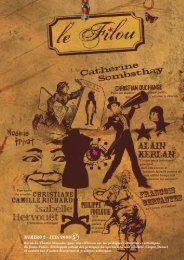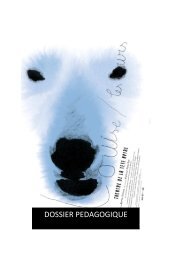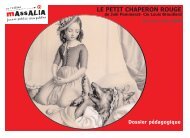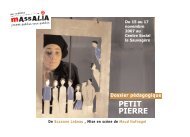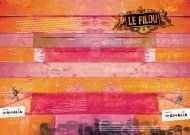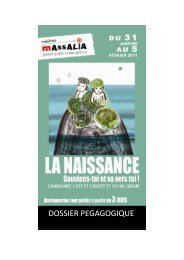Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’écriture au théâtre jeune public - Emerg<strong>en</strong>ce d’un nouveau langage ou nouveau rapport au public ? (1ère partie)<br />
m<strong>en</strong>t, tant que le théâtre n’a pas quelque chose à dire, on ne risque pas de trouver une<br />
trace de ce qu’il veut dire. C’était particulièrem<strong>en</strong>t vrai dans le domaine du théâtre pour<br />
l’<strong>en</strong>fance et la jeunesse, parce que c’était intimem<strong>en</strong>t lié à la manière dont on considère<br />
l’<strong>en</strong>fant. Le considère-t-on pour ce qu’il est ou pour ce qu’on croit qu’il est ? C’est une<br />
question c<strong>en</strong>trale par rapport à ce qui nous occupe.<br />
On peut faire le parallèle avec la littérature jeunesse. Il semblerait erroné de dissocier<br />
l’apparition du répertoire du théâtre jeune public de l’apparition de la littérature jeunesse,<br />
mais on voit ça s’est fait dans des mom<strong>en</strong>ts différ<strong>en</strong>ts. Parce que si la littérature<br />
de jeunesse est apparue au 18ème siècle, elle est apparue comme une littérature de<br />
substitution. Elle est apparue parce que l’on considérait que l’<strong>en</strong>fant n’était pas capable<br />
d’accéder au livre, d’accéder au texte, à la littérature. Par conséqu<strong>en</strong>t, il s’agissait d’une<br />
littérature qui naissait d’une c<strong>en</strong>sure, d’un interdit. Donc, est apparue une littérature de<br />
seconde main, avec des émotions de seconde main, une sorte de para littérature. On le<br />
verra <strong>en</strong>core beaucoup plus tard, au 20ème siècle, au mom<strong>en</strong>t de l’apparition d’une littérature<br />
de jeunesse, mais aussi à la fin du 19ème, avec des contes édulcorés.<br />
Cette littérature là, au lieu d’être écrite par les écrivains qui faisai<strong>en</strong>t la littérature du<br />
mom<strong>en</strong>t, était écrite par des spécialistes. Mais des spécialistes de quoi ? Est-ce que<br />
c’étai<strong>en</strong>t des spécialistes de l’empêchem<strong>en</strong>t d’accéder à la littérature ? Des spécialistes<br />
de la compréh<strong>en</strong>sion ? Il s’opérait une pré-digestion de ce qu’il fallait compr<strong>en</strong>dre, et<br />
donc pour avoir accès à la littérature et au texte, il fallait faire une sous-littérature d’accès<br />
? Une sorte de littérature intermédiaire, une sorte de para-pharmacie ? Comme je l’ai<br />
Ça ressemble à du théâtre, ça a le goût du théâtre,<br />
mais ce n’est pas du théâtre.<br />
dit parfois du théâtre, une para-pharmacie du théâtre ? Ça ressemble à du théâtre, ça a<br />
le goût du théâtre, mais ce n’est pas du théâtre. On était dans cette question de la spécialisation,<br />
qui fait qu’on a eu p<strong>en</strong>dant tout un temps des textes dont on pouvait p<strong>en</strong>ser,<br />
dont on disait aussi, et certains pédagogues de la lecture le disai<strong>en</strong>t, que c’étai<strong>en</strong>t<br />
plutôt des textes pour appr<strong>en</strong>dre à lire plutôt qu’une littérature qui permettait d’accéder<br />
à la lecture. Comme si lire, c’était uniquem<strong>en</strong>t déchiffrer des sons, et non pas accéder<br />
au s<strong>en</strong>s.<br />
Je ne vais pas marcher sur les territoires de Patrick B<strong>en</strong> Soussan, mais Bruno Bettelheim<br />
a dit là dessus des choses très pertin<strong>en</strong>tes. On sait très bi<strong>en</strong> qu’un <strong>en</strong>fant va accéder<br />
d’autant plus facilem<strong>en</strong>t au s<strong>en</strong>s, et va accéder d’autant plus facilem<strong>en</strong>t à la lecture qu’il<br />
va avoir sous les yeux, des textes qui vont le faire rêver, des textes qui vont le faire imaginer,<br />
qui vont l’interroger, parce qu’il n’aura de cesse de vouloir aller plus loin pour<br />
trouver le s<strong>en</strong>s. On voit bi<strong>en</strong> qu’on peut avoir des littératures écrans, qui empêch<strong>en</strong>t<br />
finalem<strong>en</strong>t d’accéder au s<strong>en</strong>s. Or, la question c<strong>en</strong>trale c’est : comm<strong>en</strong>t accéder au s<strong>en</strong>s,<br />
si ce qui est écrit n’<strong>en</strong> a pas ?<br />
Donc le théâtre pour <strong>en</strong>fants n’a pas échappé à ce phénomène là, avec un décalage dans<br />
le temps. Pourquoi ? Parce que, dans un premier temps, le théâtre jeune public qui<br />
apparaissait était un théâtre pour les <strong>en</strong>fants, avec la préposition « pour », préposition<br />
de la prescription, alors qu’avec le « de », et le « et », le théâtre de l’<strong>en</strong>fance, ou le théâtre<br />
et l’<strong>en</strong>fance, le s<strong>en</strong>s est différ<strong>en</strong>t. Cela valait aussi pour la littérature, la littérature<br />
qui nous accompagne à ce mom<strong>en</strong>t là de la vie. Avec le pour, il y une prescription un<br />
petit peu réductrice.<br />
Donc le théâtre jeune public dans son apparition réc<strong>en</strong>te était au départ exclu du théâtre.<br />
Pourquoi ? Parce que, fondam<strong>en</strong>talem<strong>en</strong>t, il n’avait pas de textes. Il n’avait pas de<br />
textes parce qu’il n’avait pas d’auteurs. Il n’avait pas d’auteurs parce qu’il n’avait pas<br />
d’éditeurs, pas d’édition. Par conséqu<strong>en</strong>t, on était dans une émerg<strong>en</strong>ce un peu chaotique<br />
qui ne permettait pas d’intégrer le théâtre jeune public dans la famille du théâtre.<br />
Or, les évolutions du théâtre jeune public au 20ème siècle, font <strong>en</strong> réalité, si on l’examine<br />
de près, tout à fait <strong>en</strong> écho à l’évolution du théâtre tout court, et que ceux qui ont<br />
marqué l’histoire du théâtre du 20ème siècle, de Copeau, Dullin, Gaston Baty, à Vilar,<br />
(qui <strong>en</strong> 1969 à Avignon pose la question du théâtre des <strong>en</strong>fants), et plus tard, Vitez, à<br />
Chaillot, (avec l’expéri<strong>en</strong>ce du Théâtre National des <strong>en</strong>fants), de Jack Lang, mais aussi<br />
avec Catherine Dasté, et la déc<strong>en</strong>tralisation, dans la tradition de son père (fille de Jean<br />
Dasté, petite fille de Jacques Copeau), mais aussi avec des auteurs et des metteurs <strong>en</strong><br />
scène comme Bruno Castaing, Françoise Pillet, Maurice Y<strong>en</strong>dt, Miguel Demuynck et le<br />
116