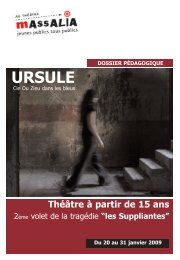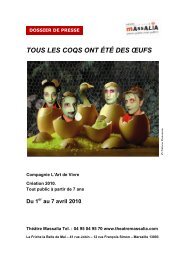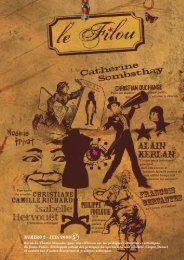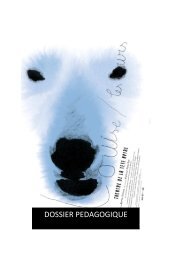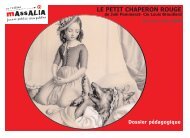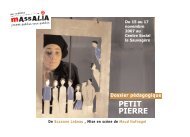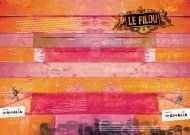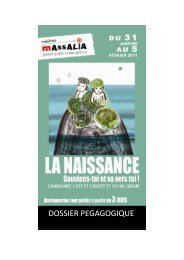Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ecriture et notation musicales : L’écriture et l’espace - Confér<strong>en</strong>ce-concert de Nicolas Frize<br />
la question de l’altérité, de l’étranger. Je me disais, avant de traiter ce sujet… Vous savez,<br />
souv<strong>en</strong>t les artistes, les compositeurs ont un sujet, et ils se docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t ou pas, et ils<br />
trait<strong>en</strong>t leur sujet. Ils amèn<strong>en</strong>t l’œuvre, la partition finie, que ce soit un texte, une musique,<br />
quoi que ce soit, ils l’amèn<strong>en</strong>t finie, comme étant leur façon à eux de traiter de ce<br />
sujet.<br />
Pour ce projet, j’ai trouvé intéressant que ce ne soit pas moi qui décide de comm<strong>en</strong>t on<br />
parle du sujet, mais que ce soi<strong>en</strong>t les g<strong>en</strong>s qui particip<strong>en</strong>t au travail musical qui<br />
anticip<strong>en</strong>t la réflexion sur le sujet. Ça s’appelait « êtres ». C’était une réflexion sur<br />
l’étranger. J’ai été voir des universitaires : un psychanalyste, un philosophe, un histori<strong>en</strong>,<br />
un anthropologue, un sociologue, des g<strong>en</strong>s de plusieurs disciplines, <strong>en</strong> me disant que<br />
cette question de l’étranger, si on la pr<strong>en</strong>d pas par tous les bouts, on la pr<strong>en</strong>d par aucun<br />
bout. C’est à dire que si on pr<strong>en</strong>d uniquem<strong>en</strong>t du côté de l’histoire et de la colonisation,<br />
on va expliquer des comportem<strong>en</strong>ts collectifs, on va expliquer comm<strong>en</strong>t le racisme était<br />
un racisme d’Etat au mom<strong>en</strong>t de la Troisième République, mais ça ne va pas nous dire<br />
pourquoi, nous, aujourd’hui, on est raciste. Ça va nous expliquer des choses, mais ça ne<br />
va pas tout nous dire.<br />
Si on va voir un psychanalyste et qu’il nous explique comm<strong>en</strong>t se constitue la figure de<br />
l’altérité, après l’accouchem<strong>en</strong>t, au mom<strong>en</strong>t où on doit se séparer du corps de la mère et<br />
accepter que le corps de la mère soit un corps distinct du notre, parce qu’au début,<br />
l’<strong>en</strong>fant p<strong>en</strong>se que le corps de la mère et le si<strong>en</strong> sont confondus. Il y a un mom<strong>en</strong>t où il<br />
y a une séparation, et cette séparation constitue la figure de l’altérité. C’est une<br />
souffrance, et il doit accepter cette séparation. Elle va lui causer des soucis jusqu’à sa<br />
mort. Ce qui va faire rev<strong>en</strong>ir le psychanalyste plus tard ! Je me disais que c’était<br />
important de voir comm<strong>en</strong>t se constitue la figure de l’autre, la figure sexuée <strong>en</strong> plus.<br />
Et puis le philosophe lui, apporte des considérations très différ<strong>en</strong>tes sur la question de<br />
l’altérité. Sur « qui suis-je ? », « qui suis moi ?», pourquoi je poursuis le même ? Et pourquoi<br />
l’autre est important ? Parce que c’est lui qui dit que je suis. Et toute une réflexion<br />
sur le miroir etc…<br />
Et puis le sociologue, lui, va parler de communauté, de communautarisme, de la façon<br />
dont on se constitue <strong>en</strong> tant que communauté, <strong>en</strong>tre g<strong>en</strong>s, qui sont mystérieusem<strong>en</strong>t<br />
parfois du même coin. Par exemple, vous avez deux personnes qui n’<strong>en</strong> ont ri<strong>en</strong> à faire<br />
de l’autre, qui sont dans un café. Et puis, par hasard, il y <strong>en</strong> a un qui dit qu’il est né à<br />
Plougastel. « C’est pas vrai, vous êtes nés à Plougastel ? Moi aussi ». Et là, ils sont<br />
copains, ils se serv<strong>en</strong>t des Calva. C’est à dire, c’est comme si le fait d’être nés au même<br />
<strong>en</strong>droit, ça nous soudait à jamais. Il y a comme ça une hystérie de la racine, une hystérie<br />
de l’origine, de « d’où je vi<strong>en</strong>s », qui est l’<strong>en</strong>droit où sont <strong>en</strong>terrés nos morts, qui nous<br />
constitue et qui est assez invraisemblable, avec cette course à l’id<strong>en</strong>tité dans laquelle on<br />
nous embarque, et qu’on croit être juste. Comme si l’id<strong>en</strong>tité, c’était le passé, comme si<br />
c’était la culture ou l’éducation de nos arrières, arrières grands-par<strong>en</strong>ts, comme si ça<br />
n’était pas aussi ce que nous avons traversé et surtout ce qu’on va dev<strong>en</strong>ir. Comme si ça<br />
n’était pas le tout, et que le tout, ce sont des imbrications assez compliquées <strong>en</strong>tre tous<br />
ces facteurs, qui sont des facteurs économiques, matériels, psychanalytiques,<br />
philosophiques, anthropologiques, sociologiques etc…<br />
Ces universitaires nous ont donc emm<strong>en</strong>é des étudiants et on a monté le projet dans 6<br />
villes successives. A Font<strong>en</strong>ay sous Bois, à Saint-Ou<strong>en</strong>, à Vill<strong>en</strong>euve la Gar<strong>en</strong>ne, etc…<br />
Dans chacune des villes, il y avait un groupe d’à peu près 100 personnes qui avai<strong>en</strong>t<br />
décidé de faire la création et qui p<strong>en</strong>dant 6 mois se sont réunis dans des séminaires,<br />
pour échanger sur leur façon de p<strong>en</strong>ser ces questions. On a donc <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du tout ce qu’on<br />
p<strong>en</strong>se nous-mêmes, tout ce qu’on <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d dans les cafés, ou ce qu’on <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d dans les<br />
dîners qu’on fait chez nous, tout ce qu’on dit <strong>en</strong>semble sur ces questions qui sont des<br />
questions difficiles, et ce ne sont pas les autres. C’est pas les autres qui ont des problèmes<br />
avec l’étranger. Parce que l’étranger, c’est tout le monde. Depuis que mon père est<br />
mort, je me suis r<strong>en</strong>du compte que finalem<strong>en</strong>t c’est la personne la plus près de soi qui<br />
est la plus étrangère. Parce c’est celle que l’on croyait connaître le mieux et on mesure à<br />
quel point elle nous est étrangère. Finalem<strong>en</strong>t, quelqu’un que je ne connais pas, je ne<br />
sais pas s’il est étranger ou pas. Mais quelqu’un que je connais bi<strong>en</strong>, je sais à quel point<br />
il m’est étranger. Quand mon père est mort, j’ai compris, j’ai réalisé que la personne avec<br />
qui j’avais vécu et avec qui j’avais grandi p<strong>en</strong>dant plus de quarante ans, c’est la personne<br />
que je connaissais le moins. Sauf que c’était un peu trop tard.<br />
C’est pour dire que ces questions ne sont pas du tout évid<strong>en</strong>tes, et que ça vaut le coup<br />
de les travailler. On a donc discuté. Et de tous ces débats j’ai sorti des constances, des<br />
72