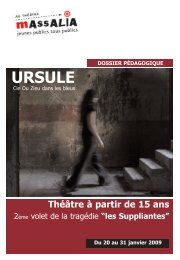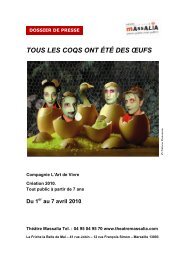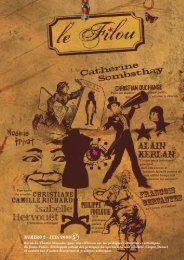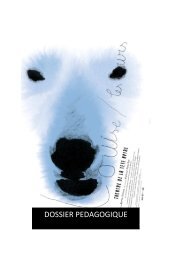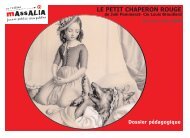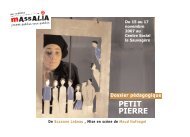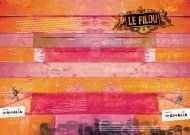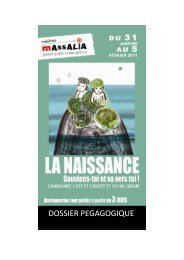Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
“Déroutes” de Mathilde Monnier par Gérard May<strong>en</strong><br />
la travers<strong>en</strong>t, qu’elle pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> charge, qu’elle transforme, et qui ne sont jamais arrêtées.<br />
Le comm<strong>en</strong>taire, notamm<strong>en</strong>t le comm<strong>en</strong>taire critique, comme le mi<strong>en</strong>, ou le comm<strong>en</strong>taire<br />
des interprètes qui <strong>en</strong> ont leur propre récit, leur propre expéri<strong>en</strong>ce, tout ça fait<br />
partie de formes diverses. Tout ça est très important. Ça vous concerne au premier plan.<br />
C’est à dire que vous ne devez absolum<strong>en</strong>t pas avoir peur, devant un spectacle, de vos<br />
propres manières de le ress<strong>en</strong>tir, de le traverser, de le voir. Il y a des manières paresseuses,<br />
peu intellig<strong>en</strong>tes, qui consist<strong>en</strong>t à dire : « Je n’aime pas », ou « Ce n’est pas ce que<br />
j’avais imaginé » ou : « ça ne correspond pas à l’idée que je me fais de ce que doit être<br />
un beau mouvem<strong>en</strong>t ». Bon d’accord. C’est assez paresseux, parce qu’une fois qu’on l’a<br />
posé, ça n’amène pas grand chose. En revanche, dès qu’on sort de cette catégorie là, des<br />
points de vue paresseux, on peut dire que tous les points de vue construis<strong>en</strong>t,<br />
nourriss<strong>en</strong>t, dans la mesure où ils se mett<strong>en</strong>t au travail, où ils se pos<strong>en</strong>t un certain<br />
nombre de questions.<br />
Aujourd’hui on a la chance de les partager avec vous et avec Herman Diephuis. Tous les points<br />
de vue sont valides. Je vais même jusqu’à dire que c’est dans le regard même que, peut-être,<br />
se fait une part de la composition. Ça serait à débattre. Peut-être<br />
que je tords le bâton un peu trop. Je vais un peu loin ! Je me laisse<br />
emporter par mes propres conceptions. En tout cas, c’est dans<br />
nos propres regards que se form<strong>en</strong>t des niveaux ess<strong>en</strong>tiels de la<br />
pièce. C’est par là où elle existe. Elle ne serait pas là sans notre<br />
regard, elle ne serait pas là sans ce que nous projetons, ce que<br />
nous <strong>en</strong> p<strong>en</strong>sons, ce que nous ress<strong>en</strong>tons, ce à quoi ça nous fait<br />
p<strong>en</strong>ser, les discussions que ça nous amène, les curiosités que ça<br />
suscite, les contradictions, ce à quoi nous adhérons, ce que nous<br />
acceptons, ce que nous rejetons, etc. La pièce n’existerait pas, s’il<br />
n’y avait pas, y compris, ce mom<strong>en</strong>t de son développem<strong>en</strong>t. C’est<br />
vraim<strong>en</strong>t une clé. C’est une bonne nouvelle. Vous n’êtes pas<br />
auteurs, vous n’êtes pas chorégraphes, <strong>en</strong>fin, j’imagine, pour la<br />
En tout cas,<br />
c’est dans nos<br />
propres regards<br />
que se form<strong>en</strong>t<br />
des niveaux ess<strong>en</strong>tiels<br />
de la pièce.<br />
plupart d’<strong>en</strong>tre vous, <strong>en</strong> revanche vous êtes vraim<strong>en</strong>t co-réalisateurs de ce qu’une pièce<br />
produit. Nous le sommes tous. Nous réalisons. Nous permettons qu’elle arrive à la réalité,<br />
qu’elle s’y confronte, qu’elle soit là, prés<strong>en</strong>te, avec nous, vivante. Et c’est forcém<strong>en</strong>t avec nous.<br />
Pour que je ne parle pas totalem<strong>en</strong>t dans le vide, j’ai p<strong>en</strong>sé vous montrer des extraits de cette<br />
pièce, pour vous la mettre sous la d<strong>en</strong>t. Il s’agit donc de la pièce « Déroutes ». Je me permets<br />
de vous dire que le titre inspire d’emblée quelque chose d’assez déroutant, où le s<strong>en</strong>s ne serait<br />
pas évid<strong>en</strong>t. C’est une idée qu’on peut garder <strong>en</strong> tête. C’est une pièce créée <strong>en</strong> 2002 au Théâtre<br />
de G<strong>en</strong>nevilliers <strong>en</strong> banlieue parisi<strong>en</strong>ne, mais <strong>en</strong> programmation du Théâtre de la Ville à Paris.<br />
Je l’ai travaillée. Je ne suis pas universitaire au niveau de Philippe Guisgand, qui est Maître de<br />
confér<strong>en</strong>ce, chercheur… Moi j’étais modestem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> DEA. Néanmoins, ça a donné cet<br />
ouvrage qui est une analyse d’œuvre, <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t consacré à l’analyse de cette pièce. Ouvrage<br />
qui s’intitule « De marche <strong>en</strong> danse », sur la pièce « Déroutes » de Mathilde Monnier.<br />
Je ne vais pas prés<strong>en</strong>ter toute l’œuvre de Mathilde Monnier. Je dirais que c’est une chorégraphe<br />
qui dirige depuis 13 ans maint<strong>en</strong>ant le C<strong>en</strong>tre Chorégraphique de Montpellier, <strong>en</strong><br />
Languedoc Roussillon. Ça serait un peu comme le Pavillon Noir d’Angelin Preljocaj à Aix <strong>en</strong><br />
Prov<strong>en</strong>ce. Ça va nous permettre de nous r<strong>en</strong>dre compte qu’il n’y pas deux directeurs de<br />
C<strong>en</strong>tres Chorégraphiques qui se ressembl<strong>en</strong>t, et que peut-être certaines conceptions sur ce<br />
qu’on fait de la danse ou ce qu’on fait d’un c<strong>en</strong>tre chorégraphique à Aix sont radicalem<strong>en</strong>t<br />
différ<strong>en</strong>tes de ce que peut inv<strong>en</strong>ter Mathilde Monnier à Montpellier. On va regarder quelques<br />
extraits.<br />
C’est une pièce longue. Une heure quarante cinq <strong>en</strong>viron. C’est une pièce d’une durée exceptionnelle.<br />
Il y a une t<strong>en</strong>dance au formatage. Des pièces de groupe font une heure ou un petit<br />
peu plus. Ces 1h45 ne veul<strong>en</strong>t pas ri<strong>en</strong> dire quant au propos de la pièce. La question du temps<br />
est une question ess<strong>en</strong>tielle <strong>en</strong> terme d’écriture chorégraphique. Ce choix de durée est peutêtre<br />
un des élém<strong>en</strong>ts de composition. On va essayer de repérer des élém<strong>en</strong>ts de composition,<br />
les saisir, les faire sortir. Ça va être notre jeu cet après-midi. Donc peut-être que cette durée<br />
veut dire quelque chose. On va regarder.<br />
[Il montre plusieurs extraits de « Déroutes » de Mathilde Monnier, à différ<strong>en</strong>ts mom<strong>en</strong>ts de la<br />
pièce.]<br />
Ne vous étonnez pas de l’obscurité, ce n’est pas un défaut de la prise de vue. C’est une<br />
caractéristique de la pièce à ce mom<strong>en</strong>t là. On va accélérer pour sortir de l’obscurité. On<br />
96