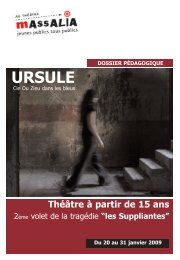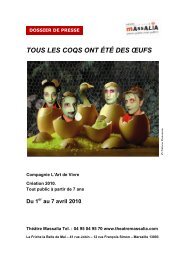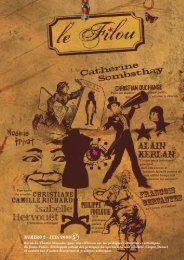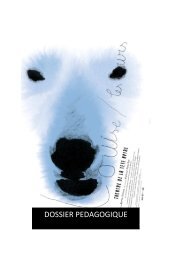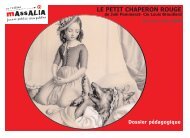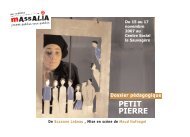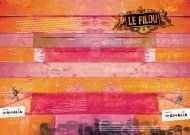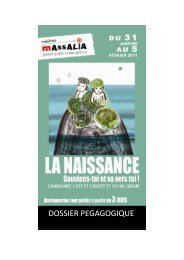Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Prélude à un Abécédaire des nouvelles écritures théâtrales par Daniel Lemahieu<br />
faire. Se cont<strong>en</strong>ter d’une simple indication, qu’on laisse au lecteur le soin d’effectuer.<br />
Ainsi les héros de Masoch ne cess<strong>en</strong>t de murmurer, leur voix doit être « un murmure à<br />
peine audible ». Par exemple, Beckett peut demander de « proférer dans un murmure ».<br />
À peine audible.<br />
Si on se trouve devant mille personnes, comm<strong>en</strong>t procéder ? Il faut qu’elles <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t.<br />
Non ! Il écrit : « Un murmure à peine audible », donc on émet le murmure à peine audible.<br />
« Isabelle, de Melville a une voix qui ne doit pas excéder le murmure. Et l’angélique Billy<br />
Budd ne s’émeut pas qu’on doive lui restituer son bégaiem<strong>en</strong>t ou même pire ». Grégoire,<br />
chez Kafka, dans La Métamorphose, piaule plus qu’il ne parle, mais c’est d’après le<br />
témoignage des tiers. Il suffit de lire le début de La Métamorphose de Kafka et vous<br />
constaterez cela.<br />
Il semble pourtant qu’il y ait une troisième possibilité : quand dire, c’est faire. Sur ce<br />
point existe un très beau livre, Quand dire, c’est faire, de l’Anglais Austin . Exemple :<br />
quand on conclut un mariage. À un mom<strong>en</strong>t donné, quelqu’un dit « Oui ». L’homme puis<br />
la femme. Ou l’inverse. À quoi s’<strong>en</strong>gag<strong>en</strong>t-ils quand ils dis<strong>en</strong>t « Oui » ? Vous le savez<br />
tous. Vous êtes la plupart passés par là. Qu’est-ce que veut dire ce « Oui » dans toutes<br />
ses conséqu<strong>en</strong>ces imprévisibles où chacun et chacune s’<strong>en</strong>gag<strong>en</strong>t ? Une seule solution :<br />
le faire au fur et à mesure pour le savoir. Dire, c’est faire.<br />
« C’est ce qui arrive quand le bégaiem<strong>en</strong>t ne porte plus sur les mots préexistants, mais<br />
introduit lui-même les mots qu’il affecte ; ceux-ci n’exist<strong>en</strong>t plus indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t du<br />
bégaiem<strong>en</strong>t qui les sélectionne et les relie par lui-même. Ce n’est plus le personnage qui<br />
est bègue de parole, c’est l’écrivain qui devi<strong>en</strong>t bègue de la langue. Il fait bégayer la langue<br />
<strong>en</strong> tant que telle. » Et Deleuze explicite « comm<strong>en</strong>t on fait bégayer la langue ».<br />
Dès lors, la langue bégaie d’elle-même <strong>en</strong> elle-même. Quand on lit une partition contemporaine,<br />
ça peut être Beckett, ça peut être Novarina, la langue y bégaie d’elle-même <strong>en</strong><br />
elle-même. Même projet du côté de Guyotat : Prostitution ; Ed<strong>en</strong>, Ed<strong>en</strong>, Ed<strong>en</strong>, livre interdit<br />
à l’exposition dans les librairies, les bibliothèques dans les années 70. Quand, <strong>en</strong><br />
1981, Antoine Vitez a monté Tombeau pour 500 000 soldats au Théâtre national Chaillot,<br />
on a perdu des quantités d’abonnés.<br />
Ce bégaiem<strong>en</strong>t conduit à quoi ? Il conduit à ce que l’auteur, l’écrivain (écrivain / écrivaine)<br />
se considère comme un étranger dans la langue où il s’exprime, même si c’est sa<br />
langue maternelle. On utilise sa langue propre pour construire, avec cette langue propre,<br />
une langue sale. Francis Ponge expliquait que lorsqu’on essaie de traiter des choses avec<br />
des mots, on parle du parti pris des choses compte t<strong>en</strong>u de mots : PPC / Parti pris des<br />
Choses / CTM / Compte t<strong>en</strong>u des Mots. Et ces mots sont sales. Ils sont utilisés par tout<br />
le monde, à la différ<strong>en</strong>ce de la gouache immaculée sortie des tubes du peintre avant qu’il<br />
ne la triture, la brosse, la malaxe, la frappe, la glisse sur la toile. On écrit avec les mots<br />
du boucher, du boulanger, du pasteur, du policier, du maçon, du fossoyeur.<br />
L’écriture s’inscrit dans cette dialectique langue propre / langue sale, et écrire <strong>en</strong> Français<br />
revi<strong>en</strong>t à écrire comme si le Français était une langue étrangère.<br />
Quand Beckett s’exprime et s’imprime, d’une certaine manière il écrit dans une langue<br />
étrangère et inv<strong>en</strong>te un Français. Jusque-là, il écrivait <strong>en</strong> Anglais. Ou <strong>en</strong> Irlandais, si vous<br />
voulez. Et tous les mots français de cette langue, qui n’est pas la si<strong>en</strong>ne, lui permett<strong>en</strong>t<br />
de parler de sa langue propre. À lui. Il manipule des mots sales, des mots qu’il ne connaît<br />
pas pleinem<strong>en</strong>t, maternellem<strong>en</strong>t et, dans cette traversée, il comm<strong>en</strong>ce à bâtir son univers.<br />
Il pratique ainsi le Français comme on pratique une langue étrangère.<br />
Pour Novarina, cela revi<strong>en</strong>t à pratiquer le “Franquon” ». Quand on pratique le “Franquon”,<br />
on <strong>en</strong>tre vraim<strong>en</strong>t dans l’étranger par sa langue et on appr<strong>en</strong>d, par l’étranger, sa propre<br />
langue. Lorsqu’on traduit une langue étrangère, ce n’est pas la langue étrangère qu’on<br />
traduit, c’est sa propre langue qu’on appr<strong>en</strong>d au fond pour traduire l’Anglais, le Russe<br />
etc.<br />
Ces écrivains t<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t l’écoute et la profération d’une langue inouïe, une langue que personne<br />
n’a <strong>en</strong>core jamais parlée. Ils fabriqu<strong>en</strong>t des « drames de bouche ». Les Allemands<br />
appell<strong>en</strong>t ça « Maulwerke », drames de gueule. « Maul » : « gueuler » et « Werke » :<br />
travaux. Ce langage jamais <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du, cette langue mineure que personne n’a jamais prononcée,<br />
ni articulée, devi<strong>en</strong>dra un jour langue majeure.<br />
16