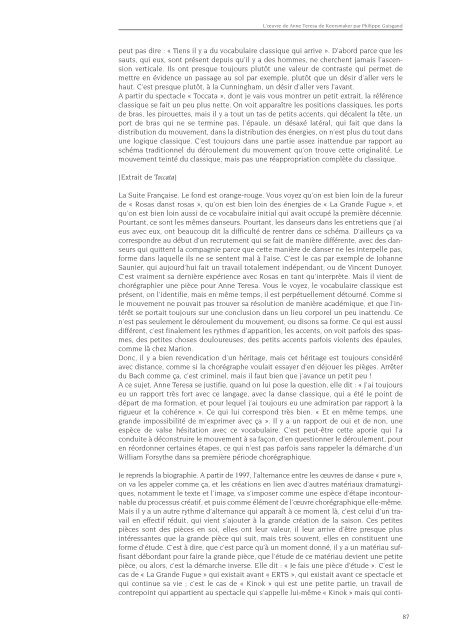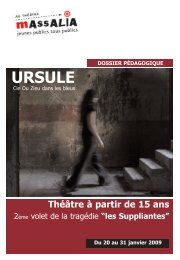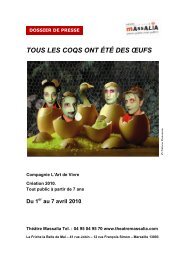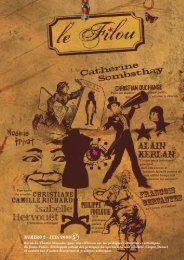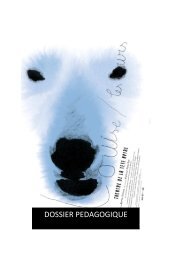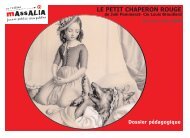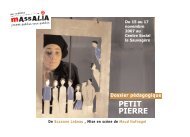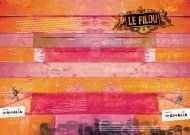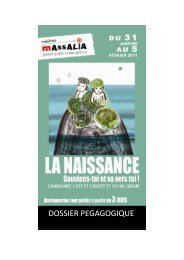Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
Mise en page 1 - Théâtre Massalia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’œuvre de Anne Teresa de Keersmaker par Philippe Guisgand<br />
peut pas dire : « Ti<strong>en</strong>s il y a du vocabulaire classique qui arrive ». D’abord parce que les<br />
sauts, qui eux, sont prés<strong>en</strong>t depuis qu’il y a des hommes, ne cherch<strong>en</strong>t jamais l’asc<strong>en</strong>sion<br />
verticale. Ils ont presque toujours plutôt une valeur de contraste qui permet de<br />
mettre <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce un passage au sol par exemple, plutôt que un désir d’aller vers le<br />
haut. C’est presque plutôt, à la Cunningham, un désir d’aller vers l’avant.<br />
A partir du spectacle « Toccata », dont je vais vous montrer un petit extrait, la référ<strong>en</strong>ce<br />
classique se fait un peu plus nette. On voit apparaître les positions classiques, les ports<br />
de bras, les pirouettes, mais il y a tout un tas de petits acc<strong>en</strong>ts, qui décal<strong>en</strong>t la tête, un<br />
port de bras qui ne se termine pas, l’épaule, un désaxé latéral, qui fait que dans la<br />
distribution du mouvem<strong>en</strong>t, dans la distribution des énergies, on n’est plus du tout dans<br />
une logique classique. C’est toujours dans une partie assez inatt<strong>en</strong>due par rapport au<br />
schéma traditionnel du déroulem<strong>en</strong>t du mouvem<strong>en</strong>t qu’on trouve cette originalité. Le<br />
mouvem<strong>en</strong>t teinté du classique, mais pas une réappropriation complète du classique.<br />
[Extrait de Toccata]<br />
La Suite Française. Le fond est orange-rouge. Vous voyez qu’on est bi<strong>en</strong> loin de la fureur<br />
de « Rosas danst rosas », qu’on est bi<strong>en</strong> loin des énergies de « La Grande Fugue », et<br />
qu’on est bi<strong>en</strong> loin aussi de ce vocabulaire initial qui avait occupé la première déc<strong>en</strong>nie.<br />
Pourtant, ce sont les mêmes danseurs. Pourtant, les danseurs dans les <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s que j’ai<br />
eus avec eux, ont beaucoup dit la difficulté de r<strong>en</strong>trer dans ce schéma. D’ailleurs ça va<br />
correspondre au début d’un recrutem<strong>en</strong>t qui se fait de manière différ<strong>en</strong>te, avec des danseurs<br />
qui quitt<strong>en</strong>t la compagnie parce que cette manière de danser ne les interpelle pas,<br />
forme dans laquelle ils ne se s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t mal à l’aise. C’est le cas par exemple de Johanne<br />
Saunier, qui aujourd’hui fait un travail totalem<strong>en</strong>t indép<strong>en</strong>dant, ou de Vinc<strong>en</strong>t Dunoyer.<br />
C’est vraim<strong>en</strong>t sa dernière expéri<strong>en</strong>ce avec Rosas <strong>en</strong> tant qu’interprète. Mais il vi<strong>en</strong>t de<br />
chorégraphier une pièce pour Anne Teresa. Vous le voyez, le vocabulaire classique est<br />
prés<strong>en</strong>t, on l’id<strong>en</strong>tifie, mais <strong>en</strong> même temps, il est perpétuellem<strong>en</strong>t détourné. Comme si<br />
le mouvem<strong>en</strong>t ne pouvait pas trouver sa résolution de manière académique, et que l’intérêt<br />
se portait toujours sur une conclusion dans un lieu corporel un peu inatt<strong>en</strong>du. Ce<br />
n’est pas seulem<strong>en</strong>t le déroulem<strong>en</strong>t du mouvem<strong>en</strong>t, ou disons sa forme. Ce qui est aussi<br />
différ<strong>en</strong>t, c’est finalem<strong>en</strong>t les rythmes d’apparition, les acc<strong>en</strong>ts, on voit parfois des spasmes,<br />
des petites choses douloureuses, des petits acc<strong>en</strong>ts parfois viol<strong>en</strong>ts des épaules,<br />
comme là chez Marion.<br />
Donc, il y a bi<strong>en</strong> rev<strong>en</strong>dication d’un héritage, mais cet héritage est toujours considéré<br />
avec distance, comme si la chorégraphe voulait essayer d’<strong>en</strong> déjouer les pièges. Arrêter<br />
du Bach comme ça, c’est criminel, mais il faut bi<strong>en</strong> que j’avance un petit peu !<br />
A ce sujet, Anne Teresa se justifie, quand on lui pose la question, elle dit : « J’ai toujours<br />
eu un rapport très fort avec ce langage, avec la danse classique, qui a été le point de<br />
départ de ma formation, et pour lequel j’ai toujours eu une admiration par rapport à la<br />
rigueur et la cohér<strong>en</strong>ce ». Ce qui lui correspond très bi<strong>en</strong>. « Et <strong>en</strong> même temps, une<br />
grande impossibilité de m’exprimer avec ça ». Il y a un rapport de oui et de non, une<br />
espèce de valse hésitation avec ce vocabulaire. C’est peut-être cette aporie qui l’a<br />
conduite à déconstruire le mouvem<strong>en</strong>t à sa façon, d’<strong>en</strong> questionner le déroulem<strong>en</strong>t, pour<br />
<strong>en</strong> réordonner certaines étapes, ce qui n’est pas parfois sans rappeler la démarche d’un<br />
William Forsythe dans sa première période chorégraphique.<br />
Je repr<strong>en</strong>ds la biographie. A partir de 1997, l’alternance <strong>en</strong>tre les œuvres de danse « pure »,<br />
on va les appeler comme ça, et les créations <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec d’autres matériaux dramaturgiques,<br />
notamm<strong>en</strong>t le texte et l’image, va s’imposer comme une espèce d’étape incontournable<br />
du processus créatif, et puis comme élém<strong>en</strong>t de l’œuvre chorégraphique elle-même.<br />
Mais il y a un autre rythme d’alternance qui apparaît à ce mom<strong>en</strong>t là, c’est celui d’un travail<br />
<strong>en</strong> effectif réduit, qui vi<strong>en</strong>t s’ajouter à la grande création de la saison. Ces petites<br />
pièces sont des pièces <strong>en</strong> soi, elles ont leur valeur, il leur arrive d’être presque plus<br />
intéressantes que la grande pièce qui suit, mais très souv<strong>en</strong>t, elles <strong>en</strong> constitu<strong>en</strong>t une<br />
forme d’étude. C’est à dire, que c’est parce qu’à un mom<strong>en</strong>t donné, il y a un matériau suffisant<br />
débordant pour faire la grande pièce, que l’étude de ce matériau devi<strong>en</strong>t une petite<br />
pièce, ou alors, c’est la démarche inverse. Elle dit : « Je fais une pièce d’étude ». C’est le<br />
cas de « La Grande Fugue » qui existait avant « ERTS », qui existait avant ce spectacle et<br />
qui continue sa vie ; c’est le cas de « Kinok » qui est une petite partie, un travail de<br />
contrepoint qui apparti<strong>en</strong>t au spectacle qui s’appelle lui-même « Kinok » mais qui conti-<br />
87