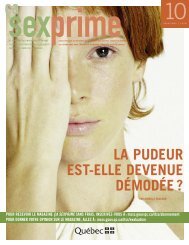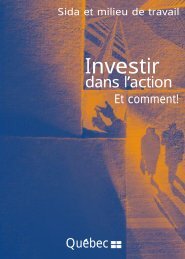De l'innovation au changement - Gouvernement du Québec
De l'innovation au changement - Gouvernement du Québec
De l'innovation au changement - Gouvernement du Québec
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Projet 26<br />
Effets des modes d’intégration des services en émergence dans la région sociosanitaire des L<strong>au</strong>rentides<br />
132<br />
L'impulsion et la mise en place des rése<strong>au</strong>x proviennent de l'extérieur des bassins. Sans elles, peu de <strong>changement</strong>s <strong>au</strong>raient été initiés.<br />
Elles proviennent surtout <strong>du</strong> MSSS et de la Régie régionale qui profite de ce contexte pour insuffler un mouvement de <strong>changement</strong> dans<br />
sa région. Elle procure un cadre, des objectifs et des incitatifs. Elle est disposée à accepter des modes d'intégration <strong>au</strong>tres que les fusions<br />
qui émaneraient des bassins et y feraient consensus, mais se réserve la possibilité d'y recourir si les collaborations entre les organisations<br />
ne progressent pas selon les paramètres et les échéanciers fixés<br />
Cette stratégie a résulté en l'émergence de deux dynamiques différentes <strong>au</strong> sein des bassins. Une première, dite consensuelle, est<br />
caractérisée par le fait que les organisations conviennent rapidement de ne pas procéder à des fusions d'établissements <strong>au</strong>tres que celles<br />
imposées par la Loi. Elles misent plutôt sur des ententes interorganisationnelles pour le partage des ressources et la fourniture de services<br />
comme alternative valable et viable <strong>au</strong>x fusions. La deuxième est marquée par des négociations difficiles et même polarisées. Ces<br />
négociations portent principalement sur le rôle et la place des centres hospitaliers <strong>au</strong> sein des rése<strong>au</strong>x de services.<br />
Trois constatations ressortent de l'analyse : 1) la mise en place de nouve<strong>au</strong>x mécanismes d'allocation de ressources prévus initialement<br />
par la Régie n'a pas eu lieu ; 2) les bassins ne se différencient pas ou très peu quant <strong>au</strong> degré et <strong>au</strong> type de partage des ressources. Les<br />
bassins qui ont procédé à des fusions d'établissements affichent un certain degré d'avancement <strong>du</strong> partage des ressources ; 3) le<br />
processus ayant présidé à l'adoption des modifications juridico-administratives permet d'identifier deux groupes de bassins. Le premier<br />
groupe est composé des bassins A et B. Le processus qui a con<strong>du</strong>it à l'adoption de modifications juridico-administratives est qualifié de<br />
consensuel. Cette collaboration ouverte entre les partenaires a résulté en la mise en place d'un rése<strong>au</strong> multicentrique dans lequel <strong>au</strong>cune<br />
organisation n'est dominante. Chaque organisation apporte sa contribution en fonction de sa mission et expertise. Pour la mise en place<br />
des rése<strong>au</strong>x de services <strong>au</strong>x personnes en perte d'<strong>au</strong>tonomie, les comités de coordination de ces bassins sont les plus actifs et de<br />
nombreuses ententes ont pu être conclues entre les établissements.<br />
Les rése<strong>au</strong>x de services de santé physique des Bassins C, D et E sont qualifiés de monocentriques, l'acteur dominant étant le centre<br />
hospitalier. <strong>De</strong>s difficultés sont rencontrées dans la mise en place, le fonctionnement et l'efficacité des mécanismes de liaison entre les<br />
établissements de ces bassins. <strong>De</strong> plus, les centres hospitaliers semblent moins miser sur une approche inter-organisationnelle pour<br />
ré<strong>du</strong>ire les hospitalisations et ré<strong>du</strong>ire la <strong>du</strong>rée moyenne. Ils mettent l'accent sur la mise en place de moyens leur permettant d'assurer à<br />
l'interne le suivi des patients visés par le virage ambulatoire : soit l'urgence (bassin D et E) ou une nouvelle " clinique de relance " (bassin<br />
C). Le travail des infirmières de liaison est en partie contraint par la " bonne volonté <strong>du</strong> médecin " de transférer ou non les patients. Ils<br />
misent <strong>au</strong>ssi sur les cabinets privés des médecins qui pratiquent <strong>au</strong>x centres hospitaliers. Il en résulte qu'une partie de la clientèle<br />
destinée à être référée et suivie par les CLSC est alors " retenue " par les médecins pratiquant à la fois <strong>au</strong> centre hospitalier et en cabinet<br />
privé. Dans ces bassins les rése<strong>au</strong>x de services de santé physique sont moins développés.<br />
Les bassins ayant privilégié le développement de rése<strong>au</strong>x multicentriques sont ceux dont les populations recourent proportionnellement<br />
moins <strong>au</strong>x centres hospitaliers pour l'obtention de leurs services et ce, avant même la mise en place de ces rése<strong>au</strong>x. À l'inverse, les<br />
bassins ayant privilégié le développement de rése<strong>au</strong>x monocentriques, sont ceux dont les populations recourent proportionnellement plus<br />
<strong>au</strong>x centres hospitaliers soit à l'hospitalisation, soit <strong>au</strong>x urgences, soit <strong>au</strong>x deux. Les modes d'intégration privilégiés sont donc, tout <strong>au</strong><br />
moins en partie, le reflet des pratiques des professionnels et des organisations que leur développement voulait modifier. C'est donc dans<br />
un processus continuel d'influence réciproque que modes d'intégration et pratiques sont susceptibles de développer à terme des rése<strong>au</strong>x<br />
intégrés modifiant, dans la direction souhaitée, les caractéristiques des services offerts à la population.<br />
Le bassin C présente un profil particulier des plus intéressants. Une dynamique complètement différente s'est installée pour le<br />
développement <strong>du</strong> rése<strong>au</strong> de services <strong>au</strong>x personnes en perte d'<strong>au</strong>tonomie. Le comité local de coordination est très actif et de<br />
nombreuses collaborations se sont développées entre plusieurs organisations <strong>du</strong> bassin. Le rése<strong>au</strong> de services à cette clientèle est l'un<br />
des plus développés de la région. <strong>De</strong>ux facteurs sont susceptibles d'être à la base de ce développement : le dynamisme de l'équipe des<br />
professionnels qui travaillent à la clinique de gériatrie <strong>du</strong> centre hospitalier ; et l'implication des médecins de cabinets privés dans la