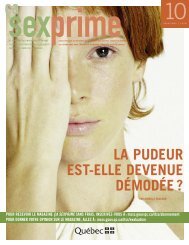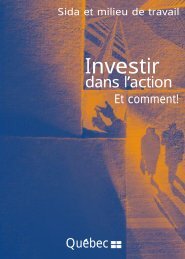De l'innovation au changement - Gouvernement du Québec
De l'innovation au changement - Gouvernement du Québec
De l'innovation au changement - Gouvernement du Québec
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Projet 34<br />
Transformation des pratiques des organismes commun<strong>au</strong>taires dans le cadre de<br />
la réorganisation <strong>du</strong> rése<strong>au</strong> de la santé et des services soci<strong>au</strong>x, tout le Québec<br />
Une telle volonté d'être <strong>au</strong>tonome peut comporter des effets pervers, entre <strong>au</strong>tres dans la conception et le discours qui accompagnent les<br />
stratégies développées dans le rapport à l'État. À trop clamer son <strong>au</strong>tonomie, on peut générer une certaine <strong>au</strong>tarcie, qui teinterait les<br />
pratiques, et qui ne permettrait pas toujours d'évoluer en restant ouvert à de nouvelles perspectives d'action. On <strong>au</strong>rait alors affaire à une<br />
expertise commun<strong>au</strong>taire forte, mais coupée, voire déracinée de sa base, des personnes et des commun<strong>au</strong>tés dont ils sont redevables,<br />
voire parfois imputables. Elle pourrait entraîner une certaine fermeture sur soi, entre " croyants «, les groupes perdraient de vue qu'ils<br />
servent des citoyens, qu'ils ne sont pas une entreprise <strong>au</strong>togérée, ou un groupe de pression.<br />
5. BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION<br />
5.1 Résultats Les organismes doivent de plus en plus répondre à des besoins urgents et extrêmement diversifiés. Cette situation implique que les<br />
organismes ont besoin d'être assurés d'une certaine stabilité afin qu'ils puissent maintenir leur capacité d'adaptation à l'évolution des<br />
besoins de la population.<br />
Les résultats font particulièrement ressortir toute l'ampleur <strong>du</strong> travail réalisé par les différents types de ressources commun<strong>au</strong>taires à<br />
l'étude. Cela se vérifie à travers leur action/programmation, par le biais de multiples services, activités et actions réalisés avec les<br />
personnes rejointes. En ce sens, les organismes commun<strong>au</strong>taires à l'étude génèrent des formes d'interaction, qui se tra<strong>du</strong>isent d'abord<br />
par l'établissement de relations entre les personnes citoyennes et le groupe.<br />
En regard de la réforme des services soci<strong>au</strong>x et de santé <strong>au</strong> Québec, l'ampleur des liens établis illustre bien la place que les organismes<br />
commun<strong>au</strong>taires occupent sur leur territoire respectif. En témoigne, ultimement, l'importance croissante des argents et des emplois qui<br />
gravitent dans ces secteurs <strong>du</strong> social, et qui contribuent <strong>au</strong> développement des commun<strong>au</strong>tés locales.<br />
Globalement, le commun<strong>au</strong>taire est devenu un acteur sur lequel il f<strong>au</strong>t compter dans le champ de la santé et des services soci<strong>au</strong>x <strong>au</strong><br />
Québec. En interface avec la réforme québécoise, il s'agit assurément d'une transformation à la fois quantitative et qualitative de leur<br />
présence. Bien qu'il soit difficile de pondérer le poids réel de cette place, force est d'admettre que les groupes commun<strong>au</strong>taires québécois<br />
sont devenus des ressources incontournables dans la reconfiguration actuelle des rapports soci<strong>au</strong>x <strong>au</strong> Québec, dont la pertinence est<br />
réaffirmée <strong>au</strong>jourd'hui, <strong>au</strong> moment où le mouvement commun<strong>au</strong>taire continue de se battre pour sa reconnaissance.<br />
Les répondants perçoivent un fort alourdissement des problématiques, accompagné d'un app<strong>au</strong>vrissement des personnes. La lourdeur<br />
des situations rencontrées et les besoins non comblés, con<strong>du</strong>isent les groupes à favoriser un fonctionnement plus " structuré " et des<br />
manières de faire plus interventionnistes.<br />
En ce qui a trait à l'action/programmation, les études de cas mettent en lumière une relative transformation de la nature des rapports<br />
entretenus avec les personnes que les organismes rejoignent <strong>au</strong> quotidien. Ces rapports sont, avec des nuances, plus structurés, plus<br />
professionnalisés.<br />
Ce positionnement, qui confère <strong>au</strong>x groupes commun<strong>au</strong>taires un rôle accru dans leur milieu respectif, s'accompagne d'un processus de<br />
structuration / formalisation de l'ensemble des sphères de pratiques des groupes à l'étude. Elle intro<strong>du</strong>it une certaine division des tâches,<br />
des paliers décisionnels, et une hiérarchisation des responsabilités. Par exemple, dans l'intervention indivi<strong>du</strong>elle, on utilise de plus en plus<br />
différents outils de suivis, qui vont <strong>du</strong> cahier de bord à la tenue de dossier.<br />
174<br />
Tous les groupes rencontrés sont traversés par une certaine formalisation, bien qu'à des degrés variables. Ce fonctionnement plus formel<br />
semble avoir des effets sur la place des bénévoles dans l'organisme. Étant donné l'omniprésence grandissante <strong>du</strong> personnel rémunéré,<br />
voire permanent, ils sont moins impliqués dans les activités stratégiques qui définissent l'essence même <strong>du</strong> groupe. Ils sont souvent<br />
ré<strong>du</strong>its à jouer un rôle d'exécutants, leur participation perdant alors de sa pertinence.