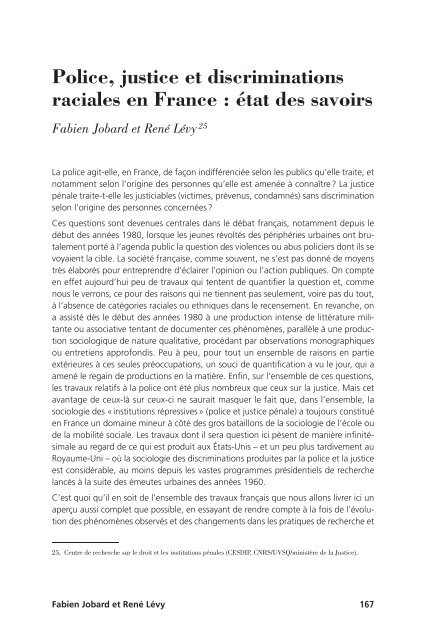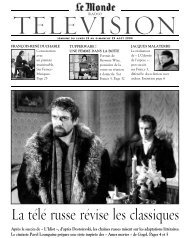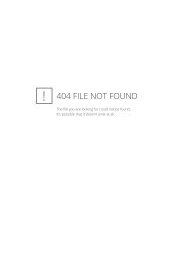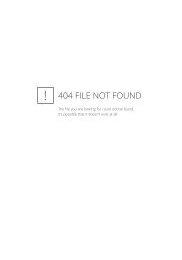- Page 1 and 2:
Commission nationale consultative d
- Page 3 and 4:
RAPPORT dE LA COMMISSION NATIONALE
- Page 5 and 6:
SommaireSommaire Avant-propos 9 CN
- Page 7 and 8:
deuxIème PArtIe lA lutte contre le
- Page 9:
note au lecteur Le rapport de la CN
- Page 12 and 13:
10 Cette responsabilité incombe au
- Page 14 and 15:
En juillet 1990, le législateur, c
- Page 16 and 17:
pas de sens et ne recouvrirait aucu
- Page 18 and 19:
Discrimination raciale • « Toute
- Page 21:
PREMIèRE PARTIE ÉtAt deS lIeux :
- Page 25 and 26:
le racisme dans l’opinion Présen
- Page 27 and 28:
CNCDH cette perspective que la CNCD
- Page 29 and 30:
- 6 auprès de « non-racistes mais
- Page 31 and 32:
Si certains interviewés dénoncent
- Page 33 and 34:
a pas ça. Je suis pas d’accord d
- Page 35 and 36:
À ces différents éléments vient
- Page 37 and 38:
Au final, il semble aux yeux de la
- Page 39 and 40:
« Le racisme c’est quand on n’
- Page 41 and 42:
Si ces deux logiques s’entretienn
- Page 43 and 44:
Par ailleurs, ce terme peut désign
- Page 45 and 46:
Figure 2 : discours type 1 Institut
- Page 47 and 48:
Figure 5 : le racisme L’Autre = V
- Page 49 and 50:
On retrouve également dans ce type
- Page 51 and 52:
Dans le même temps, ce comportemen
- Page 53 and 54:
Figure 6 : les discriminations Disc
- Page 55 and 56:
Type 3 : un discours de justificati
- Page 57 and 58:
Figure 7 : l’intégration Discour
- Page 59 and 60:
« Franchement ça me choque quand
- Page 61 and 62:
Type 3 : un discours de justificati
- Page 63 and 64:
• Finalement, dans ce contexte, l
- Page 65 and 66:
La place du racisme au sein des pr
- Page 67 and 68:
Graphique 2 Pouvez-vous me dire que
- Page 69 and 70:
…qui se confirme cette année dan
- Page 71 and 72:
moyens de s’intégrer », contre
- Page 73 and 74:
que les immigrés rencontrent « pl
- Page 75 and 76:
La lutte contre le racisme Deux int
- Page 77 and 78:
Analyse des résultats des enquête
- Page 79 and 80:
CNCDH 11 % des personnes interrogé
- Page 81 and 82:
CNCDH la société française. Leur
- Page 83 and 84:
CNCDH qu’il y a trop d’immigré
- Page 85 and 86:
l’expérience de la discriminatio
- Page 87 and 88:
l’égalité des chances (ACSE) ;
- Page 89 and 90:
C’est bien entendu face aux discr
- Page 91 and 92:
Tableau 2 Motifs de discrimination
- Page 93 and 94:
témoigne de la fragilité de la re
- Page 95:
Tableau 4 Expérience du racisme v
- Page 99 and 100:
les actes et menaces à caractère
- Page 101 and 102:
Actes et menaces à caractère raci
- Page 103 and 104:
Typologie des actions violentes com
- Page 105 and 106:
Répartition géographique des acti
- Page 107 and 108:
Typologie des menaces racistes et x
- Page 109 and 110:
Répartition géographique des mena
- Page 111 and 112:
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 12 A
- Page 113 and 114:
La violence antisémite pour l’an
- Page 115 and 116:
70 60 50 40 30 20 10 0 9 2 0 0 0 0
- Page 117 and 118: Répartition géographique des acti
- Page 119 and 120: 120 100 80 60 40 20 0 106 Personnes
- Page 121 and 122: Au cours du mois de mai, à Saint-N
- Page 123 and 124: Conclusion Après une année 2009,
- Page 125 and 126: Avec 853 signalements (hors donnée
- Page 127 and 128: S’agissant des cas de discriminat
- Page 129 and 130: CNCDH La deuxième variable tient a
- Page 131 and 132: CNCDH aux actes et menaces à carac
- Page 133 and 134: L’impossibilité d’un recenseme
- Page 135 and 136: CNCDH et racisme antimaghrébin ét
- Page 137 and 138: CNCDH Cette baisse fut progressive
- Page 139 and 140: CNCDH le nombre d’actes racistes
- Page 141: CNCDH vécue du racisme semblent ê
- Page 144 and 145: souffrances sociales et de mal-êtr
- Page 146 and 147: « liberté » totale des communica
- Page 148 and 149: communautaires ou sur le net, afin
- Page 150 and 151: Nombreux sont ceux qui voient la pa
- Page 152 and 153: Ce texte misérable porte la signat
- Page 154 and 155: Dans son ordonnance en référé re
- Page 156 and 157: sensible à ce discours, il répond
- Page 158 and 159: droit de l’écran. La troisième
- Page 160 and 161: 15 septembre 2010. Le journal La Pr
- Page 162 and 163: le racisme sur internet : usages et
- Page 164 and 165: entre groupes politiques, voire ent
- Page 166 and 167: lutte contre le racisme sur l’Int
- Page 170 and 171: les modes d’administration de la
- Page 172 and 173: le prévenu. Desdevises, si elle ra
- Page 174 and 175: et des abus policiers, mais aussi l
- Page 176 and 177: Sur la vigilance, on constate une
- Page 178 and 179: à Marseille où, toutes choses ég
- Page 180 and 181: Plus précisément, elle a cherché
- Page 182 and 183: Tableau 2 Odds-ratios pour les Magh
- Page 184 and 185: À cet égard, il est intéressant
- Page 186 and 187: Tableau 3 Contrôlés auto-déclar
- Page 188 and 189: effets de composition susceptible d
- Page 190 and 191: précisément, que sur les comparut
- Page 192 and 193: cause, puis une connaissance partic
- Page 194 and 195: générale Nº 11 sur la lutte cont
- Page 196 and 197: le nom de la personne contrôlée,
- Page 198 and 199: CIMADE, 2004. Rapport annuel. Paris
- Page 200 and 201: Open Society Justice Initiative, «
- Page 203 and 204: En 2010, la situation du racisme en
- Page 205 and 206: aciale dans le logement s’effectu
- Page 207 and 208: circulation des Gens du voyage. Fin
- Page 209: Plan national d’action Suite aux
- Page 213: chapitre 1 la réponse institutionn
- Page 216 and 217: d’une infraction que lorsqu’une
- Page 218 and 219:
Éléments statistiques permettant
- Page 220 and 221:
Peines principales prononcées, cal
- Page 222 and 223:
Peines principales prononcées, cal
- Page 224 and 225:
Observations relatives aux condamna
- Page 226 and 227:
Affaires enregistrées par les parq
- Page 228 and 229:
À noter que l’application Cassio
- Page 230 and 231:
CNCDH : Existence d’un programme
- Page 232 and 233:
du code de procédure pénale ne pr
- Page 234 and 235:
signalement et, surtout, en dévelo
- Page 236 and 237:
des services d’enquête. Plusieur
- Page 238 and 239:
la délinquance à caractère racis
- Page 240 and 241:
LA CHAÎNE PÉNALE Classement sans
- Page 242 and 243:
Les modalités de la réponse péna
- Page 244 and 245:
Cependant, cette tendance doit êtr
- Page 246 and 247:
sa politique pénale en fonction de
- Page 248 and 249:
HALDE, peut permettre de soutenir l
- Page 250 and 251:
L’élaboration du rapport 2010 do
- Page 252 and 253:
contribution du ministère de l’
- Page 254 and 255:
Bilan de l’action du ministère C
- Page 256 and 257:
Nouvelles initiatives pour l’ann
- Page 258 and 259:
statistiquement significatif, de co
- Page 260 and 261:
Les nouveaux programmes d’éducat
- Page 262 and 263:
D’autres thèmes portent sur une
- Page 264 and 265:
CNCDH : Collaboration avec le monde
- Page 266 and 267:
étudiants en master de droit d’A
- Page 268 and 269:
contribution du ministère de l’I
- Page 270 and 271:
Le directeur général de la Gendar
- Page 272 and 273:
• La BNSI Cette base nationale st
- Page 274 and 275:
CNCDH : Bonnes pratiques des admini
- Page 276 and 277:
De même, au sein de la Gendarmerie
- Page 278 and 279:
Pour autant, le ministère chargé
- Page 280 and 281:
3) au soutien de projets en matièr
- Page 282 and 283:
Concernant la Cour européenne des
- Page 284 and 285:
3 - Le ministère s’est doté d
- Page 286 and 287:
6 - La politique de formation profe
- Page 288 and 289:
« négation, (la) minimisation gro
- Page 290 and 291:
contribution du Secrétariat d’É
- Page 292 and 293:
L’objectif de ce dispositif est d
- Page 294 and 295:
À la rentrée de septembre 2010, l
- Page 296 and 297:
Secteur de l’emploi Souvent alert
- Page 298 and 299:
la politique du Gouvernement en mat
- Page 300 and 301:
La CNCDH rappelle ainsi que l’éd
- Page 302 and 303:
- cette violence raciste et antisé
- Page 304 and 305:
certains départements est préoccu
- Page 306 and 307:
ministère des Affaires étrangère
- Page 308 and 309:
la violence et les propos racistes,
- Page 310 and 311:
Par ailleurs, la CNCDH invite le se
- Page 312 and 313:
Conformément à sa recommandation
- Page 314 and 315:
supposée à une ethnie, une nation
- Page 316 and 317:
L’enquête de la HALDE Saisie d
- Page 318 and 319:
correspondant à ses attentes. Un
- Page 320 and 321:
La preuve de la discrimination à l
- Page 322 and 323:
au sujet de leur situation administ
- Page 324 and 325:
des processus discriminatoires, val
- Page 327 and 328:
les onG membres de la cncdh contrib
- Page 329 and 330:
C’est pourquoi nous avons décid
- Page 331 and 332:
eçue à la HALDE le lundi 27 septe
- Page 333 and 334:
Évolution des actes racistes antis
- Page 335 and 336:
Une telle assimilation, comme les d
- Page 337 and 338:
Il est incontestable qu’un certai
- Page 339 and 340:
Les commentaires, blogs et sites in
- Page 341 and 342:
L’année 2010 a été l’occasio
- Page 343 and 344:
Actions emblématiques La LICRA a s
- Page 345 and 346:
Un panel de haut niveau, venant d
- Page 347 and 348:
contribution du mouvement contre le
- Page 349 and 350:
Partenariats inter associatifs au n
- Page 351 and 352:
du dixième arrondissement de Paris
- Page 353 and 354:
2010, Editors : Isabelle Carles and
- Page 355 and 356:
la montée de l’extrême droite e
- Page 357 and 358:
Ces différents chiffres révèlent
- Page 359 and 360:
Enfin, comme chaque année, nous av
- Page 361 and 362:
programme Equal intitulé « Lutte
- Page 363 and 364:
Si l’on fait un bilan plus global
- Page 365 and 366:
contribution de la confédération
- Page 367 and 368:
en novembre 2010, s’est donnée p
- Page 369 and 370:
Plus récemment, Force ouvrière a
- Page 371 and 372:
Nous revendiquons en particulier qu
- Page 373 and 374:
Des sessions de formation, des jour
- Page 375 and 376:
les religions et courants de pensé
- Page 377 and 378:
Ces rencontres trimestrielles nous
- Page 379 and 380:
Contribution du Grand Rabbinat de F
- Page 381 and 382:
des actes hostiles n’ont été po
- Page 383 and 384:
En tant qu’institution, la Grande
- Page 385 and 386:
contribution du Grand orient de Fra
- Page 387 and 388:
notre population. Les discours réc
- Page 389 and 390:
CNCDH l’image de l’étranger pa
- Page 391 and 392:
CNCDH Elle recommande au Gouverneme
- Page 393 and 394:
CNCDH de leurs dispositifs statisti
- Page 395:
- Fiche technique du sondage - Tabl
- Page 399 and 400:
QUESTION - Pouvez-vous me dire quel
- Page 401 and 402:
QUESTION - Pouvez-vous me dire qu'e
- Page 403 and 404:
QUESTION - Quelles sont, à votre a
- Page 405 and 406:
QUESTION - Vous personnellement, de
- Page 407 and 408:
QUESTION - Laquelle de ces deux phr
- Page 409 and 410:
QUESTION - Pour chacune des catégo
- Page 411 and 412:
QUESTION - Pour chacune des opinion
- Page 413 and 414:
QUESTION - Pour chacune des opinion
- Page 415 and 416:
QUESTION - Pour chacune des opinion
- Page 417 and 418:
QUESTION - Vous m’avez dit que le
- Page 419 and 420:
QUESTION - Vous personnellement, de
- Page 421 and 422:
Comparatif avec SPLIT QUESTION - Di
- Page 423 and 424:
QUESTION - A votre avis, les person
- Page 425 and 426:
QUESTION - A votre avis, les person
- Page 427 and 428:
QUESTION - Pouvez-vous me dire s’
- Page 429 and 430:
QUESTION - D’après vous était-c
- Page 431 and 432:
QUESTION - Pouvez-vous me dire, pou
- Page 433 and 434:
QUESTION - Selon vous le respect de