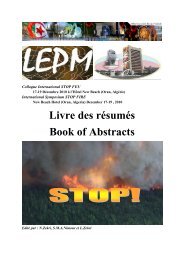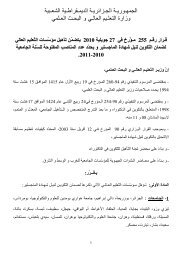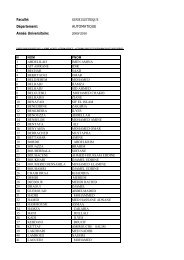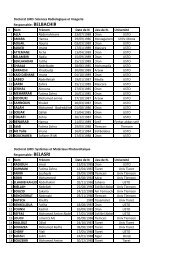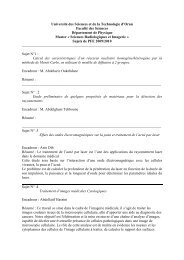You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
192 11. Relativité restreinte<br />
où L = x 2 − x 1 est la longueur <strong>de</strong> l’objet telle que mesurée dans le référentiel S; elle est donc plus<br />
petite que L 0 :<br />
L = L 0<br />
γ = L √<br />
0 1 − V 2<br />
/c 2 (11.37)<br />
Notons que les <strong>de</strong>ux mesures <strong>de</strong> position, qui sont simultanées dans S, ne le sont pas dans S ′ , car<br />
t ′ 2 ≠ t′ 1 .<br />
Il faut remarquer ici que si on pouvait ‘photographier’ un objet en mouvement très rapi<strong>de</strong>, il<br />
n’apparaîtrait pas contracté: il faut bien distinguer la ‘longueur <strong>de</strong> l’objet dans le référentiel S’,<br />
qui est une propriété <strong>de</strong> l’objet et du référentiel d’observation, <strong>de</strong> son ‘apparence visuelle’, qui est<br />
un phénomène plus complexe puisqu’il nécessite l’émission <strong>de</strong> lumière par l’objet et la réception <strong>de</strong><br />
cette lumière par un observateur après un certain temps <strong>de</strong> transit. En fait, un objet en mouvement<br />
rapi<strong>de</strong> apparaîtrait ‘tourné’ par rapport à l’objet au repos, et non contracté. De plus, en raison <strong>de</strong><br />
l’effet Doppler, ses couleurs seraient modifiées selon qu’il s’approche ou s’éloigne <strong>de</strong> l’observateur. 3<br />
11.7 Dilatation du temps<br />
Une autre conséquence notoire <strong>de</strong> la relativité est qu’une horloge en mouvement retar<strong>de</strong> par rapport<br />
à une horloge au repos. Pour démontrer cette assertion, utilisons encore une fois la transformation<br />
<strong>de</strong> Lorentz (11.20). Considérons une horloge au repos dans le référentiel S ′ (à une position x ′ ) qui<br />
produits <strong>de</strong>s ‘tics’ à un intervalle régulier. Cet intervalle est la pério<strong>de</strong> T 0 <strong>de</strong> l’horloge au repos. Dans<br />
le référentiel S, l’horloge se déplace à une vitesse V = V ˆx. Soit (x 1 , t 1 ) et (x 2 , t 2 ) les coordonnées<br />
associées à <strong>de</strong>ux ‘tics’ successifs <strong>de</strong> l’horloge. En utilisant la transformation <strong>de</strong> Lorentz inverse<br />
(11.21), on trouve<br />
(x 1 , t 1 ) = γ(x ′ + V t ′ 1 , t′ 1 + V x′ /c 2 ) (x 2 , t 2 ) = γ(x ′ + V t ′ 2 , t′ 2 + V x′ /c 2 ) (11.38)<br />
La pério<strong>de</strong> T <strong>de</strong> l’horloge dans S est la différence entre les temps <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux tics successifs :<br />
T = t 2 − t 1 = γ(t ′ 2 + V x ′ /c 2 − t ′ 1 − V x ′ /c 2 ) = γ(t ′ 2 − t ′ 1) = γT 0 (11.39)<br />
La pério<strong>de</strong> T est donc plus longue que la pério<strong>de</strong> au repos; il y a ‘dilatation du temps’:<br />
T = γT 0 =<br />
T 0<br />
√<br />
1 − V<br />
2<br />
/c 2 (11.40)<br />
Désintégration <strong>de</strong>s muons<br />
Le muon (µ) est un particule élémentaire instable <strong>de</strong> masse m µ =105,7 MeV et <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> vie<br />
τ µ = 2, 197 × 10 −6 s. On détecte une gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> muons au niveau du sol. Ces muons<br />
sont créés dans la haute atmosphère quand <strong>de</strong>s rayons cosmiques (par exemple <strong>de</strong>s protons ou <strong>de</strong>s<br />
photons) entrent en collision avec les noyaux <strong>de</strong>s molécules <strong>de</strong> l’atmosphère. Lors <strong>de</strong> ces collisions,<br />
<strong>de</strong>s mésons π (ou pions) sont créés. Ces mésons ont un temps <strong>de</strong> vie τ π = 2, 6 × 10 −8 s et se<br />
désintègrent en muons. D’autre part, les muons se désintègrent en électrons et en neutrinos :<br />
π − → µ − + ¯ν µ + 34 MeV<br />
τ π = 2, 6 × 10 −8 s<br />
µ − → e − + ¯ν e + ν µ + 105, 2 MeV τ µ = 2, 197 × 10 −6 s<br />
3 Cette question est expliquée <strong>de</strong> manière simple par V. Weisskopf dans Physics Today (sept. 1960) p.24.<br />
Weisskopf se base sur un article plus détaillé <strong>de</strong> J. Terell, Phys. Rev. 116 (1959) 1041.