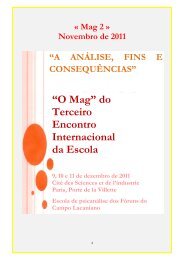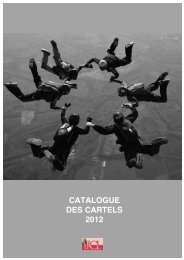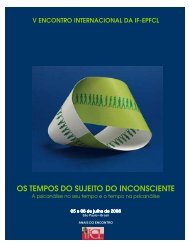O TEMPO NA DIREÃÃO DO TRATAMENTO
O TEMPO NA DIREÃÃO DO TRATAMENTO
O TEMPO NA DIREÃÃO DO TRATAMENTO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
séance à durée variable. Il s’agit donc de<br />
considérer que, logiquement, la finalité<br />
de la séance courte correspond à la<br />
formulation lacanienne de la création<br />
d’un dispositif où « le réel touche au réel<br />
». Cette perspective est relativisée si la<br />
séance analytique est conçue comme une<br />
séquence unitaire ponctuée par l’émergence<br />
de l’inconscient et dans le but de<br />
faire apparaître le sens ou la parole<br />
pleine.<br />
En réalité, au-delà de ce que l’inconscient<br />
dit, c’est le dire de l’inconscient qui<br />
est visé, cet indicible qui toutefois détermine<br />
l’ensemble des associations. Cela ne<br />
correspond ni à une technique active ni à<br />
une sacralisation de l’écoute. L’idée qu’un<br />
analyste se fait de la durée de la séance<br />
correspond, me semble-t-il, à l’idée qu’il<br />
se fait de l’inconscient. Et indépendamment<br />
de son usage, la séance courte est<br />
solidaire de l’option lacanienne qui<br />
conçoit un inconscient comme réel et<br />
vise l’os des élucubrations qui<br />
proviennent de l’inconscient. Cela se<br />
traduit par un effet analytique crucial<br />
relatif au fait que l’analyste sera plus<br />
susceptible d’être le temps, de l’incarner<br />
pour chaque analysant, au lieu de le<br />
penser.<br />
L’angoisse est le temps<br />
Prenons la question du point de vue du<br />
transfert. Tout au long de l’analyse, il ne<br />
se limite pas au temps de la rencontre<br />
avec l’analyste : l’inconscient, travailleur<br />
infatigable, ne se limite pas au travail<br />
pendant la séance. Bien plus,<br />
l’inconscient, travailleur idéal, ne fait<br />
aucune pause et se manifeste lorsqu’on<br />
s’y attend le moins. Un temps est donc<br />
nécessaire<br />
pour le déploiement de la logique symbolique<br />
qui correspond aux différents<br />
mythes sécrétés par l’inconscient et qui<br />
ont conduit à l’impasse sexuelle du sujet.<br />
Mais alors, pourquoi supposer que la<br />
séance devrait être rythmée par l’émergence<br />
de l’inconscient ? Au contraire, la<br />
séance peut être considérée comme le<br />
moment où l’analysant conclut une séquence<br />
d’élaboration.<br />
Au-delà d’un pousse-à-associer, chaque<br />
séance devrait être considérée comme<br />
une préparation à la rencontre avec le<br />
réel de la fin de l’analyse.<br />
Toutefois, pourquoi Lacan, en formulant<br />
: « le réel qui touche au réel », se<br />
réfère-t-il au discours analytique ? On<br />
peut percevoir que ce dernier a une<br />
structure semblable à celle de l’angoisse.<br />
Il suffit de revenir à la ligne supérieure<br />
du discours analytique qui va de a à et<br />
indique que l’analyste se trouve à la place<br />
de la cause du désir pour le sujet qui est<br />
aussi le lieu de l’angoisse.<br />
C’est cette perspective que Lacan<br />
privilégie concernant le temps, il en parle<br />
déjà dans le séminaire L’angoisse où il<br />
montre que la fonction de l’angoisse est<br />
d’introduire le sujet dans la dimension du<br />
temps. Lacan évoque une relation<br />
temporelle d’antériorité par rapport au<br />
désir et considère que la dimension<br />
temporelle de l’angoisse équivaut à la<br />
dimension temporelle de l’analyse. En<br />
effet, l’angoisse prépare le rendez-vous<br />
avec le désir. Il n’est pas surprenant que<br />
Lacan ait utilisé la même formule<br />
concernant le « maniement de l’angoisse<br />
» et le « maniement du temps » : l’un est<br />
solidaire de l’autre.<br />
Le fait de situer le temps de l’analyse<br />
en fonction de l’angoisse est une perspective<br />
déjà signalée par Freud, faisant de<br />
l’angoisse un point nodal dans la représentation<br />
du temps. L’angoisse, dont<br />
l’omission est au coeur de la constitution<br />
du trauma, constitue une médiation face<br />
à l’urgence pulsionnelle ou face au désir<br />
de l’Autre. À cet égard, Freud, confronté<br />
à l’abstraction du temps de la conscience,<br />
favorise le temps de l’angoisse qui<br />
s’oppose au temps du symptôme.<br />
L’angoisse introduit une discontinuité là<br />
où le symptôme assure une permanence.<br />
Le symptôme ralentit le temps parce que<br />
sa temporalité est déterminée par sa<br />
propre constitution, à savoir celle d’un<br />
temps qui s’est arrêté.<br />
C’est ce que la clinique analytique démontre.<br />
Le sujet supplée, avec le fantasme,<br />
le manque de certitude de l’inconscient,<br />
et c’est dans la vacillation du<br />
fantasme qu’émerge une autre tempo-<br />
Heteridade 7<br />
Internacional dos Fóruns-Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano 15