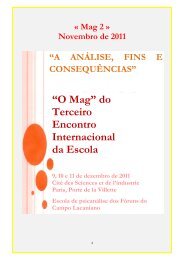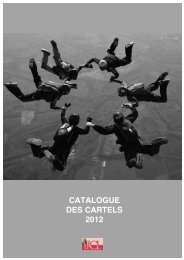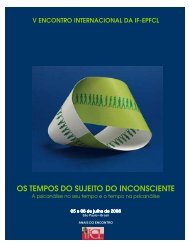O TEMPO NA DIREÃÃO DO TRATAMENTO
O TEMPO NA DIREÃÃO DO TRATAMENTO
O TEMPO NA DIREÃÃO DO TRATAMENTO
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
moindre exploit dans cette rencontre,<br />
juste une question de bon/ne heur/e.<br />
Belle ne veut pas courir le risque de savoir<br />
la suite de l’histoire, elle se fait<br />
absence éternelle pour soutenir une<br />
attente toujours insatisfaite. Assassine<br />
narcissique du désir, elle ne voit pas le<br />
temps passer. L’heure de la mort la laisse<br />
indifférente, à peine l’aperçoit-elle quand<br />
un proche en reçoit la visite funeste.<br />
Se mettre à l’heure<br />
Il serait souhaitable que ces patients,<br />
qui incarnent particulièrement<br />
l’équivoque du signifiant - ils ne sont que<br />
trop patients, trouvent dans l’analyse une<br />
mise à l’heure qui ne soit pas tant celle de<br />
l’inconscient/savoir qui ignore le temps,<br />
mais celle du réel, c’est-à-dire celle de la<br />
mort. Côté inconscient, le déroulement<br />
de la chaîne signifiante versus énoncé<br />
privilégie le mode diachronique, organisé<br />
par les bornes signifiantes de la castration<br />
tout en restant sous le contrôle d’une<br />
représentation consciente, construite et<br />
symbolisée, du temps. Il faut une<br />
intervention particulière pour rompre le<br />
fil de l’automatum, laisser place à la tuché de<br />
l’énonciation et toucher à la synchronie<br />
intemporelle du symptôme. C’est<br />
pourquoi Lacan a introduit dans la<br />
conduite même de la cure un acte<br />
affectant le temps concret, pour que<br />
l’analysant lasse le hors-temps de la<br />
jouissance et entre dans le temps,<br />
compté, comptable, du désir. Ainsi il<br />
s’agit de viser un bouclage de la série des<br />
signifiants non sur les tours de la vaine<br />
répétition mais sur une construction et<br />
une traversée du fantasme qui brise sa<br />
fixité pulsionnelle et re/met à jour le<br />
rapport du sujet à l’impossible.<br />
Seule la mort est immortelle<br />
La psychanalyse avec les enfants est<br />
particulièrement instructive car l’enfantanalysant<br />
baigne dans la matérialité du<br />
signifiant et il parle le réel, ce que les dits<br />
‘mots d’enfants’ illustrent.<br />
La question de la mort se présente à<br />
l’enfant en même temps que celle de la<br />
vie, instant de voir 92 . Le petit sujet,<br />
lorsqu’il se découvre seul et limité en<br />
entrant dans la période de névrose infantile,<br />
temps pour comprendre, explore avec<br />
ses théories sexuelles infantiles toutes les<br />
hypothèses sur le non-sens de l'existence.<br />
La conscience d'une origine s'impose, et<br />
il fait vite l’hypothèse que s'il y a un<br />
début alors il y a une fin. Derrière toutes<br />
les questions sur la naissance des bébés,<br />
sur l’énigme de la différence des sexes, se<br />
profilent, le plus souvent muettes, celles<br />
sur le devenir de chacun. Ainsi d’emblée,<br />
sexe, vie et mort se trouvent noués par le<br />
désir de savoir et les limites de ses<br />
pouvoirs. L'enfant rencontre avec<br />
horreur cette face de réel qui reste pour<br />
partie hors d’atteinte, hormis par ce que<br />
l’assomption symbolique de la castration<br />
pourra en métaboliser, en laissant<br />
l’essentiel à charge d’une ‘insondable<br />
décision’.<br />
Et seul le vivant est mortel<br />
Ce garçon de huit ans va scander en<br />
quelques séances, après un certain<br />
nombre de rencontres sans conséquence,<br />
le passage d’une angoisse de castration<br />
qui s’exprimera en angoisse de mort à la<br />
possibilité de la castration assumée,<br />
vecteur de solitude mais aussi de désir.<br />
Un malheureux accident d'arbre lui<br />
vaut un bras cassé. La chose reste banale<br />
jusqu'au jour où le plâtre est enlevé.<br />
L'enfant est saisi d'effroi devant la scie,<br />
devient blême et s'effondre. Depuis il<br />
est, dit-il, obsédé par la mort, ce qui<br />
signifie pour lui « ne plus voir la maison,<br />
ni papa, ni maman ». Dans un premier<br />
rêve, une imago paternelle digne du père<br />
de la horde primitive apparaît comme<br />
agent d’une modalité du manque qui<br />
relève surtout de la castration<br />
imaginaire : « ( ... ) le chef, il faisait peur.<br />
Son nom c’est Croque-tout. C'est un<br />
monstre qui mange tout, et tout le<br />
monde ». Reconnaissons au passage la<br />
figure de l’ogre, ce mangeur d’enfants<br />
dont le premier est Cronos, qui incarne<br />
92<br />
Cf. Hans : « la présence du thème de la mort<br />
est strictement corrélative du thème de la<br />
naissance ». Lacan J., Le séminaire livre IV, La<br />
relation d’objet, Paris, Seuil, 1994, p.413.<br />
Heteridade 7<br />
Internacional dos Fóruns-Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano 59