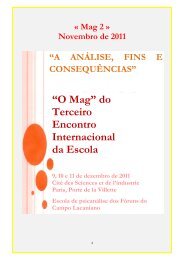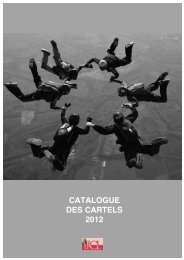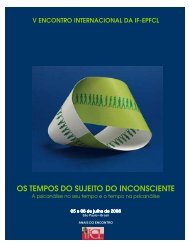O TEMPO NA DIREÃÃO DO TRATAMENTO
O TEMPO NA DIREÃÃO DO TRATAMENTO
O TEMPO NA DIREÃÃO DO TRATAMENTO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Temps logique et temps arrêté, incidences<br />
cliniques<br />
Jean-Jacques Gorog<br />
e temps logique est celui<br />
L<br />
du signifiant dans sa<br />
dynamique propre,<br />
interprétable avec<br />
efficacité parce qu’il<br />
implique une conclusion<br />
possible. Mais il arrive<br />
que le temps s’arrête. Il<br />
manifeste alors sa présence. Comme le<br />
corps quand il est malade. Cet arrêt peut<br />
relever de structures cliniques variées et<br />
suppose des réponses adaptées. En<br />
réalité il impose de situer à sa place<br />
l’objet a lacanien.<br />
Lorsqu’on tente de faire la présentation<br />
d’un exposé, longtemps à l’avance, il se<br />
glisse une ambition, légitime sans doute<br />
mais fort difficile à satisfaire lorsqu’on se<br />
trouve au pied du mur. Qu’importe, c’est<br />
une façon certes risquée mais souvent<br />
efficace de se forcer à agir, à penser, et<br />
comme toujours avec un temps qui se<br />
compte à partir de sa limite, son moment<br />
de conclure.<br />
Lacan met l’accent, j’ai tenté de le faire<br />
déjà dans un texte qui a été écrit en<br />
préambule à ces journées, sur le<br />
franchissement opéré dans ce qu’il<br />
appelle le moment de conclure et qu’il<br />
théorisera avec l’acte dans le séminaire du<br />
même nom.<br />
Mon propos est ici de revenir sur les<br />
franchissements impossibles que pour<br />
l’occasion je traiterai en termes de temps,<br />
le temps arrêté.<br />
Dans son ouvrage, Le tempo de la pensée,<br />
Patrice Loraux considère que c’est un<br />
problème général de la philosophie :<br />
« Bref au seuil de l’épreuve de réalité, la<br />
pensée, prise d’une fatale inspiration,<br />
s’octroie un temps d’arrêt où elle juge<br />
devoir faire le point, en ce lieu critique<br />
où elle assume le risque de rester à jamais<br />
l’ombre d’une opération 127 . »<br />
127<br />
LORAUX, P. Le tempo de la pensée, Paris, Seuil,<br />
1993, p.24.<br />
On reconnaîtra dans cette thématique,<br />
et d’ailleurs citée dans ce texte, la<br />
procrastination bien connue de<br />
l’obsessionnel : pas étonnant puisqu’il<br />
fait symptôme de sa pensée. Cela dit,<br />
celui-ci peut espérer de la psychanalyse<br />
qu’elle parvienne à en réduire les effets.<br />
Mais il n’y aura pas lieu d’être surpris<br />
non plus qu’il évoque souvent dans un<br />
autre registre Wittgenstein, et critique<br />
« présupposition et tautologie » comme<br />
étant les deux formes de ce qui arrête la<br />
pensée, cette pensée qui « ignore le<br />
temps bousculé, le temps qui manque de<br />
temps ». Il ironise même : « Se mouvoir<br />
dans la présupposition et la tautologie<br />
passe pour l’indice qu’on pense 128 . »<br />
La phrase « Qu’on dise reste oublié<br />
derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend<br />
129 », implique l’oubli de ce que<br />
Lacan appelle ici, dans « L’étourdit », le<br />
dire par opposition aux dits, notamment<br />
de l’inconscient. Autrement dit l’analyste<br />
peut bien relever les dits de l’inconscient<br />
de son analysant, il ne peut en restituer le<br />
dire, soit le temps où ça s’est dit. Pour<br />
une part, ceci recouvre le fait qu’il n’y a<br />
pas de point de vue extérieur qui<br />
permette d’observer le langage, qu’il n’y a<br />
pas de métalangage.<br />
Mon hypothèse est que dans la psychose,<br />
ce dire-là, tout se passe comme s’il<br />
n’était pas oublié. On le vérifie avec<br />
l’hallucination dont la perception<br />
s’éternise, et qui justement ne passe pas<br />
au dit. C’est d’ailleurs pourquoi il n’y a<br />
pas de distance entre la voix et le dit ;<br />
ainsi, par exemple, ce que dit la voix est<br />
indiscutable. On sait que par l’opération<br />
analytique, c’est à ne pas mettre en doute<br />
l’existence même de la voix qu’on obtient<br />
que puisse venir au débat ce que dit la<br />
voix, que quelque chose donc se détache<br />
128<br />
Idem p.335.<br />
129<br />
LACAN, J. « L’étourdit », Autres écrits, Paris,<br />
Seuil, 2001, p.449.<br />
Heteridade 7<br />
Internacional dos Fóruns-Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano 88