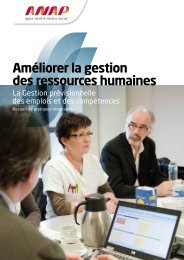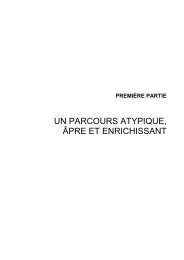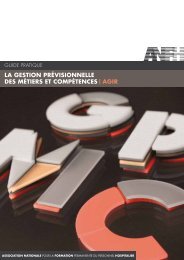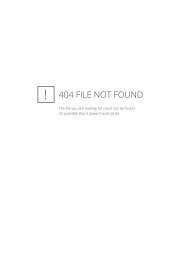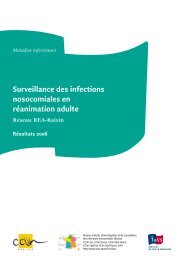Hospitalisation à domicile (HAD) - La Documentation française
Hospitalisation à domicile (HAD) - La Documentation française
Hospitalisation à domicile (HAD) - La Documentation française
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
112 IGAS, RAPPORT N°RM2010-109P<br />
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯<br />
[525] 21 dossiers ont ainsi été rejetés par la COMEX de 2006 à 2009, dont 10 en 2006. <strong>La</strong> plupart de ces<br />
rejets concernent des <strong>HAD</strong> « autonomes » conformément au choix, inscrit dans le SROS, de privilégier<br />
les structures rattachées. L’APARD a ainsi dû déposer un dossier par trois fois avant d’obtenir une<br />
autorisation sur Montpellier. A Nîmes, la même association a dû présenter sa candidature deux fois et<br />
introduire un recours contre le refus qui lui avait été opposé en 2006 avant d’obtenir une autorisation en<br />
2007.<br />
[526] Les réticences de l’ARH vis-à-vis des <strong>HAD</strong> autonomes semblent avoir été renforcées par une<br />
circulaire de la DHOS du 11 février 2008 imposant, pour obtenir une autorisation d’<strong>HAD</strong>, de détenir ou<br />
d’obtention une autorisation pour l'activité de soins concernée (médecine). Ce type d’autorisation n'étant,<br />
dans certains cas, pas disponibles au bilan, des demandes ont été rejetées. Il s’agit là d’une lecture très<br />
restrictive de la réglementation - et de la circulaire en question – qu’on ne rencontre pas dans les autres<br />
régions. L’ARH semble avoir progressivement renoncé à cette politique puisque, depuis 2008, 3 <strong>HAD</strong><br />
autonomes ont été autorisées.<br />
[527] Enfin, les difficultés rencontrées par l’<strong>HAD</strong> dans la région tiennent à l’orientation « gérontologique »<br />
du SROS. L’assurance maladie relevait ainsi, dans une note datée de 2009, que les priorités du SROS<br />
étaient en décalage par rapport aux instructions ministérielles (circulaire du premier décembre 2006) qui<br />
insistent sur la vocation polyvalente et généraliste de l’<strong>HAD</strong>. L’assurance maladie observait également<br />
qu’il y a un décalage entre l’objectif du SROS fondé sur une cible nationale de 8000 places alors que la<br />
circulaire de 2006 fixe un objectif de 15000 places en 2010. En prenant cette référence et celle de la<br />
population totale, il était donc préconisé de rectifier le nombre d’implantations à autoriser en faveur,<br />
notamment, de Montpellier.<br />
[528] Même si le SROS n’a pas été amendé, ces orientations guident depuis la politique d’autorisation.<br />
Deux implantations sont ainsi prévues, l’une à Alès et l’autre à Montpellier. L’ARS entend ainsi couvrir<br />
tout le territoire régional à travers des sites (de 30 places environ avec, le cas échéant, des antennes de 15<br />
places) et en instaurant, dans les plus grandes agglomérations, une concurrence entre <strong>HAD</strong> (Montpellier,<br />
Nîmes et Perpignan). Cette concurrence pose d’ailleurs question lors de la phase de démarrage, alors que<br />
la solidité financière des structures n’est pas assurée (les opérateurs souhaiteraient un « bornage » de leurs<br />
territoires d’intervention).<br />
[529] Au final, le développement de l’<strong>HAD</strong> dans la région semble avoir souffert d’une conjonction<br />
d’éléments défavorables : des opérateurs sanitaires peu intéressés, des tensions entre les acteurs (entre les<br />
hôpitaux et les cliniques, l’hôpital et la médecine de ville…), une politique régionale très prudente…<br />
[530] Grâce aux inflexions prises depuis deux ans, la région est désormais presque intégralement couverte et<br />
on peut espérer que les autorisations accordées seront effectivement exploitées. <strong>La</strong> volonté de l’ARS est<br />
de développer l’<strong>HAD</strong>.<br />
2.1.3. Autres démarches<br />
[531] L’ARH a fait de la continuité et de la permanence des soins une priorité en matière d’<strong>HAD</strong>. Ces<br />
établissements doivent donc assurer, eux-mêmes, non seulement une permanence paramédicale mais<br />
également médicale, sans se reposer sur le C15, SOS Médecins ou la PDS de droit commun. Ils doivent<br />
également respecter des délais d’intervention maxima de 30 minutes 27 , ce qui impose la création<br />
d’antennes dans les parties les plus éloignées de leur zone d’intervention. Ces conditions ont obligé<br />
certaines <strong>HAD</strong> à organiser un système d’astreintes avec des médecins généralistes se relayant d’une<br />
semaine sur l’autre, moyennant une compensation financière substantielle (450 € par semaine) qui pèse<br />
sur la rentabilité de ces structures.<br />
27 Le délai d'intervention de 30 mn est issu d'une position prise, lors d'une commission exécutive de l'ARH du <strong>La</strong>nguedoc<br />
Roussillon le 19/12/2007, par Madame Elisabeth HUBERT, Présidente de la FNE<strong>HAD</strong>, en référence à la circulaire DHOS du 1er<br />
décembre 2006. Cette circulaire précise que les objectifs d'implantation peuvent être exprimés "en temps maximum d'accès, dans<br />
un territoire de santé, à un établissement exerçant une activité de soins". Ce temps de trajet de 30 mn a été retenu en région parmi<br />
les critères d'implantation.