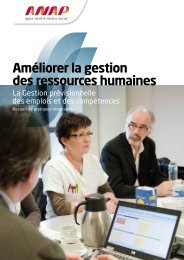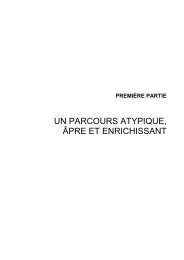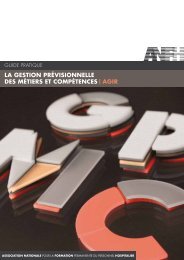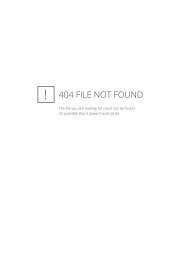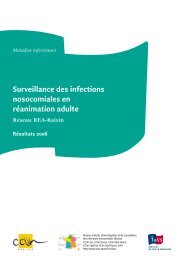Hospitalisation à domicile (HAD) - La Documentation française
Hospitalisation à domicile (HAD) - La Documentation française
Hospitalisation à domicile (HAD) - La Documentation française
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IGAS, RAPPORT N°RM2010-109P 27<br />
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯<br />
[88] Les limites de la médicalisation des EHPAD constituent également un frein puissant à<br />
l’intervention de l’<strong>HAD</strong>. Comme la confirme une étude récente 11 , une part importante des résidents<br />
en EHPAD (70%) effectuent des séjours fréquents en hôpital. Ainsi, 25% des patients des 300<br />
EHPAD de l’enquête ont été admis ou sont sortis de l’hôpital ces derniers mois. Une pathologie<br />
somatique serait en cause dans 70% des cas d’hospitalisation qui ont lieu le plus souvent en<br />
urgence. Cette situation traduit certainement les changements intervenus dans l’état de santé de la<br />
population accueillie en EHPAD mais elle reflète aussi les habitudes assez enracinées de recours à<br />
l’hospitalisation en urgence. C’est donc d’une certaine manière une conséquence des difficultés à<br />
assurer des prises en charge lourdes dans des établissements qui ne disposent pas d’infirmières de<br />
nuit ou dans lesquels les médecins coordinateurs sont présents pour des durées très limitées. Dans<br />
ce contexte, le faible recours à l’<strong>HAD</strong> s’explique dans une large mesure par l’impossibilité<br />
d’assurer au niveau de l’EHPAD sa part dans les soins médicaux et paramédicaux.<br />
1.3.3.3. L’articulation avec les réseaux<br />
[89] Lors de ses enquêtes de terrain, la mission a constaté que les relations avec les réseaux étaient<br />
très différentes d’un territoire à l’autre. D’une manière générale, elles sont essentiellement<br />
développées avec les réseaux de soins palliatifs ; d’autant plus que certaines structures d’<strong>HAD</strong><br />
trouvent leur origine dans ces réseaux. Le partage se fait en fonction du caractère plus ou moins<br />
lourd des patients et donc de la technicité de l’intervention : par exemple pour les soins palliatifs, le<br />
réseau ayant en charge avec les médecins de ville, les patients légers en articulation avec l’équipe<br />
mobile de l’hôpital. Cependant, ces règles sont définies au cas par cas, de manière empirique.<br />
1.3.3.4. Une complémentarité limitée avec les prestataires médico-techniques<br />
[90] Les relations entre les structures d’<strong>HAD</strong> et les prestataires qui interviennent à <strong>domicile</strong> pour la<br />
mise en place de dispositifs médicaux sont relativement complexes et peuvent être, dans certains<br />
cas, sources de tensions. En principe, les relations devraient s’organiser en complémentarité,<br />
notamment lorsque l’<strong>HAD</strong> fait appel à des prestataires techniques pour leur sous-traiter la mise en<br />
place de dispositifs. De fait, elles sont devenues plus délicates dans la mesure où les prestataires<br />
médico-techniques ont diversifié leurs interventions. Initialement concentrés sur la gestion<br />
d’équipements d’assistance respiratoire à <strong>domicile</strong>, c'est-à-dire l’oxygénothérapie puis le traitement<br />
de l’apnée du sommeil et la ventilation, les prestataires - ou du moins certains d’entre eux - sont<br />
intervenus sur des prises en charge comportant davantage de services et étroitement liés à des<br />
séquences de soins nécessitant la coordination de plusieurs intervenants (antibiothérapie,<br />
chimiothérapie, nutrition entérale, patients diabétiques, traitement de la douleur, traitement de la<br />
maladie de parkinson, insulinothérapie par pompe à <strong>domicile</strong>, immunothérapie, etc. ).<br />
[91] Cette évolution est perçue assez négativement par les <strong>HAD</strong> qui considèrent qu’on se situe aux<br />
limites de la confusion des genres : fort démarchage et techniques commerciales de communication<br />
voire usurpation de la qualité d’<strong>HAD</strong> et donc d’établissement de santé pour des prestations dont le<br />
moindre coût ne serait pas démontré et dont la qualité de service ne serait pas garantie. En sens<br />
inverse, les prestataires médico-techniques mettent en avant les coûts élevés, à qualité qui serait<br />
égale, de l’<strong>HAD</strong> et la faible réactivité des structures d’<strong>HAD</strong> qui justifieraient leur intervention sur<br />
son champ de compétence. <strong>La</strong> mission n’avait pas la possibilité de mener les études médicoéconomiques<br />
nécessaires pour objectiver ces débats mais elle a pu constater que les modes de<br />
régulation, notamment tarifaires, appliqués aux deux types de structures étaient très différents alors<br />
qu’il y a des recoupements dans les champs d’intervention.<br />
11 Gérontopôle de Toulouse « Etude sur la fréquence et l’impact des hospitalisations des personnes âgées en<br />
établissement » juin 2010.