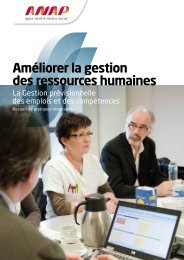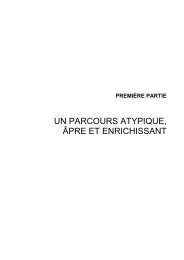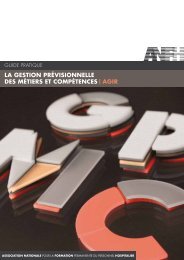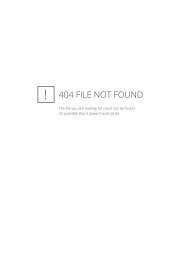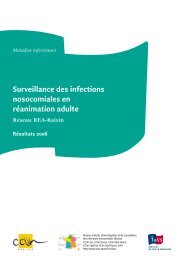Hospitalisation à domicile (HAD) - La Documentation française
Hospitalisation à domicile (HAD) - La Documentation française
Hospitalisation à domicile (HAD) - La Documentation française
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
60 IGAS, RAPPORT N°RM2010-109P<br />
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯<br />
[282] Compte tenu de la dispersion des patients, la réussite de l’<strong>HAD</strong> en zone rurale passe par un<br />
partenariat étroit avec les intervenants libéraux (cf. infra) et, dans la mesure du possible, avec les<br />
SSIAD (mise à disposition ponctuelle d’aides-soignants, notamment dans les zones les plus<br />
éloignées, cf. infra). <strong>La</strong> taille critique étant plus difficile à atteindre dans ces zones, le<br />
développement d’<strong>HAD</strong> en milieu rural repose également sur une coopération accrue entre<br />
établissements (notamment pour la permanence des soins) ou la création d’« antennes » rattachées<br />
à des établissements installés en zone urbaine. Cet adossement permet en effet de concilier<br />
proximité et efficacité. Enfin, la télémédecine ouvre des pistes potentiellement intéressantes pour la<br />
couverture des zones rurales.<br />
[283] Si la concurrence entre <strong>HAD</strong> peut être une source d’émulation et d’efficience, elle ne semble<br />
pas opportune dans les bassins de population les moins denses, ni en phase de développement de<br />
l’offre. Elle doit donc être limitée, dans un premier temps, aux zones urbaines les plus densément<br />
peuplées, dès que les structures ont atteint une certaine maturité. Ailleurs, un partage exclusif paraît<br />
plus approprié, à condition que chaque <strong>HAD</strong>, même celle rattachée à un établissement de santé,<br />
s’engage à collaborer avec tous les prescripteurs, vis-à-vis de l’ARS (CPOM avec indicateurs de<br />
suivi) et des établissements hospitaliers (comité des prescripteurs).<br />
Recommandation n°8 : Contribuer à la coordination des différents acteurs de prise en<br />
charge à <strong>domicile</strong>.<br />
[284] Bien qu’appartenant au monde hospitalier, l’<strong>HAD</strong> constitue une forme de prise en charge à<br />
<strong>domicile</strong>, un domaine marqué à la fois par une grande hétérogénéité (acteurs hospitaliers, libéraux,<br />
médico-sociaux et sociaux) et une faible structuration.<br />
[285] Même si cette question dépasse, de loin, celle de l’<strong>HAD</strong>, celle-ci peut apporter sa contribution<br />
à la coordination de ces différents acteurs et, ainsi, à l’amélioration du continuum de prise en<br />
charge et à l’optimisation des ressources. Elle peut notamment apporter son expérience et son<br />
savoir-faire dans les domaines clefs tels que la permanence des soins, la coordination<br />
pluridisciplinaire, le partage d’information, la protocolisation… Si l’<strong>HAD</strong> ne peut, à elle seule,<br />
coordonner l’ensemble des prises en charge à <strong>domicile</strong> et encore moins organiser les soins<br />
primaires, elle peut constituer un point d’appui utile.<br />
[286] L’élaboration des projets territoriaux de santé dans le cadre des futurs PRS et des SROS peut<br />
être, sous l'égide des ARS, l’occasion pour les différentes parties prenantes, en particulier les<br />
professionnels de santé libéraux, d’identifier des pistes de coopération (échange d’informations et<br />
de bonnes pratiques, communication en direction des prescripteurs, élaboration de protocoles<br />
partagés, mutualisation de certaines fonctions, interconnexion des systèmes d’information,<br />
télémédecine…) puis d’expérimenter, des outils de coordination auquel les établissements d’<strong>HAD</strong><br />
pourront apporter leur contribution.<br />
[287] Cette contribution peut prendre de multiples formes, en fonction des besoins et des projets<br />
exprimés par les acteurs de terrain. Elle peut ainsi aller de l’appui technique à la création de<br />
maisons et pôles de santé à la constitution d’opérateurs polyvalents (opérateurs offrant des services<br />
diversifiés de prise en charge à <strong>domicile</strong>) en passant par la mise en place de structures de<br />
coordination plus ou moins intégrées (du partage d’information et de bonnes pratiques à la<br />
mutualisation de ressources et de fonctions telles que la téléassistance ou la télésurveillance).<br />
Recommandation n°9 : Faciliter la coopération entre <strong>HAD</strong> et SSIAD en systématisant les<br />
conventions de relais et de mutualisation des ressources.<br />
[288] Dans l’effort général de structuration des soins à <strong>domicile</strong>, la coopération entre ses deux<br />
acteurs principaux, SSIAD et <strong>HAD</strong>, mérite une attention particulière afin, d’une part, d’améliorer<br />
la continuité de la prise en charge et, d’autre part, d’optimiser leurs moyens.