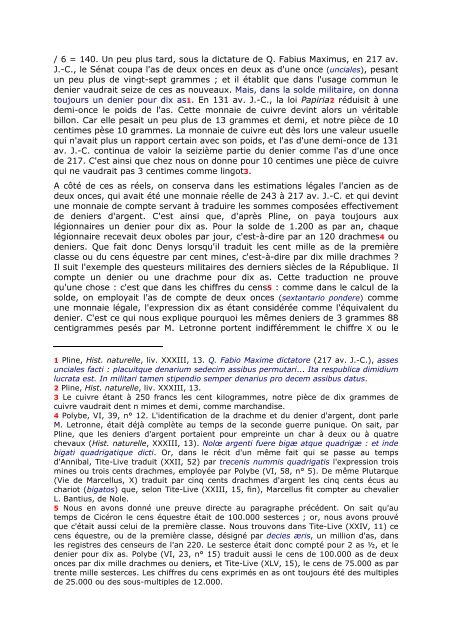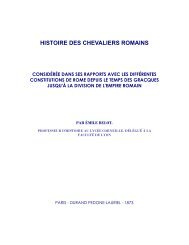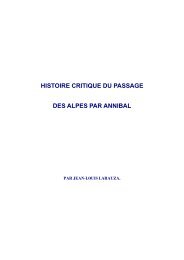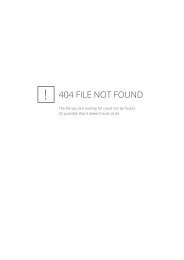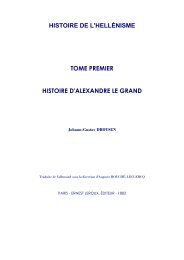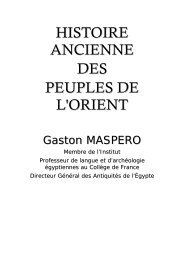HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
6 = 140. Un peu plus tard, sous la dictature de Q. Fabius Maximus, en 217 av.<br />
J.-C., le Sénat coupa l'as de deux onces en deux as d'une once (unciales), pesant<br />
un peu plus de vingt-sept grammes ; et il établit que dans l'usage commun le<br />
denier vaudrait seize de ces as nouveaux. Mais, dans la solde militaire, on donna<br />
toujours un denier pour dix as1. En 131 av. J.-C., la loi Papiria2 réduisit à une<br />
demi-once le poids de l'as. Cette monnaie de cuivre devint alors un véritable<br />
billon. Car elle pesait un peu plus de 13 grammes et demi, et notre pièce de 10<br />
centimes pèse 10 grammes. La monnaie de cuivre eut dès lors une valeur usuelle<br />
qui n'avait plus un rapport certain avec son poids, et l'as d'une demi-once de 131<br />
av. J.-C. continua de valoir la seizième partie du denier comme l'as d'une once<br />
de 217. C'est ainsi que chez nous on donne pour 10 centimes une pièce de cuivre<br />
qui ne vaudrait pas 3 centimes comme lingot3.<br />
A côté de ces as réels, on conserva dans les estimations légales l'ancien as de<br />
deux onces, qui avait été une monnaie réelle de 243 à 217 av. J.-C. et qui devint<br />
une monnaie de compte servant à traduire les sommes composées effectivement<br />
de deniers d'argent. C'est ainsi que, d'après Pline, on paya toujours aux<br />
légionnaires un denier pour dix as. Pour la solde de 1.200 as par an, chaque<br />
légionnaire recevait deux oboles par jour, c'est-à-dire par an 120 drachmes4 ou<br />
deniers. Que fait donc Denys lorsqu'il traduit les cent mille as de la première<br />
classe ou du cens équestre par cent mines, c'est-à-dire par dix mille drachmes ?<br />
Il suit l'exemple <strong>des</strong> questeurs militaires <strong>des</strong> derniers siècles de la République. Il<br />
compte un denier ou une drachme pour dix as. Cette traduction ne prouve<br />
qu'une chose : c'est que dans les chiffres du cens5 : comme dans le calcul de la<br />
solde, on employait l'as de compte de deux onces (sextantario pondere) comme<br />
une monnaie légale, l'expression dix as étant considérée comme l'équivalent du<br />
denier. C'est ce qui nous explique pourquoi les mêmes deniers de 3 grammes 88<br />
centigrammes pesés par M. Letronne portent indifféremment le chiffre X ou le<br />
1 Pline, Hist. naturelle, liv. XXXIII, 13. Q. Fabio Maxime dictatore (217 av. J.-C.), asses<br />
unciales facti : placuitque denarium sedecim assibus permutari... Ita respublica dimidium<br />
lucrata est. In militari tamen stipendio semper denarius pro decem assibus datus.<br />
2 Pline, Hist. naturelle, liv. XXXIII, 13.<br />
3 Le cuivre étant à 250 francs les cent kilogrammes, notre pièce de dix grammes de<br />
cuivre vaudrait dent n mimes et demi, comme marchandise.<br />
4 Polybe, VI, 39, n° 12. L'identification de la drachme et du denier d'argent, dont parle<br />
M. Letronne, était déjà complète au temps de la seconde guerre punique. On sait, par<br />
Pline, que les deniers d'argent portaient pour empreinte un char à deux ou à quatre<br />
chevaux (Hist. naturelle, XXXIII, 13). Nolœ argenti fuere bigæ atque quadrigæ : et inde<br />
bigati quadrigatique dicti. Or, dans le récit d'un même fait qui se passe au temps<br />
d'Annibal, Tite-Live traduit (XXII, 52) par trecenis nummis quadrigatis l'expression trois<br />
mines ou trois cents drachmes, employée par Polybe (VI, 58, n° 5). De même Plutarque<br />
(Vie de Marcellus, X) traduit par cinq cents drachmes d'argent les cinq cents écus au<br />
chariot (bigatos) que, selon Tite-Live (XXIII, 15, fin), Marcellus fit compter au chevalier<br />
L. Bantius, de Nole.<br />
5 Nous en avons donné une preuve directe au paragraphe précédent. On sait qu'au<br />
temps de Cicéron le cens équestre était de 100.000 sesterces ; or, nous avons prouvé<br />
que c'était aussi celui de la première classe. Nous trouvons dans Tite-Live (XXIV, 11) ce<br />
cens équestre, ou de la première classe, désigné par decies æris, un million d'as, dans<br />
les registres <strong>des</strong> censeurs de l'an 220. Le sesterce était donc compté pour 2 as ½, et le<br />
denier pour dix as. Polybe (VI, 23, n° 15) traduit aussi le cens de 100.000 as de deux<br />
onces par dix mille drachmes ou deniers, et Tite-Live (XLV, 15), le cens de 75.000 as par<br />
trente mille sesterces. Les chiffres du cens exprimés en as ont toujours été <strong>des</strong> multiples<br />
de 25.000 ou <strong>des</strong> sous-multiples de 12.000.