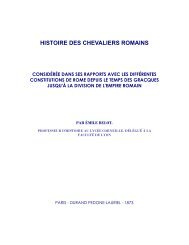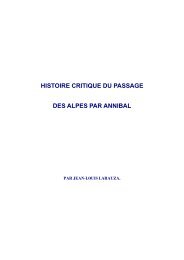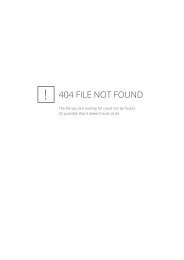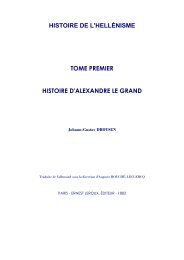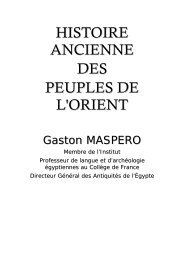HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
montrent que la population de la ville et la population rurale étaient ri peu prés<br />
en nombre égal. Mais la première exerçait seule les droits politiques. Les<br />
plébéiens de la campagne ne jouissaient que <strong>des</strong> droits civils et, en échange, ils<br />
devaient contribuer de leur sang et de leur argent à la défense commune de<br />
l'État. Jusqu'à l'an 509 av. J.-C., ils n'occupèrent pas, dans le royaume de<br />
Servius ou de Tarquin, un rang beaucoup plus élevé que celui qui fut assigné aux<br />
alliés Latins sous la République romaine.<br />
Les conquêtes de Tarquin-le-Superbe, qui donna le droit de cité aux habitants de<br />
Gabies1, augmentèrent le nombre total <strong>des</strong> citoyens et, depuis le règne de<br />
Servius Tullius jusqu'à l'expulsion <strong>des</strong> Tarquins, on le trouve porté de quatrevingt<br />
à cent trente mille2. Mais la population urbaine s'accroissait comme celle<br />
<strong>des</strong> campagnes : si le territoire s'agrandissait et se peuplait, <strong>des</strong> familles nobles,<br />
comme les Valerius d'Eretum3, les Appius de Regilli4, venaient s'établir à Rome<br />
avec de nombreux serviteurs, et maintenaient la prépondérance de la ville.<br />
Riais, en 509 av. J.-C., l'aristocratie de Rome, pour chasser les Tarquins, dut<br />
payer de quelques concessions politiques le concours <strong>des</strong> plébéiens de la<br />
campagne. Les cadres <strong>des</strong> classes et <strong>des</strong> centuries qui, jusque-là, n'avaient servi<br />
qu'au recrutement et à la levée <strong>des</strong> impôts, devinrent ceux d'une assemblée<br />
politique, où les paysans paraissaient exercer les mêmes droits que les Quirites<br />
de la ville. Il y eut alors deux peuples en un : le premier, plus restreint, celui de<br />
la ville, qui, divisé par races et par clienteles5, votait dans les comices curiates ;<br />
le second, plus complet, celui du territoire entier, Rome comprise, qui, divisé par<br />
classes, votait dans l'assemblée <strong>des</strong> centuries. La voix <strong>des</strong> trente licteurs<br />
appelait, comme autrefois, les Quirites de la ville à l'assemblée <strong>des</strong> curies. Le son<br />
du cor, qui était dans le camp le signal du mouvement <strong>des</strong> drapeaux, convoquait<br />
au Champ-de-Mars, en dehors de l'enceinte sacrée du Pomœrium, les classes de<br />
l'armée civile de Servius6. Le peuple <strong>des</strong> curies donnait seul l'imperium qui ne<br />
pouvait s'exercer qu'en dehors <strong>des</strong> limites de la ville. Le peuple <strong>des</strong> centuries<br />
désignait, il est vrai, ceux à qui devait être confié le commandement militaire ;<br />
mais il se composait de ceux qui devaient le subir. Un consul présidant<br />
l'assemblée centuriate au Champ-de-Mars, pouvait, s'il n'était pas encore rentré<br />
dans Rome, où finissait son droit de vie et de mort, menacer de ses haches un<br />
votant ou un candidat, comme s'il eût encore commandé au milieu d'un camp7.<br />
Le droit de vote <strong>des</strong> plébéiens de la campagne dans l'assemblée centuriate était<br />
à peu près illusoire. Dans cette institution où les historiens modernes ont cherché<br />
un progrès de la démocratie, les anciens n'ont vu qu'un stratagème politique<br />
<strong>des</strong>tiné à tromper la plèbe et à lui cacher sa nullité réelle8. Mais ce n'est pas au<br />
bon roi Servius qu'il faut imputer l'invention de cette liberté mensongère. On y<br />
sent partout l'habileté persévérante <strong>des</strong> patriciens, qui, obligés à <strong>des</strong><br />
concessions, travaillent à en détruire l'effet, et veulent retenir pour eux seuls<br />
l'autorité qu'ils ont l'air de partager.<br />
1 Denys, IV, 58.<br />
2 Denys, V, 20.<br />
3 Valère Maxime, liv. II, ch. IV, n° 5.<br />
4 Suétone, Vie de Tibère, 1.<br />
5 Lælius Félix, dans Aulu-Gelle, XV, 27.<br />
6 Varron, De lingua latina, liv. V, fin.<br />
7 Tite-Live, XXIV, 9.<br />
8 Denys, IV, 21.