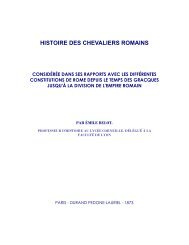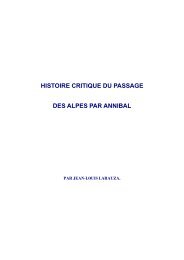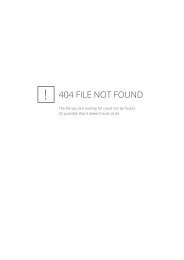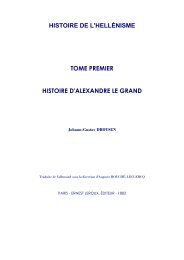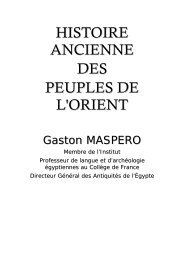HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
son histoire politique de celle de la constitution de Servius. D'un autre côté, les<br />
six premières centuries de chevaliers, ayant voté longtemps en tête de<br />
l'assemblée centuriate, tandis que leurs membres étaient exclus de l'assemblée<br />
<strong>des</strong> tribus, leur influence politique dépendait de l'issue de la lutte séculaire<br />
engagée entre la noblesse et la plèbe.<br />
Il est donc nécessaire, pour suivre les vicissitu<strong>des</strong> par lesquelles a passé la<br />
chevalerie considérée comme corps politique, d'esquisser un tableau <strong>des</strong><br />
révolutions romaines, et surtout de remonter à la cause principale qui les a<br />
produites. Cette cause, c'est celle que Niebuhr a indiquée, mais sans déduire<br />
toutes les conséquences qu'elle renfermait : c'est la dualité primitive du peuple<br />
Romain, l'antagonisme du patriciat de la ville et de la plèbe rustique ; plus tard,<br />
de la noblesse urbaine, et de l'aristocratie municipale <strong>des</strong> chevalier<br />
Cicéron opposait encore dans le pro Sulla1 le patricien, l'homme dont la famille<br />
était originaire de Rome, au citoyen d'origine municipale qui, pour le Romain de<br />
la ville, était un étranger à cause de ce défaut de naissance. Les municipes les<br />
plus rapprochés de la ville, comme Tusculum, devinrent presque <strong>des</strong> faubourgs<br />
de Rome. Leur noblesse confondit ses intérêts, ses sentiments avec ceux du<br />
patriciat. Mais les municipes, les colonies, les préfectures plus éloignées<br />
continuèrent la lutte de la campagne contre la ville. Leurs chefs, c'étaient ces<br />
hommes nouveaux que la vieille aristocratie écartait <strong>des</strong> honneurs avec un soin<br />
jaloux2. Cicéron résumait toute l'histoire politique de Rome en trois mots,<br />
lorsque comparant Mina, à l'orgueilleuse Tusculum, qui déjà ne comptait plus ses<br />
consulaires, il disait : Atina, préfecture moins ancienne, moins voisine de Rome,<br />
et moins illustre que Tusculum par les magistrats qu'elle a produits3.<br />
Nous avons montré que la plèbe rustique et le patriciat formaient, en 493 av. J -<br />
C., deux peuples rivaux, mais unis par le besoin d'une défense commune et par<br />
le traité qui avait consacré l'institution du tribunat. Bientôt la plèbe urbaine, un<br />
instant unie à la plèbe rustique pour obtenir cette importante garantie, s'en<br />
détache, et retombe sous le joug <strong>des</strong> patriciens. Dès 470 av. J.-C., les plébéiens<br />
ne veulent plus que les curies décident l'élection <strong>des</strong> tribuns de la plèbe, parce<br />
que les clients <strong>des</strong> nobles forment la majorité dans l'assemblée curiate4. C'est à<br />
la même époque que, selon Pison, on nomme cinq tribuns de la plèbe au lieu de<br />
deux. Chacun représente une <strong>des</strong> cinq premières classes5. La sixième classe,<br />
celle qui devait contenir la plupart <strong>des</strong> affranchis de la ville, se trouve ainsi<br />
séparée de la plèbe rustique, et privée de la protection tribunitienne.<br />
1 Pro Sulla, ch. VII et VIII. Cicéron dit à L. Manlius Torquatus : Illud quœro, cur me<br />
peregrinum esse dixeris ? — Hoc dito te esse ex municipio (Arpinatium). — Fateor.... non<br />
possunt omnes esse patricii.... Ac si, judices, ceteris patriciis, me et vos peregrinos videri<br />
oporteret, a Torquato tamen hoc vitium sileretur. Est enim ipso a materno genere<br />
municipalis. La même opposition se retrouve à toutes les pages du Pro Sextio (ch. XV,<br />
XXV, XXVII, XLV, L, LIII, LIX, LXII). Cicéron, au chapitre XLV de ce plaidoyer, appelle le<br />
grand parti qu'il représente municipales rusticique Romani, et, au chapitre L, rerum<br />
populum, par opposition à la populace urbaine soudoyée par le patriciat.<br />
2 Cicéron, Pro Murena, VIII.<br />
3 Pro Plancio, VIII. Voir aussi les chapitres VI et IX.<br />
4 Tite-Live, II, 53. Comparez Denys (IV, 23, fin), sur l'introduction <strong>des</strong> affranchis dans<br />
l'assemblée curiate, au temps de Servius.<br />
5 Asconius, In oratione pro C. Cornelia, s. v. Tanta igitur virtus. Comparez Tite-Live, III,<br />
30.