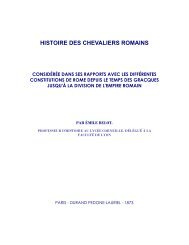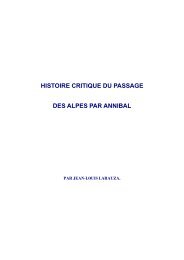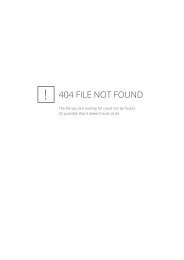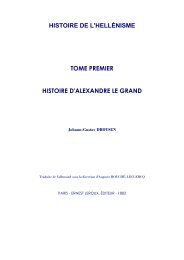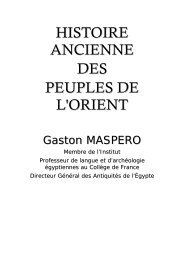HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
cent mille sesterces, ils n'étaient regardés que comme possesseurs d'une demifortune1,<br />
d'un demi-cens ; ils n'étaient pas censi, quoiqu'ils fussent hommes <strong>des</strong><br />
classes (classici)2. Ils n'étaient pas soumis à la loi Voconia et pouvaient instituer<br />
leur fille héritière de tout leur bien, quand même ce bien eût été estimé 90 mille<br />
sesterces.<br />
Si l'on suppose au contraire ; comme MM. Bœckh et Zumpt, qu'au temps <strong>des</strong><br />
deux dernières guerres puniques, le chiffre du cens de la première classe était<br />
seulement de cent mille as de deux onces, ou de quarante mille sesterces, nième<br />
si on l'élève avec Aulu-Gelle à cent vingt-cinq mille as ou à cinquante mille<br />
sesterces3, la loi Voconia, faite en l'an 168 av. J.-C., devient tout à fait<br />
incompréhensible. Comment un législateur, qui voulait restreindre les héritages<br />
<strong>des</strong> femmes, qui même, selon Cicéron, avait été à leur égard d'une révoltante<br />
injustice, leur aurait-il permis d'hériter jusqu'à vingt-cinq mille deniers oh deux<br />
cent cinquante mille as de deux onces, si cette somme eût été au moins double<br />
de la valeur d'une fortune de première classe ?<br />
A qui d'ailleurs cette loi s'appliquait-elle ? aux censi, c'est-à-dire, d'après<br />
Asconius, à ceux qui avaient plus de cent mille sesterces ou de deux cent<br />
cinquante mille as. Ceux qui avaient moins en étaient exempts. Dans l'hypothèse<br />
<strong>des</strong> érudits allemands, les quatre dernières classes et même une grande partie<br />
de la première eussent échappé à la loi. La fille unique étant favorisée, la loi ne<br />
s'appliquait dans sa plus grande rigueur qu'aux successions à recueillir par<br />
plusieurs enfants4. Un père qui avait cinq cent mille as de fortune à partager<br />
entre un fils et une fille, n'était pas fort embarrassé pour rétablir entre eux<br />
l'égalité. Il en était quitte pour léguer à sa fille cent mille sesterces, comme la loi<br />
le permettait. Ainsi la loi Voconia, si le cens de la première classe eût été de cent<br />
mille as, n'eût produit d'effet possible que dans le partage <strong>des</strong> successions qui<br />
eussent valu plus que le double du cens de la première classe, et d'effet certain,<br />
que dans le partage de celles qui auraient été plus de cinq fois plus<br />
considérables. On ne peut supposer que Caton cid dépensé sou éloquence pour<br />
faire voter une loi qui n'aurait obligé presque personne, et dont l'application eut<br />
été un fait exceptionnel, comme le serait en France, celle d'une loi qui<br />
dérangerait l'égalité, <strong>des</strong> partages entre les enfants de millionnaires.<br />
1 Asconius (In Verrem prætura urbana, s. v. Neque census esset) dit : Centum millia<br />
sestertium.... Hujusmodi adeo facultates census vocabantur. Cinquante mille sesterces<br />
étaient donc ce que nous appelons une demi-fortune ; c'était celle <strong>des</strong> citoyens de la<br />
cinquième classe.<br />
2 Il n'est pas étonnant que les citoyens de la cinquième classe fussent distingués, par la<br />
loi civile, <strong>des</strong> censi ou citoyens <strong>des</strong> quatre premières classes ; car cette distinction était,<br />
dès l'origine, faite par la loi militaire et par la loi politique. La quatrième classe, selon<br />
Denys (IV, 17 et 18), formait, dans la légion de Servius, le dernier rang <strong>des</strong> phalangites.<br />
La cinquième classe fournissait l'infanterie légère, qui combattait hors <strong>des</strong> rangs<br />
(vélites). Dans l'assemblée centuriate, Denys dit encore (IV, 20, fin) que le plus souvent<br />
le vote prenait fin dès l'appel de la première classe, que rarement on allait jusqu'à<br />
appeler la quatrième, et que la cinquième et la dernière ne figuraient dans l'assemblée<br />
pour la forme.<br />
3 Aulu-Gelle, VII, 13.<br />
4 Si l'on suppose qu'un père avait deux filles et qu'il fût census, comme elles ne<br />
pouvaient être héritières, mais seulement légataires, et que la somme <strong>des</strong> legs ne<br />
pouvait dépasser la valeur laissée aux héritiers, le père ne pouvait léguer à chacune de<br />
ses filles que le quart de sa fortune.