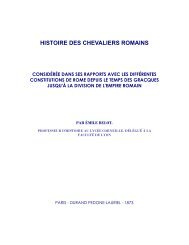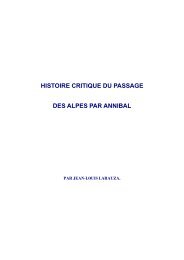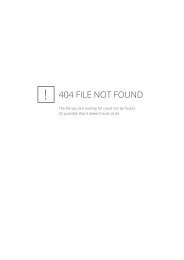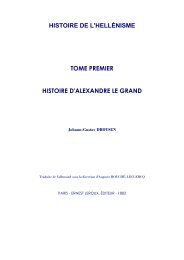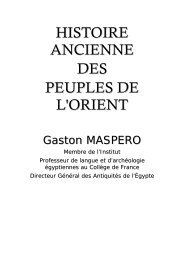HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
l'Arniensis, qui était la dernière <strong>des</strong> tribus rustiques1 ; et dans chaque tribu, par<br />
une raison religieuse, la centurie <strong>des</strong> juniores votait avant celle <strong>des</strong> seniores de<br />
la même classe2. De même dans la chevalerie equo publico, les douze centuries<br />
votaient avant les six suffrages, non-seulement parce qu'elles représentaient<br />
mieux les intérêts de la plèbe, mais parce que les six suffrages contenaient les<br />
sénateurs, c'est-à-dire les seniores de la chevalerie equo publico.<br />
La révolution politique qui s'accomplit entre 240 et 218 av. J.-C., changea aussi<br />
la constitution de l'assemblée <strong>des</strong> tribus. Les six centuries sénatoriales de<br />
chevaliers ayant perdu le privilège de voter au Champ-de-Mars en tête de<br />
l'assemblée centuriate et de former avec les douze centuries equo publico un<br />
peuple et <strong>des</strong> comices à part, la plèbe n'avait plus aucune raison de s'isoler de<br />
son côté dans l'assemblée par tribus.<br />
Les sénateurs et leurs fils commencèrent donc à voter dans l'assemblée<br />
plébéienne d'où une loi spéciale les avait jusque-là écartés. Chaque sénateur<br />
avait toujours été inscrit dans une tribu à titre de contribuable et de citoyen<br />
astreint au service militaire. Désormais il y fut avec ses fils inscrit comme<br />
votant3, parce que les dix-huit centuries equo publico faisaient partie de la<br />
première classe, et qu'elles furent désormais, comme cette classe tout entière,<br />
distribuées par les censeurs entre les trente-cinq tribus.<br />
Le sens du mot populus reçut une nouvelle extension. Il avait d'abord désigné<br />
exclusivement le peuple noble de la ville, l'aristocratie <strong>des</strong> Rhamnes, <strong>des</strong> Tities et<br />
<strong>des</strong> Luceres ; sons le règne de Servius, on comprit sous ce nom, outre<br />
l'aristocratie patricienne, les chevaliers <strong>des</strong> douze centuries nouvellement créées,<br />
et même les clients et les affranchis inscrits comme citoyens dans les trente<br />
curies. Seulement l'orgueil nobiliaire avait établi une distinction, dans le sein<br />
même <strong>des</strong> curies, entre le peuple noble et les humbles Quirites de la plèbe<br />
urbaine. Le prêtre patricien priait pour le peuple romain et pour les hommes <strong>des</strong><br />
curies, pro populo Romano Quiritibusque.<br />
La réforme qui eut lieu vers l'an 240 av. J-C., en consacrant le triomphe de la<br />
plèbe, en anoblissant eu quelque sorte les tribus, divisées chacune en cinq<br />
classes, étendit à toutes les classes de l'assemblée centuriate cette qualification<br />
jusque-là tout urbaine de populus. C'est peu près depuis la fin de la première<br />
guerre punique, que ce nom reçut le sens compréhensif que lui attribuent Gaius4<br />
et Aulu-Gelle5.<br />
En même temps les citoyens <strong>des</strong> classes moyennes, les plébéiens de la<br />
campagne, étaient inscrits dans les trente curies de la ville, et tous les Romains<br />
recevaient le nom commun de Quirites.<br />
1 Cicéron, De lege agraria, II, 9.9. La Romilia, la première <strong>des</strong> tribus rustiques, était<br />
appelée la cinquième (quinta). Varron, L. L., IV, 9.<br />
2 D'après Aulu-Gelle (X, 28), les juniores avaient de 17 à 46 ans ; les seniores de 46 à<br />
60. Cette assertion d'Aulu-Gelle est probablement inexacte. Trente-cinq ans était l'âge<br />
sénatorial, et plusieurs passages, l'un de Tite-Live (XXII, ch. XI, fin), les autres de<br />
Suétone (Vie d'Auguste, ch. XXXII et XXXVIII), semblent faire croire que c'était aussi<br />
l'âge <strong>des</strong> seniores. Comment les seniores auraient-ils été en même nombre que les<br />
juniores, au temps de Servius, si l'un <strong>des</strong> deux âges eût compris tous les jeunes gens de<br />
17 à 46 ans, et l'autre, seulement les hommes de 46 à 60 ans ?<br />
3 Varron, De re rustica, III, 2.<br />
4 Gaius, I, 3.<br />
5 Aulu-Gelle, X, 20.