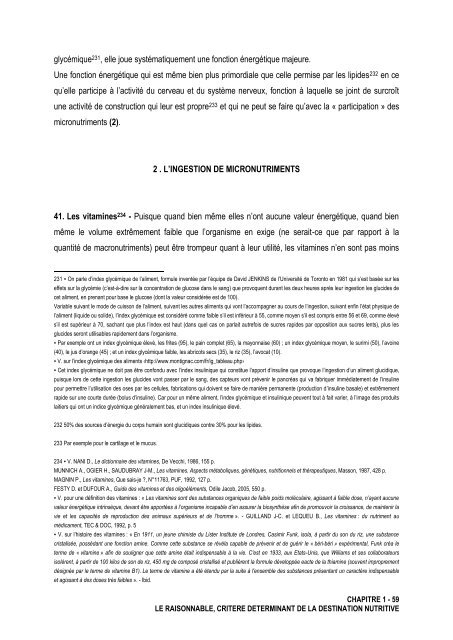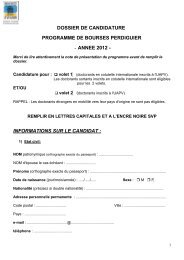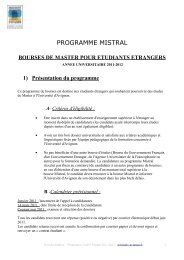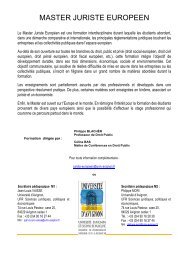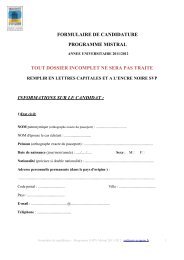La notion de denrées alimentaires - Université d'Avignon et des ...
La notion de denrées alimentaires - Université d'Avignon et des ...
La notion de denrées alimentaires - Université d'Avignon et des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
glycémique 231 , elle joue systématiquement une fonction énergétique majeure.<br />
Une fonction énergétique qui est même bien plus primordiale que celle permise par les lipi<strong>de</strong>s 232 en ce<br />
quřelle participe à lřactivité du cerveau <strong>et</strong> du système nerveux, fonction à laquelle se joint <strong>de</strong> surcroît<br />
une activité <strong>de</strong> construction qui leur est propre 233 <strong>et</strong> qui ne peut se faire quřavec la « participation » <strong>de</strong>s<br />
micronutriments (2).<br />
2 . L’INGESTION DE MICRONUTRIMENTS<br />
41. Les vitamines 234 - Puisque quand bien même elles nřont aucune valeur énergétique, quand bien<br />
même le volume extrêmement faible que lřorganisme en exige (ne serait-ce que par rapport à la<br />
quantité <strong>de</strong> macronutriments) peut être trompeur quant à leur utilité, les vitamines nřen sont pas moins<br />
231 ▪ On parle dřin<strong>de</strong>x glycémique <strong>de</strong> lřaliment, formule inventée par lřéquipe <strong>de</strong> David JENKINS <strong>de</strong> lř<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Toronto en 1981 qui sřest basée sur les<br />
eff<strong>et</strong>s sur la glycémie (cřest-à-dire sur la concentration <strong>de</strong> glucose dans le sang) que provoquent durant les <strong>de</strong>ux heures après leur ingestion les gluci<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
c<strong>et</strong> aliment, en prenant pour base le glucose (dont la valeur considérée est <strong>de</strong> 100).<br />
Variable suivant le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> cuisson <strong>de</strong> lřaliment, suivant les autres aliments qui vont lřaccompagner au cours <strong>de</strong> lřingestion, suivant enfin lřétat physique <strong>de</strong><br />
lřaliment (liqui<strong>de</strong> ou soli<strong>de</strong>), lřin<strong>de</strong>x glycémique est considéré comme faible sřil est inférieur à 55, comme moyen sřil est compris entre 56 <strong>et</strong> 69, comme élevé<br />
sřil est supérieur à 70, sachant que plus lřin<strong>de</strong>x est haut (dans quel cas on parlait autrefois <strong>de</strong> sucres rapi<strong>de</strong>s par opposition aux sucres lents), plus les<br />
gluci<strong>de</strong>s seront utilisables rapi<strong>de</strong>ment dans lřorganisme.<br />
▪ Par exemple ont un in<strong>de</strong>x glycémique élevé, les frites (95), le pain compl<strong>et</strong> (65), la mayonnaise (60) ; un in<strong>de</strong>x glycémique moyen, le surimi (50), lřavoine<br />
(40), le jus dřorange (45) ; <strong>et</strong> un in<strong>de</strong>x glycémique faible, les abricots secs (35), le riz (35), lřavocat (10).<br />
▪ V. sur lřin<strong>de</strong>x glycémique <strong>de</strong>s aliments ‹http://www.montignac.com/fr/ig_tableau.php›<br />
▪ C<strong>et</strong> in<strong>de</strong>x glycémique ne doit pas être confondu avec lřin<strong>de</strong>x insulinique qui constitue lřapport dřinsuline que provoque lřingestion dřun aliment glucidique,<br />
puisque lors <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te ingestion les gluci<strong>de</strong>s vont passer par le sang, <strong>de</strong>s capteurs vont prévenir le pancréas qui va fabriquer immédiatement <strong>de</strong> lřinsuline<br />
pour perm<strong>et</strong>tre lřutilisation <strong>de</strong>s oses par les cellules, fabrications qui doivent se faire <strong>de</strong> manière permanente (production dřinsuline basale) <strong>et</strong> extrêmement<br />
rapi<strong>de</strong> sur une courte durée (bolus dřinsuline). Car pour un même aliment, lřin<strong>de</strong>x glycémique <strong>et</strong> insulinique peuvent tout à fait varier, à lřimage <strong>de</strong>s produits<br />
laitiers qui ont un indice glycémique généralement bas, <strong>et</strong> un in<strong>de</strong>x insulinique élevé.<br />
232 50% <strong>de</strong>s sources dřénergie du corps humain sont glucidiques contre 30% pour les lipi<strong>de</strong>s.<br />
233 Par exemple pour le cartilage <strong>et</strong> le mucus.<br />
234 ▪ V. NANI D., Le dictionnaire <strong>de</strong>s vitamines, De Vecchi, 1986, 155 p.<br />
MUNNICH A., OGIER H., SAUDUBRAY J-M., Les vitamines. Aspects métaboliques, génétiques, nutritionnels <strong>et</strong> thérapeutiques, Masson, 1987, 428 p.<br />
MAGNIN P., Les vitamines, Que sais-je ?, N°11763, PUF, 1992, 127 p.<br />
FESTY D. <strong>et</strong> DUFOUR A., Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong>s vitamines <strong>et</strong> <strong>de</strong>s oligoéléments, Odile Jacob, 2005, 550 p.<br />
▪ V. pour une définition <strong>de</strong>s vitamines : « Les vitamines sont <strong>de</strong>s substances organiques <strong>de</strong> faible poids moléculaire, agissant à faible dose, n’ayant aucune<br />
valeur énergétique intrinsèque, <strong>de</strong>vant être apportées à l’organisme incapable d’en assurer la biosynthèse afin <strong>de</strong> promouvoir la croissance, <strong>de</strong> maintenir la<br />
vie <strong>et</strong> les capacités <strong>de</strong> reproduction <strong>de</strong>s animaux supérieurs <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’homme ». - GUILLAND J-C. <strong>et</strong> LEQUEU B., Les vitamines : du nutriment au<br />
médicament, TEC & DOC, 1992, p. 5<br />
▪ V. sur lřhistoire <strong>de</strong>s vitamines : « En 1911, un jeune chimiste du Lister Institute <strong>de</strong> Londres, Casimir Funk, isola, à partir du son du riz, une substance<br />
cristalisée, possédant une fonction amine. Comme c<strong>et</strong>te substance se révéla capable <strong>de</strong> prévenir <strong>et</strong> <strong>de</strong> guérir le « béri-béri » expérimental, Funk créa le<br />
terme <strong>de</strong> « vitamine » afin <strong>de</strong> souligner que c<strong>et</strong>te amine était indispensable à la vie. C'est en 1933, aux Etats-Unis, que Williams <strong>et</strong> ses collaborateurs<br />
isolèrent, à partir <strong>de</strong> 100 kilos <strong>de</strong> son <strong>de</strong> riz, 450 mg <strong>de</strong> composé cristallisé <strong>et</strong> publièrent la formule développée eacte <strong>de</strong> la thiamine (souvent improprement<br />
désignée par le terme <strong>de</strong> vitamine B1). Le terme <strong>de</strong> vitamine a été étendu par la suite à l'ensemble <strong>de</strong>s substances présentant un caractère indispensable<br />
<strong>et</strong> agissant à <strong>de</strong>s doses très faibles ». - Ibid.<br />
CHAPITRE 1 - 59<br />
LE RAISONNABLE, CRITERE DETERMINANT DE LA DESTINATION NUTRITIVE