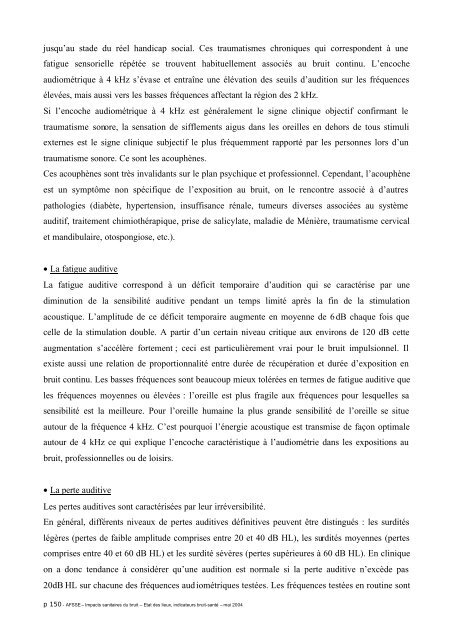- Page 1 and 2:
Impacts sanitaires du bruit État d
- Page 3 and 4:
Composition du groupe de travail Fa
- Page 5 and 6:
II-1) BRUIT ET AUDITION............
- Page 7 and 8:
IV-1-1) Compétences générales de
- Page 9 and 10:
Liste des figures Figure 1 : Inéga
- Page 11 and 12:
INRETS : Institut national de reche
- Page 13 and 14:
Ce rapport dresse un état des lieu
- Page 15 and 16:
apide, de la puissance mécanique.
- Page 17 and 18:
Directive européenne 2002/49/CE du
- Page 19 and 20:
En France, les connaissances en ter
- Page 21 and 22:
étude utilise un mode d’évaluat
- Page 23 and 24:
connaissance des processus psycholo
- Page 25 and 26:
Cette multiplicité rend complexe l
- Page 27 and 28:
RECOMMANDATIONS Ce rapport donne li
- Page 29 and 30:
déclarer gênés dans leur vie quo
- Page 31 and 32:
de se déclarer souvent gêné par
- Page 33 and 34:
épondants à l’enquête CREDOC 2
- Page 35 and 36:
I-1) LE BRUIT DANS L’HABITAT ET L
- Page 37 and 38:
Les enfants, lorsqu’ils crient, p
- Page 39 and 40:
Une installation de chauffage à ci
- Page 41 and 42:
l’appareil. Dans son analyse de l
- Page 43 and 44:
La méthodologie d’appréciation
- Page 45 and 46:
I-1-3) Isolation et traitement acou
- Page 47 and 48:
I-1-3-2) Isolement aux bruits d’i
- Page 49 and 50:
campagnes de mesures réalisées à
- Page 51 and 52:
I-2-1-2) Structure de la musique Ou
- Page 53 and 54:
numérisées ou enregistrées (dans
- Page 55 and 56:
econduite à l’occasion du plan n
- Page 57 and 58:
et qui concernent aussi les salles
- Page 59 and 60:
En termes de temps de réverbérati
- Page 61 and 62:
Local d’émission ? Local de réc
- Page 63 and 64:
En Italie, le bruit généré par l
- Page 65 and 66:
I-2-4-2) Locaux de santé et hôtel
- Page 67 and 68:
I-3) LE BRUIT AMBIANT Ce chapitre t
- Page 69 and 70:
Les phénomènes de Slip and Stick
- Page 71 and 72:
des phénomènes et les méthodes d
- Page 73 and 74:
L’article 13 institue le classeme
- Page 75 and 76:
Description des différentes source
- Page 77 and 78:
années futures, dans la mesure où
- Page 79 and 80:
l’adjonction d’échappements, c
- Page 81 and 82:
simple diagnostic de nuisances sono
- Page 83 and 84:
attribuent des niveaux de sonie et
- Page 85 and 86:
intervenue en avril 2002 a été pr
- Page 87 and 88:
territoriales et des projets permet
- Page 89 and 90:
Activités aériennes militaires Su
- Page 91 and 92:
domine les autres composantes de br
- Page 93 and 94:
La réduction des nuisances sonores
- Page 95 and 96:
- Effet sur des équipements sensib
- Page 97 and 98:
suivre pour éviter les nuisances s
- Page 99 and 100: Les nouvelles exigences acoustiques
- Page 101 and 102: I-3-2) Bruits dans les moyens de tr
- Page 103 and 104: Les résultats sont les suivants :
- Page 105 and 106: - il existe aussi des facteurs psyc
- Page 107 and 108: Aspect réglementaire général sp
- Page 109 and 110: Les règles techniques de mesure du
- Page 111 and 112: - le niveau de bruit admissible pou
- Page 113 and 114: classées, en fonction de l’impla
- Page 115 and 116: La directive 2000/14/CE est applica
- Page 117 and 118: Matériel Bruit mesuré (1) dB(A) D
- Page 119 and 120: - les barotraumatismes auxquels peu
- Page 121 and 122: Selon une enquête du Ministère du
- Page 123 and 124: contre les risques dus à l’expos
- Page 125 and 126: • Évolutions réglementaires pr
- Page 127 and 128: Tableau 13 : Quelques exemples de n
- Page 129 and 130: L'écart entre deux-roues et voitur
- Page 131 and 132: - les conditions dans lesquelles l
- Page 133 and 134: niveaux sonores d’homologation, p
- Page 135 and 136: (3) la réflexion sur les surfaces
- Page 137 and 138: Gradient de température positif Gr
- Page 139 and 140: - des modélisations simplifiées d
- Page 141 and 142: L’enjeu de cette réflexion (abso
- Page 143 and 144: essais de caractérisation des prop
- Page 145 and 146: Figure 13 : Exemple de calcul par
- Page 147 and 148: d’un trauma crânien ou d’un tr
- Page 149: Membrane réticulaire Cellules cili
- Page 153 and 154: * Les acouphènes Le traumatisme so
- Page 155 and 156: l’exposition se prolongeait. Il s
- Page 157 and 158: Prévalence des acouphènes En mili
- Page 159 and 160: II-2) EFFETS BIOLOGIQUES EXTRA-AUDI
- Page 161 and 162: La perturbation d’une séquence n
- Page 163 and 164: (Vallet M., Gagneux J.M. et al., 19
- Page 165 and 166: sonores diurnes. Une seule étude,
- Page 167 and 168: l’élévation de la pression art
- Page 169 and 170: note une augmentation des catéchol
- Page 171 and 172: l'état de stress chez celui-ci (St
- Page 173 and 174: II-3) EFFETS SUBJECTIFS DU BRUIT Si
- Page 175 and 176: Ces enquêtes ont montré pour la p
- Page 177 and 178: transport dans l’économie de la
- Page 179 and 180: différent du sien. Or beaucoup de
- Page 181 and 182: II-3-3) Les effets du bruit sur les
- Page 183 and 184: syntaxique pour « combler les vide
- Page 185 and 186: Environnement spécifique Effet cri
- Page 187 and 188: La durée de réverbération (TR) i
- Page 189 and 190: Lukas et al. ont conduit une étude
- Page 191 and 192: II-4-2-1) Multiexposition au bruit
- Page 193 and 194: II-4-3) Connaissance des coexpositi
- Page 195 and 196: Il convient d'avertir et d'informer
- Page 197 and 198: la perméabilité membranaire des c
- Page 199 and 200: plus en plus rapprochées (rythme c
- Page 201 and 202:
Figure 20 : Voies d'intoxication em
- Page 203 and 204:
Les compromis trouvés par les suje
- Page 205 and 206:
facteurs de risque et comportements
- Page 207 and 208:
La surdité présente cependant une
- Page 209 and 210:
II-5-3-5) Métiers accessibles aux
- Page 211 and 212:
II-5-4-2) Efficacité des protectio
- Page 213 and 214:
Bruit en façade exprimé en Taux d
- Page 215 and 216:
Exposure Level) qui, a contrario du
- Page 217 and 218:
laquelle on mesure le LAeq ambiant
- Page 219 and 220:
de trafics assez continus, la diff
- Page 221 and 222:
parmi les riverains de l’aéropor
- Page 223 and 224:
III-1-2-4) Les indicateurs de la Di
- Page 225 and 226:
III-2) AMELIORATIONS DES TECHNIQUES
- Page 227 and 228:
d'impulsivité. Il existe une disto
- Page 229 and 230:
III-3) AMELIORATIONS OU EVOLUTIONS
- Page 231 and 232:
uit. Très peu de pays retiennent u
- Page 233 and 234:
Définition des principaux descript
- Page 235 and 236:
- contrôle des règles de construc
- Page 237 and 238:
IV-1-1-2) Construction d’une nouv
- Page 239 and 240:
correspondantes, notamment (mais pa
- Page 241 and 242:
justifier les choix retenus par la
- Page 243 and 244:
- préciser les mesures de nature
- Page 245 and 246:
situés à l’arrière. L’épann
- Page 247 and 248:
Les maires des communes concernées
- Page 249 and 250:
dans certains secteurs avec la cré
- Page 251 and 252:
de jour et à 60 dB(A) de nuit, et
- Page 253 and 254:
d’urbanisme. Elle apporte à ce t
- Page 255 and 256:
(1) le bruit est une nuisance diffi
- Page 257 and 258:
économiques contradictoires. La lu
- Page 259 and 260:
Tous ces éléments cumulés se ré
- Page 261 and 262:
terrestres, dont l’objet est de c
- Page 263 and 264:
Références bibliographiques Confe
- Page 265 and 266:
exemple de partenariat et de coopé
- Page 267 and 268:
Cancer Chemother Pharmacol, n°51 p
- Page 269 and 270:
- Hiel H., Schamel A., Erre J.P., H
- Page 271 and 272:
à Paris, mars 2002. - Lambert J.,
- Page 273 and 274:
- Moch A. et Maramotti I., "Les amb
- Page 275 and 276:
nerve synapse contribute to both TT
- Page 277 and 278:
Présentation des membres du groupe
- Page 279 and 280:
Michel Hubert (auteur) est chargé
- Page 281 and 282:
Michel Vallet (auteur), psychologue
- Page 283 and 284:
RECOMMANDATIONS p 282 - AFSSE - Imp
- Page 285 and 286:
1. INDICATEURS BRUIT - SANTE Une pr
- Page 287 and 288:
homogène de données. Les étalonn
- Page 289 and 290:
connaissance de l’exposition au b
- Page 291 and 292:
effets strictement auditifs. Il con
- Page 293 and 294:
et donc ne prend pas en compte le t
- Page 295 and 296:
- des marqueurs sanitaires indirect
- Page 297 and 298:
Si l’arsenal réglementaire est r
- Page 299 and 300:
compétition des acheteurs) ; d’a
- Page 301 and 302:
3.2. Études d’impact : bruit des
- Page 303 and 304:
simulation virtuelle du résultat a
- Page 305 and 306:
Les expositions sonores les plus d
- Page 307 and 308:
p 2 - AFSSE - Impacts sanitaires du
- Page 309 and 310:
ANNEXE 1 - Le signal acoustique, se
- Page 311 and 312:
A-I-2-2) Grandeurs de l’acoustiqu
- Page 313 and 314:
S.E.L LAeq LA 90 80 70 60 50 10 9 1
- Page 315 and 316:
ANNEXE 2 - Bruit ferroviaire en mil
- Page 317 and 318:
Actions de la RATP en matière de l
- Page 319 and 320:
Insertion des nouvelles infrastruct
- Page 321 and 322:
Le service du réseau d’autobus
- Page 323 and 324:
ANNEXE 3 - Bruits et vibrations li
- Page 325 and 326:
est identifié à partir des mesure
- Page 327 and 328:
voyageurs et fret et pour des vites
- Page 329 and 330:
allemande DEUFRAKO). À partir des
- Page 331 and 332:
acoustique émise par celle-ci de p
- Page 333 and 334:
ANNEXE 4 - Un exemple de campagne d
- Page 335 and 336:
Musique forte en soirée entre copa
- Page 337 and 338:
On distingue deux grandes catégori
- Page 339 and 340:
c- Intensité du bruit Le risque de
- Page 341 and 342:
Le bruit aérodynamique, quant à l
- Page 343 and 344:
- les associations spécialisées d
- Page 345 and 346:
13 - Où puis-je me renseigner sur