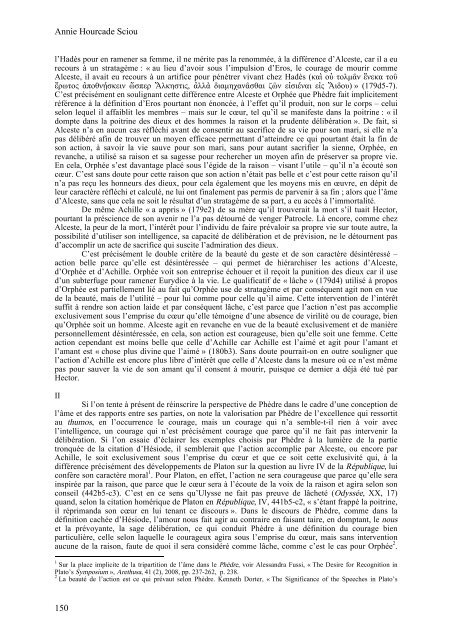Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Annie Hourcade Sciou<br />
l’Hadès pour en ramener sa femme, il ne mérite pas la renommée, à la différence d’Alceste, car il a eu<br />
recours à un stratagème : « au lieu d’avoir sous l’impulsion d’Eros, le courage de mourir comme<br />
Alceste, il avait eu recours à un artifice pour pénétrer vivant chez Hadès (καὶ οὐ τολµᾶν ἕνεκα τοῦ<br />
ἔρωτος ἀποθνῄσκειν ὥσπερ Ἄλκηστις, ἀλλὰ διαµηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἅιδου) » (179d5-7).<br />
C’est précisément en soulignant cette différence entre Alceste et Orphée que Phèdre fait implicitement<br />
référence à la définition d’Eros pourtant non énoncée, à l’effet qu’il produit, non sur le corps – celui<br />
selon lequel il affaiblit les membres – mais sur le cœur, tel qu’il se manifeste dans la poitrine : « il<br />
dompte dans la poitrine des dieux et des hommes la raison et la prudente délibération ». De fait, si<br />
Alceste n’a en aucun cas réfléchi avant de consentir au sacrifice de sa vie pour son mari, si elle n’a<br />
pas délibéré afin de trouver un moyen efficace permettant d’atteindre ce qui pourtant était la fin de<br />
son action, à savoir la vie sauve pour son mari, sans pour autant sacrifier la sienne, Orphée, en<br />
revanche, a utilisé sa raison et sa sagesse pour rechercher un moyen afin de préserver sa propre vie.<br />
En cela, Orphée s’est davantage placé sous l’égide de la raison – visant l’utile – qu’il n’a écouté son<br />
cœur. C’est sans doute pour cette raison que son action n’était pas belle et c’est pour cette raison qu’il<br />
n’a pas reçu les honneurs des dieux, pour cela également que les moyens mis en œuvre, en dépit de<br />
leur caractère réfléchi et calculé, ne lui ont finalement pas permis de parvenir à sa fin ; alors que l’âme<br />
d’Alceste, sans que cela ne soit le résultat d’un stratagème de sa part, a eu accès à l’immortalité.<br />
De même Achille « a appris » (179e2) de sa mère qu’il trouverait la mort s’il tuait Hector,<br />
pourtant la préscience de son avenir ne l’a pas détourné de venger Patrocle. Là encore, comme chez<br />
Alceste, la peur de la mort, l’intérêt pour l’individu de faire prévaloir sa propre vie sur toute autre, la<br />
possibilité d’utiliser son intelligence, sa capacité de délibération et de prévision, ne le détournent pas<br />
d’accomplir un acte de sacrifice qui suscite l’admiration des dieux.<br />
C’est précisément le double critère de la beauté du geste et de son caractère désintéressé –<br />
action belle parce qu’elle est désintéressée – qui permet de hiérarchiser les actions d’Alceste,<br />
d’Orphée et d’Achille. Orphée voit son entreprise échouer et il reçoit la punition des dieux car il use<br />
d’un subterfuge pour ramener Eurydice à la vie. Le qualificatif de « lâche » (179d4) utilisé à propos<br />
d’Orphée est partiellement lié au fait qu’Orphée use de stratagème et par conséquent agit non en vue<br />
de la beauté, mais de l’utilité – pour lui comme pour celle qu’il aime. Cette intervention de l’intérêt<br />
suffit à rendre son action laide et par conséquent lâche, c’est parce que l’action n’est pas accomplie<br />
exclusivement sous l’emprise du cœur qu’elle témoigne d’une absence de virilité ou de courage, bien<br />
qu’Orphée soit un homme. Alceste agit en revanche en vue de la beauté exclusivement et de manière<br />
personnellement désintéressée, en cela, son action est courageuse, bien qu’elle soit une femme. Cette<br />
action cependant est moins belle que celle d’Achille car Achille est l’aimé et agit pour l’amant et<br />
l’amant est « chose plus divine que l’aimé » (180b3). Sans doute pourrait-on en outre souligner que<br />
l’action d’Achille est encore plus libre d’intérêt que celle d’Alceste dans la mesure où ce n’est même<br />
pas pour sauver la vie de son amant qu’il consent à mourir, puisque ce dernier a déjà été tué par<br />
Hector.<br />
II<br />
Si l’on tente à présent de réinscrire la perspective de Phèdre dans le cadre d’une conception de<br />
l’âme et des rapports entre ses parties, on note la valorisation par Phèdre de l’excellence qui ressortit<br />
au thumos, en l’occurrence le courage, mais un courage qui n’a semble-t-il rien à voir avec<br />
l’intelligence, un courage qui n’est précisément courage que parce qu’il ne fait pas intervenir la<br />
délibération. Si l’on essaie d’éclairer les exemples choisis par Phèdre à la lumière de la partie<br />
tronquée de la citation d’Hésiode, il semblerait que l’action accomplie par Alceste, ou encore par<br />
Achille, le soit exclusivement sous l’emprise du cœur et que ce soit cette exclusivité qui, à la<br />
différence précisément des développements de Platon sur la question au livre IV de la République, lui<br />
confère son caractère moral 1 . Pour Platon, en effet, l’action ne sera courageuse que parce qu’elle sera<br />
inspirée par la raison, que parce que le cœur sera à l’écoute de la voix de la raison et agira selon son<br />
conseil (442b5-c3). C’est en ce sens qu’Ulysse ne fait pas preuve de lâcheté (Odyssée, XX, 17)<br />
quand, selon la citation homérique de Platon en République, IV, 441b5-c2, « s’étant frappé la poitrine,<br />
il réprimanda son cœur en lui tenant ce discours ». Dans le discours de Phèdre, comme dans la<br />
définition cachée d’Hésiode, l’amour nous fait agir au contraire en faisant taire, en domptant, le nous<br />
et la prévoyante, la sage délibération, ce qui conduit Phèdre à une définition du courage bien<br />
particulière, celle selon laquelle le courageux agira sous l’emprise du cœur, mais sans intervention<br />
aucune de la raison, faute de quoi il sera considéré comme lâche, comme c’est le cas pour Orphée 2 .<br />
1 Sur la place implicite de la tripartition de l’âme dans le Phèdre, voir Alessandra Fussi, « The Desire for Recognition in<br />
Plato’s <strong>Symposium</strong> », Arethusa, 41 (2), 2008, pp. 237-262, p. 238.<br />
2 La beauté de l’action est ce qui prévaut selon Phèdre. Kenneth Dorter, « The Significance of the Speeches in Plato’s<br />
150