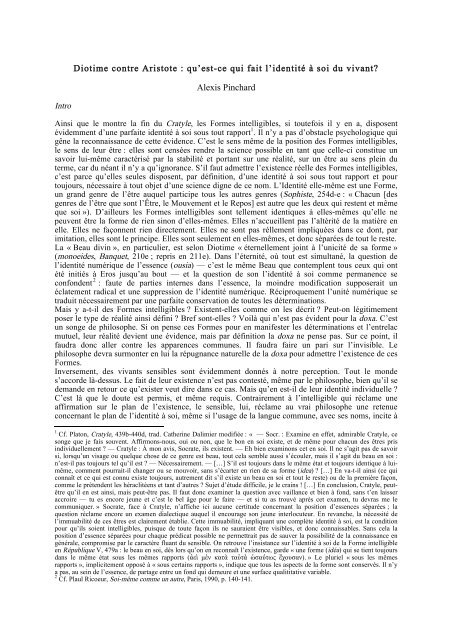You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Intro<br />
Diotime contre Aristote : qu’est-ce qui fait l’identité à soi du vivant?<br />
Alexis Pinchard<br />
Ainsi que le montre la fin du Cratyle, les Formes intelligibles, si toutefois il y en a, disposent<br />
évidemment d’une parfaite identité à soi sous tout rapport 1 . Il n’y a pas d’obstacle psychologique qui<br />
gêne la reconnaissance de cette évidence. C’est le sens même de la position des Formes intelligibles,<br />
le sens de leur être : elles sont censées rendre la science possible en tant que celle-ci constitue un<br />
savoir lui-même caractérisé par la stabilité et portant sur une réalité, sur un être au sens plein du<br />
terme, car du néant il n’y a qu’ignorance. S’il faut admettre l’existence réelle des Formes intelligibles,<br />
c’est parce qu’elles seules disposent, par définition, d’une identité à soi sous tout rapport et pour<br />
toujours, nécessaire à tout objet d’une science digne de ce nom. L’Identité elle-même est une Forme,<br />
un grand genre de l’être auquel participe tous les autres genres (Sophiste, 254d-e : « Chacun [des<br />
genres de l’être que sont l’Être, le Mouvement et le Repos] est autre que les deux qui restent et même<br />
que soi »). D’ailleurs les Formes intelligibles sont tellement identiques à elles-mêmes qu’elle ne<br />
peuvent être la forme de rien sinon d’elles-mêmes. Elles n’accueillent pas l’altérité de la matière en<br />
elle. Elles ne façonnent rien directement. Elles ne sont pas réllement impliquées dans ce dont, par<br />
imitation, elles sont le principe. Elles sont seulement en elles-mêmes, et donc séparées de tout le reste.<br />
La « Beau divin », en particulier, est selon Diotime « éternellement joint à l’unicité de sa forme »<br />
(monoeides, Banquet, 210e ; repris en 211e). Dans l’éternité, où tout est simultané, la question de<br />
l’identité numérique de l’essence (ousia) — c’est le même Beau que contemplent tous ceux qui ont<br />
été initiés à Eros jusqu’au bout — et la question de son l’identité à soi comme permanence se<br />
confondent 2 : faute de parties internes dans l’essence, la moindre modification supposerait un<br />
éclatement radical et une suppression de l’identité numérique. Réciproquement l’unité numérique se<br />
traduit nécessairement par une parfaite conservation de toutes les déterminations.<br />
Mais y a-t-il des Formes intelligibles ? Existent-elles comme on les décrit ? Peut-on légitimement<br />
poser le type de réalité ainsi défini ? Bref sont-elles ? Voilà qui n’est pas évident pour la doxa. C’est<br />
un songe de philosophe. Si on pense ces Formes pour en manifester les déterminations et l’entrelac<br />
mutuel, leur réalité devient une évidence, mais par définition la doxa ne pense pas. Sur ce point, il<br />
faudra donc aller contre les apparences communes. Il faudra faire un pari sur l’invisible. Le<br />
philosophe devra surmonter en lui la répugnance naturelle de la doxa pour admettre l’existence de ces<br />
Formes.<br />
Inversement, des vivants sensibles sont évidemment donnés à notre perception. Tout le monde<br />
s’accorde là-dessus. Le fait de leur existence n’est pas contesté, même par le philosophe, bien qu’il se<br />
demande en retour ce qu’exister veut dire dans ce cas. Mais qu’en est-il de leur identité individuelle ?<br />
C’est là que le doute est permis, et même requis. Contrairement à l’intelligible qui réclame une<br />
affirmation sur le plan de l’existence, le sensible, lui, réclame au vrai philosophe une retenue<br />
concernant le plan de l’identité à soi, même si l’usage de la langue commune, avec ses noms, incite à<br />
1 Cf. Platon, Cratyle, 439b-440d, trad. Catherine Dalimier modifiée : « — Socr. : Examine en effet, admirable Cratyle, ce<br />
songe que je fais souvent. Affirmons-nous, oui ou non, que le bon en soi existe, et de même pour chacun des êtres pris<br />
individuellement ? — Cratyle : À mon avis, Socrate, ils existent. — Eh bien examinons cet en soi. Il ne s’agit pas de savoir<br />
si, lorsqu’un visage ou quelque chose de ce genre est beau, tout cela semble aussi s’écouler, mais il s’agit du beau en soi :<br />
n’est-il pas toujours tel qu’il est ? — Nécessairement. — […] S’il est toujours dans le même état et toujours identique à luimême,<br />
comment pourrait-il changer ou se mouvoir, sans s’écarter en rien de sa forme (idea) ? […] En va-t-il ainsi (ce qui<br />
connaît et ce qui est connu existe toujours, autrement dit s’il existe un beau en soi et tout le reste) ou de la première façon,<br />
comme le prétendent les héraclitéens et tant d’autres ? Sujet d’étude difficile, je le crains ! […] En conclusion, Cratyle, peutêtre<br />
qu’il en est ainsi, mais peut-être pas. Il faut donc examiner la question avec vaillance et bien à fond, sans t’en laisser<br />
accroire — tu es encore jeune et c’est le bel âge pour le faire — et si tu as trouvé après cet examen, tu devras me le<br />
communiquer. » Socrate, face à Cratyle, n’affiche ici aucune certitude concernant la position d’essences séparées ; la<br />
question réclame encore un examen dialectique auquel il encourage son jeune interlocuteur. En revanche, la nécessité de<br />
l’immuabilité de ces êtres est clairement établie. Cette immuabilité, impliquant une complète identité à soi, est la condition<br />
pour qu’ils soient intelligibles, puisque de toute façon ils ne sauraient être visibles, et donc connaissables. Sans cela la<br />
position d’essence séparées pour chaque prédicat possible ne permettrait pas de sauver la possibilité de la connaissance en<br />
générale, compromise par le caractère fluant du sensible. On retrouve l’insistance sur l’identité à soi de la Forme intelligible<br />
en République V, 479a : le beau en soi, dès lors qu’on en reconnaît l’existence, garde « une forme (idéa) qui se tient toujours<br />
dans le même état sous les mêmes rapports (ἀεὶ µὲν κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχουσαν). » Le pluriel « sous les mêmes<br />
rapports », implicitement opposé à « sous certains rapports », indique que tous les aspects de la forme sont conservés. Il n’y<br />
a pas, au sein de l’essence, de partage entre un fond qui demeure et une surface qualititative variable.<br />
2 Cf. Plaul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, 1990, p. 140-141.